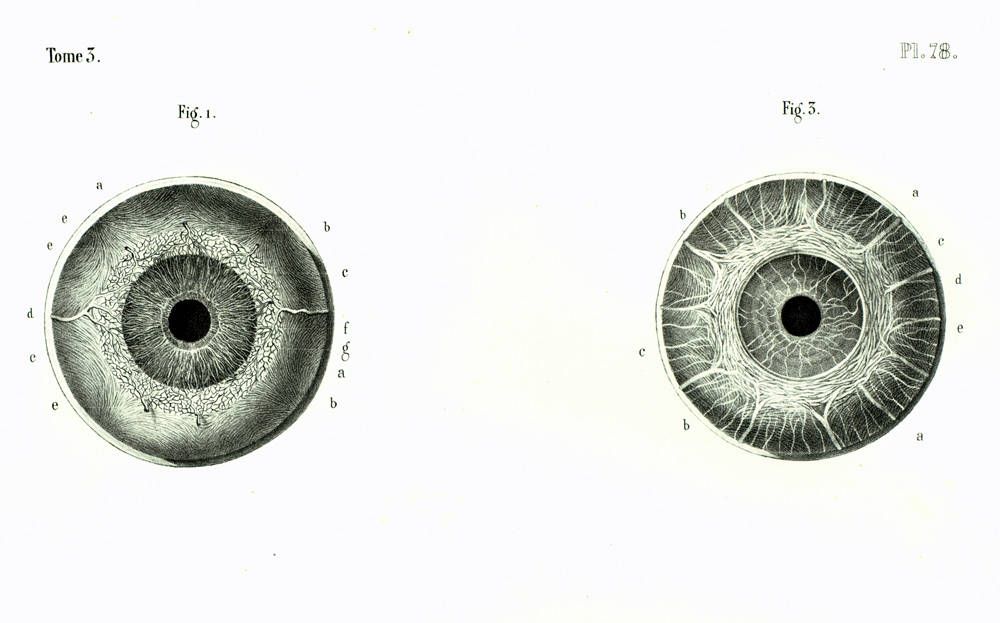Vous êtes spécialiste des questions de déviance et de criminalité. Pourquoi avez-vous investi ces champs de recherche ?
Je dirais un mélange de hasard et de nécessité pour faire un clin d’œil au livre classique de Jacques Monod. La nécessité, c’est ce que j’appelle les dispositions affectivo-intellectuelles. Concrètement, c’est sans doute d’abord l’empreinte familiale (mes deux parents étaient psy) qui fait que j’ai eu besoin de comprendre les problèmes sociaux, les déviances individuelles et sociales, et de chercher à savoir comment soulager les souffrances engendrées. Ensuite, c’est aussi une sensibilité politique transmise par ma famille, des deux côtés, qui me rend particulièrement attentif aux phénomènes d’exclusion, aux injustices et aux inégalités sociales. J’avais créé un petit groupe de réflexion quand j’étais en Terminale au lycée Masséna de Nice et le premier thème retenu fut la prison, thème qui condense sans doute un peu tout cela. Mais au cours de ma formation universitaire, à Aix puis à Paris, je me suis toujours intéressé à beaucoup de sujets très différents ainsi du reste qu’à plusieurs disciplines, en particulier la sociologie, l’histoire générale, la science politique, la philosophie des sciences (ou l’épistémologie) et la psychologie sociale expérimentale. Finalement, c’est aussi le hasard des rencontres qui m’a conduit à la sociologie de la délinquance. Quand j’étais doctorant à l’EHESS de Paris, en histoire des sciences, j’ai organisé mon premier colloque sur l’histoire des sciences criminelles et j’y ai invité aussi des sociologues du CESDIP, principal laboratoire de recherche français sur ces questions, créé par Philippe Robert et dirigé ensuite par René Lévy. Et ce sont eux qui m’ont débauché. Quand j’ai réussi le concours d’entrée au CNRS en 1997, je suis allé directement travailler dans ce laboratoire où j’ai énormément appris et où j’ai achevé de devenir sociologue. Ensuite, c’est le principe de spécialisation de la recherche qui vous pousse à être un expert d’un domaine particulier. Et une fois qu’on a pris ce pli, il est difficile de s’en détacher car vous êtes rapidement catalogué et par ailleurs constamment sollicité pour ce qui vous a déjà fait connaître.
Quel regard portez-vous sur la criminalité en Corse ?
Je vais être prudent dans mes réponses sur la Corse, non par crainte de quoi que ce soit, mais parce que, même si j’y viens régulièrement depuis un demi-siècle, et même si j’y avais dirigé une première recherche avec mon collègue André Fazi en 2013-2014 (pour le compte de la CTC de l’époque), je commence à peine à y vivre et y travailler à plein temps. Donc je dirais que je débute en sociologie corse. Je viens cependant de boucler une première petite recherche de trois mois intensifs sur la délinquance de la vie quotidienne dans la région bastiaise. Et ce qui me frappe, c’est le décalage entre l’imaginaire de la violence en Corse et la réalité particulièrement paisible et sécure de la vie quotidienne. J’avais déjà repéré ce décalage à Marseille, où j’ai dirigé plusieurs recherches ces dernières années. L’imaginaire y est accaparé par le narco-banditisme et les règlements de compte meurtriers qu’il suscite. Et du coup, vu de Paris, on imagine que toute la société locale est violente au quotidien, ce qui n’est pas le cas. En Corse, j’ai retrouvé ce problème mais d’une façon plus complexe. Il me semble que penser la délinquance en Corse suppose de s’affranchir d’un double imaginaire.
D’un côté, il existe ce que j’appellerai la « légende noire » de la Corse et des Corses, qui se déploie de longue date dans l’imaginaire continental. C’est l’idée d’un peuple sauvage, querelleur, violent voire sanguinaire, hostile par principe à l’Etat et à ses institutions, qui protègerait les activités criminelles de ses bandits par une omertà généralisée. Cet imaginaire est ancien, il a été figé jusque dans la caricature par la pseudo-ethnographie des lettrés continentaux du XIXe siècle en mal d’exotisme (on se souvient que Mérimée n’avait jamais mis les pieds en Corse lorsqu’il a rédigé Mateo Falcone). Dans l’histoire récente, le demi-siècle écoulé depuis l’affaire de la cave viticole d’Aleria a bien entendu réactivé fortement cet imaginaire. Encore aujourd’hui, ceci irrigue en permanence les représentations des agents de l’Etat, comme je l’ai constaté dans la plupart des entretiens que j’ai menés à Bastia, entretiens que je commençais (ou terminais) souvent en demandant aux personnes quelles avaient été les réactions de leur entourage professionnel quand elles ont annoncé qu’elles étaient affectées en Corse. Les réponses usent souvent de l’humour pour exprimer clairement le fond de cet imaginaire. Cela donne par exemple ce genre de réponse : « Ah bon, tu pars en Corse ? Tu as demandé un gilet pare-balle ? ». Mais il faut reconnaître que cet imaginaire est également entretenu par les Corses eux-mêmes, non seulement dans certains milieux politiques où l’on a longtemps justifié le recours à la violence, mais aussi dans la culture de façon générale (la littérature, le cinéma, etc.). Cette légende noire permet en effet d’héroïser certains acteurs (dans un imaginaire fondamentalement masculin, pour ne pas dire machiste), de valoriser certains traits de leur personnalité ou de leur action tels que le courage face au danger, la force physique et la force de caractère, le patriotisme allant jusqu’au sacrifice de soi.
D’un autre côté, il faut également tenir à distance un autre mythe produit non seulement par l’histoire mais aussi par la géographie, que j’appellerais cette fois la « légende dorée » de la Corse et des Corses. Il s’agit ici de se représenter cette société comme une communauté homogène, harmonieuse dans ses mécanismes internes d’autorégulation, que viendraient régulièrement perturber les personnes, les institutions et les idées venues « de l’extérieur », c’est-à-dire pour l’essentiel « du continent ». J’ai également rencontré cet imaginaire dans mon enquête, non plus ici chez des continentaux venus travailler en Corse mais chez des insulaires, y compris politiquement hostiles au nationalisme, ainsi que chez des émigrés d’origine continentale devenus des Corses d’adoption. Il structure des discours consistant à expliquer les difficultés sociales et certains phénomènes de délinquance par l’immigration des personnes ou l’influence des idées « venues de l’extérieur ». Dans cet imaginaire, tous ces problèmes sont « importés du continent », notamment par des personnes croyant que « la misère serait moins pénible au soleil », comme chantait Aznavour. Comme s’il existait quelque chose qui s’appellerait « la Corse profonde » ou encore « la Corse authentique », sorte de paradis paisible et harmonieux, qui ne connaitrait ni violence intrafamiliale, ni violence conjugale, ni maltraitance des enfants, ni échec scolaire, ni processus d’exclusion, de marginalisation ou d’exploitation des uns par les autres.
Je pense que ces deux imaginaires, hérités du passé et qui fonctionnent en miroir, doivent être explicités et tenus à distance si l’on prétend étudier la Corse de façon scientifique, c’est-à-dire de façon non seulement neutre et désintéressée, mais aussi capable de lire le présent pour ce qu’il est voire à l’aune du futur qu’il dessine, et non pas toujours en fonction du passé qu’il rappelle, ou semble rappeler.
On parle désormais beaucoup de mafia en Corse. Comment voyez-vous cette question ? Les mobilisations anti-mafia vous paraissent-elles révélatrices d’une évolution de la criminalité ?
Je suis toujours un peu gêné par l’emploi extensif du terme de « mafia » qui réfère à mes yeux à une forme de criminalité organisée très ancienne et très enracinée dans la société, telles que certaines régions du Sud de l’Italie ont pu la connaître à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, en lien avec le long et conflictuel processus d’unification et d’affirmation de l’Etat italien. Une mafia comme la Cosa nostra sicilienne n’était pas seulement une bande de malfrats rackettant des commerçants et truquant certains marchés publics. C’était aussi une organisation sociale et politique cherchant à contrôler durablement des secteurs entiers des économies légale et illégale, à s’affilier une partie de la population, à recruter ou corrompre les élus et les fonctionnaires locaux, et n’hésitant pas à engager la guerre contre l’Etat en assassinant ses fonctionnaires et ses militaires par centaines comme à l’époque des Corleonesi.
A partir de là, peut-on utiliser le même mot pour décrire le banditisme corse contemporain ? Quels liens exacts y a-t-il eu historiquement entre certains militants nationalistes clandestins, certains élus et les groupes criminels de braqueurs de banques ou de trafiquants de drogues ? Simples liens familiaux ou amicaux et simples échanges de services ? Ou bien allégeances assumées voire actions illégales concertées ? Par ailleurs, ces groupes criminels ont-ils conçu des systèmes d’entente et d’organisation pour le véritable contrôle de secteurs de l’économie ? Ou bien a-t-on plus simplement affaire à quelques familles et quelques bandes de délinquants qui cherchent avant tout à s’enrichir à titre individuel, à blanchir leur argent, et qui s’entretuent surtout entre elles dans la concurrence pour cet enrichissement privé ? Je n’en sais rien. Les principales sources constamment citées sur le sujet sont des compilations de journalistes et des déclarations de hauts fonctionnaires (préfets, procureurs de la République, etcaetera) dans des rapports parlementaires. Il faudrait faire une recherche systématique qui n’a jamais été réalisée et qui supposerait que la police et la justice ouvrent leurs archives récentes aux chercheurs. La question que ces derniers poseraient ne serait évidemment pas celle des personnes (l’anonymat est toujours strictement respecté dans les recherches en sciences sociales), mais celle de la description des activités criminelles et des types de liens entre les personnes impliquées.
En 2011, vous avez créé l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux en PACA. Pouvez-vous nous expliquer les objectifs et le fonctionnement de cet outil ? Quel bilan en tirez-vous ? Et une structure de ce type pourrait-elle être utile en Corse ?
J’avais effectivement créé cet observatoire à mon retour en Provence, après une vingtaine d’années passées en région parisienne. Et il a fonctionné en continu pendant 7 ans. Juridiquement, il s’agissait d’un programme de recherche autonome de l’université d’Aix-Marseille, faisant par ailleurs l’objet d’une convention de partenariat avec le CNRS et surtout le Conseil régional PACA. Le CNRS me mettait à disposition comme directeur du programme, l’université fournissait les bureaux et leur équipement informatique ainsi que les services communs pour la gestion et l’administration, la Région donnait le budget de fonctionnement permettant notamment l’embauche de deux ingénieurs de recherche statisticiens. L’ambition était triple : 1) fédérer les différents chercheurs qui s’intéressaient à ces thématiques mais n’avaient aucune forme d’organisation collective, 2) travailler avec les collectivités territoriales dans un échange de services bien compris (expertises et évaluations quasi gratuites en échange d’un accès privilégié aux terrains et aux données), 3) dynamiser les liens entre la recherche scientifique et l’enseignement supérieur. Côté bilan, comme je le détaille dans le livre collectif publié à la fin, je dirais que les points 1 et 3 ont été des réussites assez formidables, mais que le point 2 a été un échec relatif. La dynamique intellectuelle a été belle, avec de nombreuses recherches, des mémoires de Master et des thèses, des colloques et des journées d’études qui ont connu un grand succès et des dizaines de publications électroniques ou papier. En revanche, si le travail avec les techniciens des collectivités a été souvent fructueux, participant à leur formation continue en quelque sorte, le rapport avec les élus est d’une autre nature et ne m’a pas rendu très optimiste. Derrière les satisfactions du moment sur la restitution des recherches, notre influence sur les politiques publiques a été à peu près nulle. Les questions de sécurité étant hyper-politisées et médiatisées sur le continent, une fois le moment électoral arrivé les élus n’ont généralement tenu aucun compte des conclusions de nos travaux, privilégiant les logiques proprement politico-électorales. Là où nous pouvions par exemple préconiser de lutter avant tout contre l’échec scolaire ou de changer la façon de travailler de la police municipale pour en faire une vraie police de proximité, les élus locaux ont souvent préféré installer des caméras de vidéosurveillance et armer ces agents municipaux.
Mais pour vous répondre de façon totalement sincère et transparente, je ne crois pas nécessaire ni même utile d’essayer de développer un programme de recherche équivalent ici. A côté de la recherche ponctuelle déjà évoquée sur la criminalité organisée (qui, elle, serait vraiment nécessaire pour savoir une fois pour toutes à quoi nous avons affaire), je dirais qu’il n’y a pas suffisamment de matière ni de ressource humaine pour nourrir un tel projet collectif. La Corse est petite et surtout peu peuplée, elle ne compte que deux véritables aires urbaines. Nous ne sommes pas du tout sur la même échelle que la région PACA (désormais région Sud) qui compte 5 millions d’habitants et une vingtaine de villes de plus de 40 000 habitants. En réalité, ce qui me paraîtrait nécessaire ici, ce serait de monter un observatoire sociologique généraliste, un observatoire de la société corse. Beaucoup de recherches en sciences sociales produites à l’université de Corse concernent la Corse du passé, son histoire, sa langue, ses traditions et productions culturelles. C’est évidemment tout à fait respectable et important, y compris dans la façon dont cela continue à influencer le présent. Mais ce n’est pas suffisant. La Corse connaît depuis une vingtaine d’années des évolutions économiques, démographiques et sociales de grande ampleur, dont les conséquences mériteraient d’être étudiées en détail. A quoi pensent les jeunes en Corse de nos jours ? Comment grandissent-ils ? Quels problèmes rencontrent-ils ? Quels sont leurs univers culturels ? Et leurs parents ? Comment se rencontre-t-on, se marie-t-on et souvent aussi divorce-t-on en Corse aujourd’hui ? Comment travaille-t-on ? Comment se loge-t-on ? A-t-on souvent eu des expériences de vie ou de travail sur le continent ? Qui part et qui reste en Corse dans les familles et selon les milieux sociaux ? Que consomme-t-on ? Quels sont les loisirs aux différents âges de la vie ? Quelles conceptions a-t-on de la vie et de la mort ? De quoi est-on malade et comment se soigne-t-on ? Comment participe-t-on à la vie publique ? Quelles sont les formes d’engagement de nos jours ? Comment la richesse est-elle héritée, produite, reproduite, partagée ? Comment évoluent les inégalités sociales et territoriales ? Etcaetera. C’est tout un programme qui pourrait être décliné au fil des ans, en partenariat aussi avec d’autres organismes publics comme l’INSEE, et en pratiquant autant que possible la comparaison avec d’autres territoires afin, en fin de compte, de pouvoir aussi déterminer ce qu’il y a de plus ou moins spécifique à cette société corse en comparaison avec d’autres. Bref, ce sont juste quelques idées pour faire œuvre utile. On verra bien si cela fait réagir vos lecteurs.