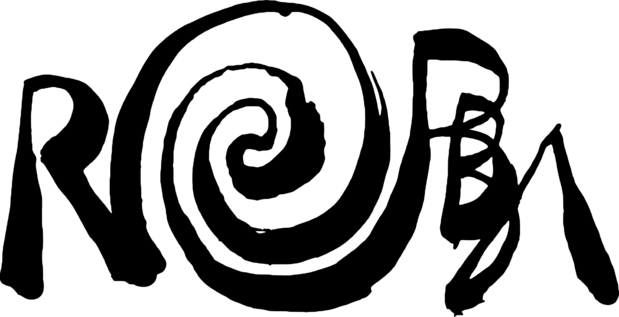Au temps de l’anthropocène et de ses conséquences (perte de biodiversité, risque incendie, appauvrissement des sols...), la réinvention d’un élevage pastoral gagnant en maitrise se révèle la seule activité humaine capable d’agir et de préserver significativement nos espaces et la capacité nourricière de notre île. C’est aussi l’activité la plus à même de changer nos regards sur les « autres vivants » qui peuplent nos milieux de vie.
Les formes communautaires de l’élevage pastoral
Persu l’allevu...persa a Corsica ! Une formule au potentiel de vérité croissant. L’élevage en Corse est une constante historique. La chair de cette île est le produit des activités humaines et particulièrement de l’élevage. La formation de ses sols, sa flore et sa faune [1], dont deux représentants emblématiques a muvra et l’altore, sont le fruit des premières domestications, il y a 8000 ans.
Nous devons notre île à la coévolution plurimillénaire des hommes et de leurs milieux de vie, aux interactions issues de l’agriculture et des activités d’élevage. Ce fait est masqué par une historiographie qui a réduit l’existence de la Corse à la société des hommes. S’agissant d’une société agrosylvopastorale, l’oubli nous prive de comprendre une part importante de notre histoire matérielle. Sans l’élevage, cette île-mosaïque complexe ne serait certainement pas faite des mêmes paysages. Sans l’élevage, la biodiversité domestique et culturelle ne serait pas ce qu’elle est et nous ne serions pas vraiment ce que nous sommes. Il appartient aux historiens et aux politiques de nous aider à réinsérer nos existences dans toute l’épaisseur vivante de cette histoire aux cotés des animaux.
Les composantes essentielles de l’élevage corse
Une des raisons de la forte disqualification de l’élevage corse facilement d’observable au fil de l’histoire, tient à son caractère pastoral que l’on peut saisir à partir de quelques-unes de ses composantes. En premier lieu, l’utilisation de races locales façonnées dans le temps long par l’activité des éleveurs eux-mêmes, une endogénéité qui s’explique par la spécificité des milieux et les besoins de communautés insulaires. L’exact opposé des races standardisées (répondant à un standard de race), sélectionnées en conditions contrôlées et orientées pour satisfaire l’agro-industrie, c’est-à-dire déliées des ressources d’un milieu spécifique et situé.
Il est nécessaire de préciser ici que la Corse est une des très rares régions d’Europe où les races locales sont présentes en large majorité pour toutes les espèces domestiques majeures (vaches, porcs, brebis, chèvres, chevaux...). Viennent ensuite les ressources alimentaires des troupeaux prélevées dans notre ile, soit par l’animal lui-même soit apportées par l’éleveur (u porcu mannarinu ou a sgiocca). Le caractère pastoral se base ici sur le prélèvement de ressources spontanées, d’aucuns diraient naturelles, ce qui a peu de sens du fait de la forte intervention humaine dans la constitution des milieux concernés, qu’ils s’agissent des prairies, des terres cultivées, des maquis et même des forêts.
La troisième composante est le caractère circulant de l’élevage corse. Encore aujourd’hui, l’élevage en stabulation demeure largement minoritaire et ne concerne que quelques élevages utilisant des races standardisées. Mais la composante essentielle est certainement les savoirs mis en œuvre dans les élevages pastoraux, leur diffusion et leur transmission par la langue Corse qui doit presque tout au monde paysan et à l’agriculture.
Conduire des troupeaux circulants, souvent transhumants, en milieu ouvert, avec un minimum d’équipement et produire des aliments pour nourrir toute l’année des communautés particulièrement isolées suppose des compétences souvent cachées parce qu’intimement associées aux autres composantes vivantes du système (animaux, milieux et communautés). Selon le logiciel dominant, cette « composante relationnelle » du système pastoral a longtemps été ignorée faisant de l’élevage corse l’activité de l’ignorance.
Errances
Avec la globalisation des échanges au début du XXe siècle, les systèmes de production villageois se sont littéralement désintégrés. Ce qui faisait la cohérence des communautés agrosylvopastorales s’est décomposée laissant l’élevage pastoral occuper seul l’espace libéré. Les autres manières d’élever les animaux, dans la proximité des villages, n’ont pas survécu à la forte déprise enclenchée au début de XXe siècle.
C’est d’abord la céréaliculture qui disparait au début du 20ème siècle et dans l’entre-deux-guerres, puis l’arboriculture et le maraichage domestique. En laissant toute la place à l’élevage, le cycle vertueux entre les productions végétales et les activités d’élevage, entre cultures et fumures s’est rompu.
Il est possible de faire débuter ce qu’il convient d’appeler l’errance de l’élevage corse à cette rupture entre les activités de production végétale et la conduite animale. Par errance, il faut comprendre ici son premier sens, la circulation des animaux peu à peu libérée de la surveillance humaine. Une liberté animale qu’il faut de suite corriger car en l‘espèce l’unité de gestion, dans le cas de l’élevage Corse, n’est pas l’individu mais le troupeau.
La correction est importante car elle nous préserve d’une philosophie urbaine qui, en regroupant l’ensemble des animaux domestiques, d’élevage et de compagnie, postule de fait l’identité des conditions du bien-être animal. Il n’en demeure pas moins que la perte de maitrise de la circulation des troupeaux signe les prémisses de l’instabilité de l’ancien système agrosylvopastoral.
L’errance est la manifestation de la perte de cohérence d’activités jusqu’ici intimement reliées, associant les savoirs du cultivateur à ceux de l’éleveur (savoirs paysans), les aptitudes d’animaux domestiqués (lait, déplacement...) aux capacités des milieux (choix des ressources, chargement...). La libération des troupeaux s’est accompagnée d’une diversification des espaces pâturés (prairies, friches, maquis, forêts, estives, espace périvillageoises, châtaigneraies ...). La fameuse "divagation" animale, marqueur peu enviable de l’élevage corse, n’est que la manifestation d’une activité faite d’errances qui a perdu sa place dans l’espace et la règlementation faute d’une maitrise suffisante, d'une qualification sociale ajustée et d'un statut administratif adapté.
Autrefois contraint, le prélèvement de la ressource pastorale s’est étendu jusqu’à se généraliser à une très grande partie de l’espace rural. Dans la seconde partie du siècle dernier, l’emprise de l’élevage s’est donc faite au fur et à mesure de la déprise des autres activités rurales. Ce faisant, la disparition progressive de la transhumance et son corolaire, la sédentarité des élevages, a réduit le territoire alimentaire des élevages pastoraux d’autant plus fortement que la littoralisation des autres activités agricoles et non agricoles, associée à l’urbanisation, les privaient des anciennes ressources fourragères de plaine.
En position quasi hégémonique dans l’après-guerre à la faveur des débouchés de Roquefort, voilà le pastoralisme aujourd’hui dépossédé de la majeure partie des prairies littorales. Celles-là même qui apportaient la complémentation fourragère aux espaces de parcours (sous formes pâturées, de foins ou de céréales).
Dépendances
C’est peut-être sur le registre des savoirs que la mise en dépendance est la plus forte en raison même de leur invisibilité. Les savoirs pastoraux des élevages corses, comme de partout dans le monde, ont longtemps été ignorés puis disqualifiés. Il a fallu une lente prise de conscience soutenue par plusieurs travaux de recherche pour que les connaissances du pastoralisme soient enfin considérées, sans être toutefois véritablement reconnues c'est à dire codifiées, formalisées et enseignées.
En les disqualifiant, c’est leur pouvoir de mise en relation et de production de sens qui fragilise chacune des autres composantes, les espèces, les espaces, les métiers jusqu’au métier d' éleveur lui-même. C’est ainsi que le couple chèvres et maquis demeure encore aujourd’hui mal pensé par l’administration, les institutions et quelquefois les organisations professionnelles. Le soft power du modèle dominant et de ses référentiels, dans le domaine de la reproduction, de l’alimentation, de la santé, déclinés « espèces par espèces » (chèvre, bovin, brebis, caprin...) n’est pas sans conséquence sur la vision et la définition du rôle du pastoralisme.
Ne disposant pas de modèles dédiés stabilisés les promoteurs du maintien de l’élevage pastoral en viennent à céder au méthodes du modèle dominant. Et la priorité est d’engager séparément les diverses composantes de l’élevage corse dans la voie de la productivité. C’est-à-dire sans vision systémique, en augmentant le potentiel laitier des races locales, la production fourragère des zones de plaine et en formant les néo-installés à la conduite d’animaux à l’herbe selon les canons de l’élevage de la montagne humide.
La dégradation des liens entre les élevages corses et leurs milieux-ressources (prairies, parcours, maquis, chênaies, châtaigneraies, forets) n’est pas sans poser de sérieux problèmes d’alimentation des troupeaux. Les éleveurs sont contraints d’acheter de façon continu des aliments le plus souvent à l’extérieur, pour maintenir le niveau laitier des troupeaux. La production fourragère cultivée dans l’île ne fournit pas, loin sans faut, les volumes nécessaires à la couverture des besoins de l'élevage corse.
Ces cinq dernières années, la complémentation extérieure en foin ou en concentrés n’a cessé de croitre jusqu’à devenir la principale charge financière et quelquefois la première fraction de la ration alimentaire. Les désordres liés aux incertitudes climatiques et aux renchérissement du prix des céréales conduisent aujourd’hui à une crise sans précédent qui remet en cause l’existence économique de l’activité dans l’île.
La bonne réponse aux errances de l’élevage en Corse passe sans doute par la construction et l’expérimentation d’une pluralité de modèles susceptibles de répondre à la diversité des milieux de production et plus généralement aux mutations de la société corse ainsi qu'au nouveau régime climatique. Le changement climatique constitue à lui seul une raison d’écarter l’idée d’une réplication de l’ancien pastoralisme mais il nous enjoint à repenser les liens entre ses composantes pour réinventer l'élevage pastoral en Corse.
Car la preuve de leur résilience est établie par le simple fait que ces élevages sont toujours là pour faire vivre des familles, parce que la manière d’élever en Corse démontre qu’il est possible de produire avec les forces du vivant sans artificialisation des ressources des milieux. C’est peut-être à partir de l’analyse des crises que se révèlent les points d’appui et les facteurs de résilience.
Nous devons notre île à la coévolution plurimillénaire des hommes et de leurs milieux de vie, aux interactions issues de l’agriculture et des activités d’élevage. Ce fait est masqué par une historiographie qui a réduit l’existence de la Corse à la société des hommes. S’agissant d’une société agrosylvopastorale, l’oubli nous prive de comprendre une part importante de notre histoire matérielle. Sans l’élevage, cette île-mosaïque complexe ne serait certainement pas faite des mêmes paysages. Sans l’élevage, la biodiversité domestique et culturelle ne serait pas ce qu’elle est et nous ne serions pas vraiment ce que nous sommes. Il appartient aux historiens et aux politiques de nous aider à réinsérer nos existences dans toute l’épaisseur vivante de cette histoire aux cotés des animaux.
Les composantes essentielles de l’élevage corse
Une des raisons de la forte disqualification de l’élevage corse facilement d’observable au fil de l’histoire, tient à son caractère pastoral que l’on peut saisir à partir de quelques-unes de ses composantes. En premier lieu, l’utilisation de races locales façonnées dans le temps long par l’activité des éleveurs eux-mêmes, une endogénéité qui s’explique par la spécificité des milieux et les besoins de communautés insulaires. L’exact opposé des races standardisées (répondant à un standard de race), sélectionnées en conditions contrôlées et orientées pour satisfaire l’agro-industrie, c’est-à-dire déliées des ressources d’un milieu spécifique et situé.
Il est nécessaire de préciser ici que la Corse est une des très rares régions d’Europe où les races locales sont présentes en large majorité pour toutes les espèces domestiques majeures (vaches, porcs, brebis, chèvres, chevaux...). Viennent ensuite les ressources alimentaires des troupeaux prélevées dans notre ile, soit par l’animal lui-même soit apportées par l’éleveur (u porcu mannarinu ou a sgiocca). Le caractère pastoral se base ici sur le prélèvement de ressources spontanées, d’aucuns diraient naturelles, ce qui a peu de sens du fait de la forte intervention humaine dans la constitution des milieux concernés, qu’ils s’agissent des prairies, des terres cultivées, des maquis et même des forêts.
La troisième composante est le caractère circulant de l’élevage corse. Encore aujourd’hui, l’élevage en stabulation demeure largement minoritaire et ne concerne que quelques élevages utilisant des races standardisées. Mais la composante essentielle est certainement les savoirs mis en œuvre dans les élevages pastoraux, leur diffusion et leur transmission par la langue Corse qui doit presque tout au monde paysan et à l’agriculture.
Conduire des troupeaux circulants, souvent transhumants, en milieu ouvert, avec un minimum d’équipement et produire des aliments pour nourrir toute l’année des communautés particulièrement isolées suppose des compétences souvent cachées parce qu’intimement associées aux autres composantes vivantes du système (animaux, milieux et communautés). Selon le logiciel dominant, cette « composante relationnelle » du système pastoral a longtemps été ignorée faisant de l’élevage corse l’activité de l’ignorance.
Errances
Avec la globalisation des échanges au début du XXe siècle, les systèmes de production villageois se sont littéralement désintégrés. Ce qui faisait la cohérence des communautés agrosylvopastorales s’est décomposée laissant l’élevage pastoral occuper seul l’espace libéré. Les autres manières d’élever les animaux, dans la proximité des villages, n’ont pas survécu à la forte déprise enclenchée au début de XXe siècle.
C’est d’abord la céréaliculture qui disparait au début du 20ème siècle et dans l’entre-deux-guerres, puis l’arboriculture et le maraichage domestique. En laissant toute la place à l’élevage, le cycle vertueux entre les productions végétales et les activités d’élevage, entre cultures et fumures s’est rompu.
Il est possible de faire débuter ce qu’il convient d’appeler l’errance de l’élevage corse à cette rupture entre les activités de production végétale et la conduite animale. Par errance, il faut comprendre ici son premier sens, la circulation des animaux peu à peu libérée de la surveillance humaine. Une liberté animale qu’il faut de suite corriger car en l‘espèce l’unité de gestion, dans le cas de l’élevage Corse, n’est pas l’individu mais le troupeau.
La correction est importante car elle nous préserve d’une philosophie urbaine qui, en regroupant l’ensemble des animaux domestiques, d’élevage et de compagnie, postule de fait l’identité des conditions du bien-être animal. Il n’en demeure pas moins que la perte de maitrise de la circulation des troupeaux signe les prémisses de l’instabilité de l’ancien système agrosylvopastoral.
L’errance est la manifestation de la perte de cohérence d’activités jusqu’ici intimement reliées, associant les savoirs du cultivateur à ceux de l’éleveur (savoirs paysans), les aptitudes d’animaux domestiqués (lait, déplacement...) aux capacités des milieux (choix des ressources, chargement...). La libération des troupeaux s’est accompagnée d’une diversification des espaces pâturés (prairies, friches, maquis, forêts, estives, espace périvillageoises, châtaigneraies ...). La fameuse "divagation" animale, marqueur peu enviable de l’élevage corse, n’est que la manifestation d’une activité faite d’errances qui a perdu sa place dans l’espace et la règlementation faute d’une maitrise suffisante, d'une qualification sociale ajustée et d'un statut administratif adapté.
Autrefois contraint, le prélèvement de la ressource pastorale s’est étendu jusqu’à se généraliser à une très grande partie de l’espace rural. Dans la seconde partie du siècle dernier, l’emprise de l’élevage s’est donc faite au fur et à mesure de la déprise des autres activités rurales. Ce faisant, la disparition progressive de la transhumance et son corolaire, la sédentarité des élevages, a réduit le territoire alimentaire des élevages pastoraux d’autant plus fortement que la littoralisation des autres activités agricoles et non agricoles, associée à l’urbanisation, les privaient des anciennes ressources fourragères de plaine.
En position quasi hégémonique dans l’après-guerre à la faveur des débouchés de Roquefort, voilà le pastoralisme aujourd’hui dépossédé de la majeure partie des prairies littorales. Celles-là même qui apportaient la complémentation fourragère aux espaces de parcours (sous formes pâturées, de foins ou de céréales).
Dépendances
C’est peut-être sur le registre des savoirs que la mise en dépendance est la plus forte en raison même de leur invisibilité. Les savoirs pastoraux des élevages corses, comme de partout dans le monde, ont longtemps été ignorés puis disqualifiés. Il a fallu une lente prise de conscience soutenue par plusieurs travaux de recherche pour que les connaissances du pastoralisme soient enfin considérées, sans être toutefois véritablement reconnues c'est à dire codifiées, formalisées et enseignées.
En les disqualifiant, c’est leur pouvoir de mise en relation et de production de sens qui fragilise chacune des autres composantes, les espèces, les espaces, les métiers jusqu’au métier d' éleveur lui-même. C’est ainsi que le couple chèvres et maquis demeure encore aujourd’hui mal pensé par l’administration, les institutions et quelquefois les organisations professionnelles. Le soft power du modèle dominant et de ses référentiels, dans le domaine de la reproduction, de l’alimentation, de la santé, déclinés « espèces par espèces » (chèvre, bovin, brebis, caprin...) n’est pas sans conséquence sur la vision et la définition du rôle du pastoralisme.
Ne disposant pas de modèles dédiés stabilisés les promoteurs du maintien de l’élevage pastoral en viennent à céder au méthodes du modèle dominant. Et la priorité est d’engager séparément les diverses composantes de l’élevage corse dans la voie de la productivité. C’est-à-dire sans vision systémique, en augmentant le potentiel laitier des races locales, la production fourragère des zones de plaine et en formant les néo-installés à la conduite d’animaux à l’herbe selon les canons de l’élevage de la montagne humide.
La dégradation des liens entre les élevages corses et leurs milieux-ressources (prairies, parcours, maquis, chênaies, châtaigneraies, forets) n’est pas sans poser de sérieux problèmes d’alimentation des troupeaux. Les éleveurs sont contraints d’acheter de façon continu des aliments le plus souvent à l’extérieur, pour maintenir le niveau laitier des troupeaux. La production fourragère cultivée dans l’île ne fournit pas, loin sans faut, les volumes nécessaires à la couverture des besoins de l'élevage corse.
Ces cinq dernières années, la complémentation extérieure en foin ou en concentrés n’a cessé de croitre jusqu’à devenir la principale charge financière et quelquefois la première fraction de la ration alimentaire. Les désordres liés aux incertitudes climatiques et aux renchérissement du prix des céréales conduisent aujourd’hui à une crise sans précédent qui remet en cause l’existence économique de l’activité dans l’île.
La bonne réponse aux errances de l’élevage en Corse passe sans doute par la construction et l’expérimentation d’une pluralité de modèles susceptibles de répondre à la diversité des milieux de production et plus généralement aux mutations de la société corse ainsi qu'au nouveau régime climatique. Le changement climatique constitue à lui seul une raison d’écarter l’idée d’une réplication de l’ancien pastoralisme mais il nous enjoint à repenser les liens entre ses composantes pour réinventer l'élevage pastoral en Corse.
Car la preuve de leur résilience est établie par le simple fait que ces élevages sont toujours là pour faire vivre des familles, parce que la manière d’élever en Corse démontre qu’il est possible de produire avec les forces du vivant sans artificialisation des ressources des milieux. C’est peut-être à partir de l’analyse des crises que se révèlent les points d’appui et les facteurs de résilience.
[1] L’altore, charognard exclusif, se voit menacer du fait de la diminution des carcasses d’animaux issus de l’élevage et le mouflon emblème de l’île, est issu du marronnage des troupeaux de brebis domestiques.
Les crises de l’élevage pastoral et les transformations en cours
Des politiques publiques en échec
Il faut signaler que les difficultés et la régression de l’élevage en zone de montagne est la réalité de tous les massifs, les pyrénéens et l’arc alpin, même si la stratégie de maintien par la valorisation des produits (AOP fromagères) est parvenue à limiter la déprise. À la singularité près que l’isolement insulaire redouble l’isolement montagnard. La piste de l’incapacité des corses à organiser n’est donc pas le bon point de départ. Nous privilégions plutôt la piste de la difficulté à changer qu’ont les organisations communautaires à forte intégration environnementale.
Il demeure que l’élevage corse n’est toujours pas parvenu en ce début de siècle à se réinventer et à poser sa politique de développement et ses modèles socioéconomiques. Sans politique publique structurante efficace, les éleveurs naviguent à vue, équipés exclusivement d’une passion quelquefois assortie d’une culture technique aujourd’hui en cours de délestage.
Pourtant de nombreuses actions de développement, de projets professionnels, d’expérimentation et de recherches ont été présentés, délibérés et soutenus au plan financier et technique. Les nombreuses études réalisées n’ont pas suscité l’adhésion nécessaire et l’élaboration d’un agenda consensuel.
À titre d’exemple pas moins de cinq typologies des élevages émanant de divers organismes ont été produites, une toutes les décennies depuis presque 40 ans. Autant de documentation susceptible de fournir des éléments de tendance et donc de pilotage afin de donner un cap à l’élevage corse.
Dans Berger en Corse, Pernet et Lenclud associaient en 1977 leurs compétences d’agroéconomiste et d’ethnologue pour poser quelques hypothèses sur l’avenir de l’élevage corse. Le pronostic était franchement pessimiste, si le dépeuplement de l’intérieur se poursuit, « la survie du modèle pastoral traditionnel comme forme spécifique de relations entre l’homme et le milieu parait impossible », faute d’un renouvellement des paysans et faute « d’un modèle d’utilisation pastorale du milieu susceptible de donner les moyens d’exister à un groupe suffisamment nombreux ».
Un demi-siècle plus tard l’activité est toujours là mais elle est au plus mal. Sa forte résilience indique bien que les composantes (races locales, parcours, ressources spontanées et savoir-faire de conduite) gardent leur pertinence pour produire à faible coût et avec peu d'intrants mais sont désormais désajustées pour répondre aux nouveaux enjeux.
L’échec des politiques publiques et la faible efficience des connaissances acquises tiennent à la difficulté qu’ont les décideurs et les professionnels de décider d’un cap et de modèles de production intégrant les ressources locales. En Corse comme ailleurs, ils doivent faire face à la toute-puissance des forces de cadrage, celle des raisonnements, des enseignements, des logiques économiques qui gouvernent des politiques publiques.
Ces politiques inspirées du modèle de l’entreprise agricole et de l’exploitation sans limites de ressources agroindustrielles, facilitent de fait le recours aux intrants. Les revenus agricoles sont ainsi plombés par une forme de facilité consumériste soutenue par l’appareil de conseil et de prescription. Le postulat de l’efficience de l’initiative privée et individuelle a conforté le modèle de l’homme-filière aujourd’hui à bout de souffle. Une logique qui ne parviendra sans doute pas à rémunérer le travail des différents ateliers de production et à fixer le juste prix des productions sans une organisation collective du travail.
L’alliance attendue entre les acteurs ne s’est toujours pas produite. Ici la résilience des anciennes manières pastorales d’élever s’est traduite par un étiolement puis par une fragmentation de ce qui fait pourtant l’originalité des systèmes d’élevage corses. Car à y regarder de plus près, cette résilience est soutenue dans les faits par des financements régionaux et européens significatifs. Il faut se rendre à l’évidence, les programmes, les stratégies, les politiques de soutien n’ont pas permis d'éviter une situation extrêmement dégradée.
Le verrou du travail
Le verrou le plus tangible qui empêche la stabilisation des systèmes d’élevage à caractère pastoral est sans aucun doute le travail, sa nature, son intensité, sa pénibilité et son organisation. On en déduit que sa rationalisation peut fournir un levier efficace pour compenser l’effet des crises.
Si l’élevage pastoral requiert un important volume de travail et une grande variété des tâches, il convient d’identifier les moyens d’action pour revoir l’organisation des ateliers/postes. Le modèle de type « homme filière » où l’éleveur cumule la conduite du troupeau, la transformation et la vente des produits souvent de façon directe semble une impasse. La cohérence du système de production qui reposait sur des savoirs, un travail hautement qualifié et une forte entraide a été mis à mal par des processus connus de désaffiliation communautaire, familiale et villageoise. C’est ce système de production façonné par des siècles de vie communautaire qui met aujourd’hui en tension le travail.
En effet, modèle de « L’homme-filière » et la pratique de la vente directe (la corse est au premier rang en France) supportés par la seule force d’une ou de deux personnes (le couple est la situation la plus fréquente), a gagné en force avec la notion de "production fermière". Ce modèle souvent présenté comme l’idéal d’organisation se fait souvent aux dépens des activités d’élevage notamment de la production fourragère et la surveillance du troupeau. En tout cas, il ne semble pas généralisable sans solution d’organisation collective (matériel en commun, groupement d'employeurs, banque de travail, ateliers collectifs de transformation, fruitière d'affinage, magasin collectif, plateforme de vente ou encore dans la mixité avec le modèle de la régie productive/collectivité etc.).
Pour préserver ce qui constitue les composantes essentielles de l’élevage corse et relâcher la tension sur le travail, d’autres formes d’organisation, communautaire ou sociétaire sont donc possibles. À ce titre, les échecs de la coopération dans le secteur de l’élevage des années 1980, notamment celui des coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA), ne doivent pas prononcer la fin de l’histoire de la coopération en Corse, il est temps en effet de sortir du traumatisme.
Le désarroi actuel lié en partie à la faible rémunération du travail nourrit un manque de confiance et un sentiment d'injustice voire une forme de ressentiment au regard d'autres métiers, lequel induit à son tour une perte d’attractivité de l'élevage et une diminution des installations. Sans aucun doute l’organisation du travail, finalement peu traitée par les organisations professionnelles, constitue un moyen de reconstituer la confiance nécessaire dans la production fermière. L’écologisation des pratiques d’élevage, notamment le recours à la "prairie naturelle" ou de fauche, au parcours et aux races locales, la vente directe de produits fermiers, associée au programme de l'agroécologie, se fait sans innovation collective, sans de nouvelles formes d’organisation de la production, faisant courir le risque d’ajouter de nouvelles taches à une calendrier de travail déjà très chargé.
Le foncier, une variable masquante
La disponibilité foncière est présentée comme la pierre angulaire de la nouvelle édification de l’élevage. Au-delà de l’évidence (il faut des terres pour produire), la question mérite une réflexion qui doit dépasser la seule solution de la propriété foncière pour affronter celle de l’organisation des usages.
Une politique foncière ne peut se résumer à des transferts de propriété pas plus qu’elle ne peut prendre pour référence le seul statut d’agriculteur. S’il faut sanctuariser quelque chose, ce sont les usages agricoles plutôt que la propriété foncière des agriculteurs. Aucun propriétaire ne se laissera convaincre de céder une terre agricole à un agriculteur si celui-ci n’offre aucune garantie particulière pour le maintien d'un usage agricole dans la durée.
Plusieurs outils réglementaires existent (AFP, ASL, GFA, etc.), mais la réservation légale de terres par zonage agricole de longue durée est le seul moyen d’éteindre tout intention spéculative d’où qu’elle vienne. Le désalignement des politiques publiques en faveur de l’agriculture, notamment le PADDUC et les documents d’urbanisme, contribuent à entretenir un flou sur les allocations des terres à l’élevage. Sans de nouveaux dispositifs de réservation foncière et de zonage, le fameux « blocage foncier » présente tous les traits d’une variable masquante laissant sans solution d’autres verrous à l’installation tout aussi sérieux.
Innover dans l’élevage pastoral
Nous avons vu l’importance du travail consacré à l’usage des milieux-ressources, si important pour le pilotage des systèmes pastoraux. Dans ce domaine, l’innovation est rendue difficile parce qu’elle ne s’inscrit pas dans le cortège technique du modèle dominant.
Si l’on recense les innovations vraiment structurantes de ces 50 dernières années, elles sont peu nombreuses. On retiendra bien sûr la clôture comme moyen de contenir la circulation animale de troupeaux devenus sédentaires, l’amélioration pastorale par le girobroyage, la généralisation du quai de traite (autant que la machine à traire) et enfin l’équipement des fromageries (il faut avoir en mémoire les fortes divergences de vue sur la conception des ateliers entre les attentes des berger-fromager et celles de l’administration sanitaire). L'artificialisation des techniques de production notamment par l'usage des engrais et des aliments, relève plus de l'élargissement de l'approvisionnement que d'une innovation sociotechnique tournée vers l'autonomie des élevages. Il faut noter enfin l'utilisation de plus en plus fréquente des GPS comme dispositif d'appui à la surveillance des troupeaux par l'éleveur sur le territoire pastoral. Une innovation durable et d'importance susceptible d'étendre le pâturage à une plus grande partie du territoire.
Peu d’innovations concernent l’organisation du travail, la rationalisation des procédés, sa pénibilité, son ergonomie et au final la qualification des métiers. Les efforts de l'ARACT doivent être ici soulignés.
Quelle valorisation des produits ?
Du côté des produits, la valorisation de l’origine a connu un succès indéniable. Elle a permis le maintien des savoirs de transformation et la bonne réputation des produits. Mais la dynamique de valorisation n’a pas permis de soutenir, et aujourd’hui de prévenir, la dégradation des composantes pastorales de l’élevage corse par ses productions.
La difficulté d'intégrer pleinement, et de façon rationnelle, les milieux-ressources (parcours, châtaigneraie, prairies, maquis, forêts), les pratiques liées à leurs usages et surtout les conditions de leur renouvellement, aux cahiers des charges des produits souligne la difficulté de concevoir l'innovation "avec le vivant". A ce titre, les atermoiements que suscite la qualification du parcours en ressource pastorale démontre la difficulté de l'envisager comme une "ressource domestiquée" par l'éleveur et les animaux et ce faisant de la sortir du registre naturel dans lequel il es confiné. Un statut préjudiciable à la valorisation des laits et des fromages (certification AOP). et à la qualification des savoir-faire associés à l'élevage pastoral corse.
Enfin, les difficultés rencontrés pour bâtir la variété des fromages à partir des types territoriaux (sartinesu, bastelicacciu, venachese, niulincu et calinzanincu) conduit une partie des éleveurs à concevoir aujourd'hui la valorisation autour des laits crus, appréhendés, à raison, comme la meilleure expression des conditions d’élevage. À vrai dire rien ne s’oppose, bien au contraire, à penser une qualification des types territoriaux bâtie sur les bases d’un fromage pastoral (usage des parcours, limitation des concentrés, races locales).
Transformations et nouveaux conflits
Aux anciennes transformations du système agraire de la Corse, liées au retrait des activités agricoles, s’ajoutent aujourd’hui les conséquences de nouvelles occupation des sols liées à la croissance urbaine. Les changements en cours font de l’ancien pastoralisme une activité d’élevage multi-espèces et multiforme.
Dans les zones les moins peuplées, les moins attractives au regard de l’essor résidentiel et touristique, on le trouve de partout, souvent en lambeaux de ce qu’il était autrefois. La diversification des espaces pâturés souvent traversés par des animaux errants provoque des tensions avec d’autres usages. Ces tensions alimentent des conflits entre ruraux. Elles exposent les élevages à des risques sanitaires notamment des zoonoses. Elles nuisent à l’image du métier et à son attractivité...
Les conflits sont d’autant plus forts que, par défaut de transmission, les manières d’élever sont diverses au point où il devient difficile d’en repérer les formes traditionnelles. À cela s’ajoute une recomposition profonde de l’identité de berger et des savoir-faire qui la définissaient. L’entrée dans le métier pour des jeunes néoruraux en attente de nouvelles aspirations élargit le vivier aux villes corses et continentales de même que semble poindre une féminisation effective des chefs d’exploitation.
Pour l’heure aucune réponse aux crises n’est apportée et l’errance de l’élevage ne trouve pas de sortie en raison de l’absence de modèles de production et de référentiels qui intègrent à la fois les composantes de l’élevage corse, les mutations de la société corse et la transformation de ses espaces. Dans ce paysage, le nouveau régime climatique va-t-il favoriser les atouts singuliers du pastoralisme corse ou au contraire va-t-il sonner le glas d’une activité millénaire?
Il faut signaler que les difficultés et la régression de l’élevage en zone de montagne est la réalité de tous les massifs, les pyrénéens et l’arc alpin, même si la stratégie de maintien par la valorisation des produits (AOP fromagères) est parvenue à limiter la déprise. À la singularité près que l’isolement insulaire redouble l’isolement montagnard. La piste de l’incapacité des corses à organiser n’est donc pas le bon point de départ. Nous privilégions plutôt la piste de la difficulté à changer qu’ont les organisations communautaires à forte intégration environnementale.
Il demeure que l’élevage corse n’est toujours pas parvenu en ce début de siècle à se réinventer et à poser sa politique de développement et ses modèles socioéconomiques. Sans politique publique structurante efficace, les éleveurs naviguent à vue, équipés exclusivement d’une passion quelquefois assortie d’une culture technique aujourd’hui en cours de délestage.
Pourtant de nombreuses actions de développement, de projets professionnels, d’expérimentation et de recherches ont été présentés, délibérés et soutenus au plan financier et technique. Les nombreuses études réalisées n’ont pas suscité l’adhésion nécessaire et l’élaboration d’un agenda consensuel.
À titre d’exemple pas moins de cinq typologies des élevages émanant de divers organismes ont été produites, une toutes les décennies depuis presque 40 ans. Autant de documentation susceptible de fournir des éléments de tendance et donc de pilotage afin de donner un cap à l’élevage corse.
Dans Berger en Corse, Pernet et Lenclud associaient en 1977 leurs compétences d’agroéconomiste et d’ethnologue pour poser quelques hypothèses sur l’avenir de l’élevage corse. Le pronostic était franchement pessimiste, si le dépeuplement de l’intérieur se poursuit, « la survie du modèle pastoral traditionnel comme forme spécifique de relations entre l’homme et le milieu parait impossible », faute d’un renouvellement des paysans et faute « d’un modèle d’utilisation pastorale du milieu susceptible de donner les moyens d’exister à un groupe suffisamment nombreux ».
Un demi-siècle plus tard l’activité est toujours là mais elle est au plus mal. Sa forte résilience indique bien que les composantes (races locales, parcours, ressources spontanées et savoir-faire de conduite) gardent leur pertinence pour produire à faible coût et avec peu d'intrants mais sont désormais désajustées pour répondre aux nouveaux enjeux.
L’échec des politiques publiques et la faible efficience des connaissances acquises tiennent à la difficulté qu’ont les décideurs et les professionnels de décider d’un cap et de modèles de production intégrant les ressources locales. En Corse comme ailleurs, ils doivent faire face à la toute-puissance des forces de cadrage, celle des raisonnements, des enseignements, des logiques économiques qui gouvernent des politiques publiques.
Ces politiques inspirées du modèle de l’entreprise agricole et de l’exploitation sans limites de ressources agroindustrielles, facilitent de fait le recours aux intrants. Les revenus agricoles sont ainsi plombés par une forme de facilité consumériste soutenue par l’appareil de conseil et de prescription. Le postulat de l’efficience de l’initiative privée et individuelle a conforté le modèle de l’homme-filière aujourd’hui à bout de souffle. Une logique qui ne parviendra sans doute pas à rémunérer le travail des différents ateliers de production et à fixer le juste prix des productions sans une organisation collective du travail.
L’alliance attendue entre les acteurs ne s’est toujours pas produite. Ici la résilience des anciennes manières pastorales d’élever s’est traduite par un étiolement puis par une fragmentation de ce qui fait pourtant l’originalité des systèmes d’élevage corses. Car à y regarder de plus près, cette résilience est soutenue dans les faits par des financements régionaux et européens significatifs. Il faut se rendre à l’évidence, les programmes, les stratégies, les politiques de soutien n’ont pas permis d'éviter une situation extrêmement dégradée.
Le verrou du travail
Le verrou le plus tangible qui empêche la stabilisation des systèmes d’élevage à caractère pastoral est sans aucun doute le travail, sa nature, son intensité, sa pénibilité et son organisation. On en déduit que sa rationalisation peut fournir un levier efficace pour compenser l’effet des crises.
Si l’élevage pastoral requiert un important volume de travail et une grande variété des tâches, il convient d’identifier les moyens d’action pour revoir l’organisation des ateliers/postes. Le modèle de type « homme filière » où l’éleveur cumule la conduite du troupeau, la transformation et la vente des produits souvent de façon directe semble une impasse. La cohérence du système de production qui reposait sur des savoirs, un travail hautement qualifié et une forte entraide a été mis à mal par des processus connus de désaffiliation communautaire, familiale et villageoise. C’est ce système de production façonné par des siècles de vie communautaire qui met aujourd’hui en tension le travail.
En effet, modèle de « L’homme-filière » et la pratique de la vente directe (la corse est au premier rang en France) supportés par la seule force d’une ou de deux personnes (le couple est la situation la plus fréquente), a gagné en force avec la notion de "production fermière". Ce modèle souvent présenté comme l’idéal d’organisation se fait souvent aux dépens des activités d’élevage notamment de la production fourragère et la surveillance du troupeau. En tout cas, il ne semble pas généralisable sans solution d’organisation collective (matériel en commun, groupement d'employeurs, banque de travail, ateliers collectifs de transformation, fruitière d'affinage, magasin collectif, plateforme de vente ou encore dans la mixité avec le modèle de la régie productive/collectivité etc.).
Pour préserver ce qui constitue les composantes essentielles de l’élevage corse et relâcher la tension sur le travail, d’autres formes d’organisation, communautaire ou sociétaire sont donc possibles. À ce titre, les échecs de la coopération dans le secteur de l’élevage des années 1980, notamment celui des coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA), ne doivent pas prononcer la fin de l’histoire de la coopération en Corse, il est temps en effet de sortir du traumatisme.
Le désarroi actuel lié en partie à la faible rémunération du travail nourrit un manque de confiance et un sentiment d'injustice voire une forme de ressentiment au regard d'autres métiers, lequel induit à son tour une perte d’attractivité de l'élevage et une diminution des installations. Sans aucun doute l’organisation du travail, finalement peu traitée par les organisations professionnelles, constitue un moyen de reconstituer la confiance nécessaire dans la production fermière. L’écologisation des pratiques d’élevage, notamment le recours à la "prairie naturelle" ou de fauche, au parcours et aux races locales, la vente directe de produits fermiers, associée au programme de l'agroécologie, se fait sans innovation collective, sans de nouvelles formes d’organisation de la production, faisant courir le risque d’ajouter de nouvelles taches à une calendrier de travail déjà très chargé.
Le foncier, une variable masquante
La disponibilité foncière est présentée comme la pierre angulaire de la nouvelle édification de l’élevage. Au-delà de l’évidence (il faut des terres pour produire), la question mérite une réflexion qui doit dépasser la seule solution de la propriété foncière pour affronter celle de l’organisation des usages.
Une politique foncière ne peut se résumer à des transferts de propriété pas plus qu’elle ne peut prendre pour référence le seul statut d’agriculteur. S’il faut sanctuariser quelque chose, ce sont les usages agricoles plutôt que la propriété foncière des agriculteurs. Aucun propriétaire ne se laissera convaincre de céder une terre agricole à un agriculteur si celui-ci n’offre aucune garantie particulière pour le maintien d'un usage agricole dans la durée.
Plusieurs outils réglementaires existent (AFP, ASL, GFA, etc.), mais la réservation légale de terres par zonage agricole de longue durée est le seul moyen d’éteindre tout intention spéculative d’où qu’elle vienne. Le désalignement des politiques publiques en faveur de l’agriculture, notamment le PADDUC et les documents d’urbanisme, contribuent à entretenir un flou sur les allocations des terres à l’élevage. Sans de nouveaux dispositifs de réservation foncière et de zonage, le fameux « blocage foncier » présente tous les traits d’une variable masquante laissant sans solution d’autres verrous à l’installation tout aussi sérieux.
Innover dans l’élevage pastoral
Nous avons vu l’importance du travail consacré à l’usage des milieux-ressources, si important pour le pilotage des systèmes pastoraux. Dans ce domaine, l’innovation est rendue difficile parce qu’elle ne s’inscrit pas dans le cortège technique du modèle dominant.
Si l’on recense les innovations vraiment structurantes de ces 50 dernières années, elles sont peu nombreuses. On retiendra bien sûr la clôture comme moyen de contenir la circulation animale de troupeaux devenus sédentaires, l’amélioration pastorale par le girobroyage, la généralisation du quai de traite (autant que la machine à traire) et enfin l’équipement des fromageries (il faut avoir en mémoire les fortes divergences de vue sur la conception des ateliers entre les attentes des berger-fromager et celles de l’administration sanitaire). L'artificialisation des techniques de production notamment par l'usage des engrais et des aliments, relève plus de l'élargissement de l'approvisionnement que d'une innovation sociotechnique tournée vers l'autonomie des élevages. Il faut noter enfin l'utilisation de plus en plus fréquente des GPS comme dispositif d'appui à la surveillance des troupeaux par l'éleveur sur le territoire pastoral. Une innovation durable et d'importance susceptible d'étendre le pâturage à une plus grande partie du territoire.
Peu d’innovations concernent l’organisation du travail, la rationalisation des procédés, sa pénibilité, son ergonomie et au final la qualification des métiers. Les efforts de l'ARACT doivent être ici soulignés.
Quelle valorisation des produits ?
Du côté des produits, la valorisation de l’origine a connu un succès indéniable. Elle a permis le maintien des savoirs de transformation et la bonne réputation des produits. Mais la dynamique de valorisation n’a pas permis de soutenir, et aujourd’hui de prévenir, la dégradation des composantes pastorales de l’élevage corse par ses productions.
La difficulté d'intégrer pleinement, et de façon rationnelle, les milieux-ressources (parcours, châtaigneraie, prairies, maquis, forêts), les pratiques liées à leurs usages et surtout les conditions de leur renouvellement, aux cahiers des charges des produits souligne la difficulté de concevoir l'innovation "avec le vivant". A ce titre, les atermoiements que suscite la qualification du parcours en ressource pastorale démontre la difficulté de l'envisager comme une "ressource domestiquée" par l'éleveur et les animaux et ce faisant de la sortir du registre naturel dans lequel il es confiné. Un statut préjudiciable à la valorisation des laits et des fromages (certification AOP). et à la qualification des savoir-faire associés à l'élevage pastoral corse.
Enfin, les difficultés rencontrés pour bâtir la variété des fromages à partir des types territoriaux (sartinesu, bastelicacciu, venachese, niulincu et calinzanincu) conduit une partie des éleveurs à concevoir aujourd'hui la valorisation autour des laits crus, appréhendés, à raison, comme la meilleure expression des conditions d’élevage. À vrai dire rien ne s’oppose, bien au contraire, à penser une qualification des types territoriaux bâtie sur les bases d’un fromage pastoral (usage des parcours, limitation des concentrés, races locales).
Transformations et nouveaux conflits
Aux anciennes transformations du système agraire de la Corse, liées au retrait des activités agricoles, s’ajoutent aujourd’hui les conséquences de nouvelles occupation des sols liées à la croissance urbaine. Les changements en cours font de l’ancien pastoralisme une activité d’élevage multi-espèces et multiforme.
Dans les zones les moins peuplées, les moins attractives au regard de l’essor résidentiel et touristique, on le trouve de partout, souvent en lambeaux de ce qu’il était autrefois. La diversification des espaces pâturés souvent traversés par des animaux errants provoque des tensions avec d’autres usages. Ces tensions alimentent des conflits entre ruraux. Elles exposent les élevages à des risques sanitaires notamment des zoonoses. Elles nuisent à l’image du métier et à son attractivité...
Les conflits sont d’autant plus forts que, par défaut de transmission, les manières d’élever sont diverses au point où il devient difficile d’en repérer les formes traditionnelles. À cela s’ajoute une recomposition profonde de l’identité de berger et des savoir-faire qui la définissaient. L’entrée dans le métier pour des jeunes néoruraux en attente de nouvelles aspirations élargit le vivier aux villes corses et continentales de même que semble poindre une féminisation effective des chefs d’exploitation.
Pour l’heure aucune réponse aux crises n’est apportée et l’errance de l’élevage ne trouve pas de sortie en raison de l’absence de modèles de production et de référentiels qui intègrent à la fois les composantes de l’élevage corse, les mutations de la société corse et la transformation de ses espaces. Dans ce paysage, le nouveau régime climatique va-t-il favoriser les atouts singuliers du pastoralisme corse ou au contraire va-t-il sonner le glas d’une activité millénaire?