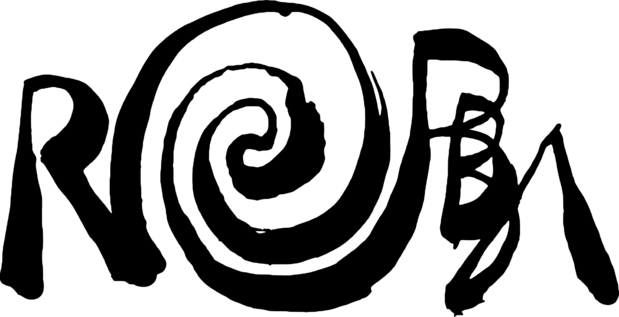« Se intende essere pienamente fedele a sé stessa [la fede] comporta un impegno e una testimonianza verso tutti, per la crescita umana, il progresso sociale e la cura del creato, nel segno della carità », déclara le Pape à Ajaccio.
À travers ces mots se condense l’effort de l’Église pour redécouvrir la Bonne Nouvelle qu’elle a pour mission d’annoncer. Car comme le souligna le Cardinal Bustillo après la messe au Casone : « l’Évangile, si méconnu, nous relève et nous provoque pour mener une vie meilleure, plus juste, plus pacifique, plus fraternelle ». Au cœur d’un nouveau moment franciscain, l’esprit du 15 décembre appelle ainsi une nouvelle attention au monde et un nouveau regard sur le monde.
À travers ces mots se condense l’effort de l’Église pour redécouvrir la Bonne Nouvelle qu’elle a pour mission d’annoncer. Car comme le souligna le Cardinal Bustillo après la messe au Casone : « l’Évangile, si méconnu, nous relève et nous provoque pour mener une vie meilleure, plus juste, plus pacifique, plus fraternelle ». Au cœur d’un nouveau moment franciscain, l’esprit du 15 décembre appelle ainsi une nouvelle attention au monde et un nouveau regard sur le monde.
Une image renouvelée de la foi
Ce n’est pas à partir de dogmes théologiques ou de croyances populaires que François invite l’Église à se renouveler mais à partir du kérygme. Seul repris dans les langues contemporaines, ce mot dérive dans le grec néotestamentaire d’un verbe souvent traduit par « prêcher », ce qui est assez vague.
Or, dans le Nouveau Testament, « kérygmatiser » et kérygme désignent précisément la proclamation de la Bonne Nouvelle et la Bonne Nouvelle proclamée. Ainsi, après avoir passé quarante jours au désert, où Satan le tenta en vain, « Jésus alla en Galilée proclamant l’évangile de Dieu et disant : le moment est venu et le royaume de Dieu se rapproche, convertissez-vous et croyez en l’évangile » (Mc 1, 14-15).
Au sommet de l’Église, c’est bien à redécouvrir le kérygme que François invita en 2023 le nouveau Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, successeur de l’Inquisition romaine établie en 1542 pour servir à la Contre-Réforme : « Nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno ». De façon plus significative encore, c’est à approfondir le kérygme qu’il invita le nouveau Préfet en lui demandant de promouvoir le savoir théologique au lieu de chasser les erreurs doctrinales [1] .
Dans la longue durée de l’Église catholique, cette mission apparaît comme une vraie nouveauté, ou un vrai signe de renouveau évangélique. Depuis les XIIIe et XIVe siècles, en effet, quand prirent forme les procédures d’inquisition, l’Église tend à rapprocher hérésie et péché jusqu’à les assimiler presque [2].
D’où une tendance à se faire un devoir de condamner l’erreur, presque identifiée au mal puisqu’elle en procèderait et que d’elle procèderaient tant de maux. D’où aussi sans doute une tentation : la tentation de se faire une fierté de débusquer l’erreur, de la condamner et d’en triompher, comme si l’on prouvait ainsi que l’on jouit d’une grâce spéciale.
Non seulement, dit-il, ce n’est pas en étant mise sous surveillance que la foi sera le mieux gardée mais voici que François s’adresse, au nom de l’authenticité de leur propre foi, à ceux qui ne sont ni catholiques ni chrétiens. Ainsi dans l’exhortation apostolique Laudate Deum , sur la crise climatique, donnée huit ans après Laudato si’ :
« Je ne veux pas manquer de rappeler aux fidèles catholiques les motivations qui naissent de leur foi. J’encourage les frères et sœurs des autres religions à faire de même, car nous savons que la foi authentique donne non seulement des forces au cœur humain, mais qu’elle transforme toute la vie, transfigure les objectifs personnels, éclaire la relation avec les autres et les liens avec toute la Création. »
Chrétienne ou non, la foi authentique, dit le pape, est transformation de la vie, conversion, y compris « conversion écologique ». Son authenticité n’est donc pas avant tout une question d’orthodoxie, d’appartenance à la véritable Église ou de profession de la vraie religion.
À Ajaccio, le Pape ne fit pas de vaine apologie de la foi chrétienne. Il ne prétendit pas que la politique moderne lui devrait tout ce qu’elle a de bon, des droits de l’homme à l’écologie en passant par la justice sociale. Il indiqua que c’est à ses fruits, à sa capacité d’engagement dans le monde et de témoignage universel, pour la croissance humaine, le progrès social et le soin de la Création, le tout sous le signe de la charité, que l’on reconnaît une foi chrétienne authentique. Nulle auto-célébration donc mais des critères de discernement et d’examen de conscience, en premier lieu bien sûr pour l’Église et les chrétiens.
Apparaît ainsi une image profondément renouvelée de la foi. Longtemps, en effet, on a tendu à l’isoler, en la distinguant trop des œuvres ou en n’imaginant pas que l’on puisse être martyr d’autre chose que de la foi. Or, à la suite de Benoît XVI, qui cherchait à mettre en relation systématique foi, espérance et charité, l’Église contemporaine déconfine la foi. En déclarant qu’« une foi fidèle à elle-même implique un engagement et un témoignage pour la croissance humaine, le progrès social et le soin de la Création, sous le signe de la charité », on redéfinit la foi comme foi opérante et on rapproche foi, espérance et charité jusqu’à les rendre indissociables.
Or, dans le Nouveau Testament, « kérygmatiser » et kérygme désignent précisément la proclamation de la Bonne Nouvelle et la Bonne Nouvelle proclamée. Ainsi, après avoir passé quarante jours au désert, où Satan le tenta en vain, « Jésus alla en Galilée proclamant l’évangile de Dieu et disant : le moment est venu et le royaume de Dieu se rapproche, convertissez-vous et croyez en l’évangile » (Mc 1, 14-15).
Au sommet de l’Église, c’est bien à redécouvrir le kérygme que François invita en 2023 le nouveau Préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, successeur de l’Inquisition romaine établie en 1542 pour servir à la Contre-Réforme : « Nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno ». De façon plus significative encore, c’est à approfondir le kérygme qu’il invita le nouveau Préfet en lui demandant de promouvoir le savoir théologique au lieu de chasser les erreurs doctrinales [1] .
Dans la longue durée de l’Église catholique, cette mission apparaît comme une vraie nouveauté, ou un vrai signe de renouveau évangélique. Depuis les XIIIe et XIVe siècles, en effet, quand prirent forme les procédures d’inquisition, l’Église tend à rapprocher hérésie et péché jusqu’à les assimiler presque [2].
D’où une tendance à se faire un devoir de condamner l’erreur, presque identifiée au mal puisqu’elle en procèderait et que d’elle procèderaient tant de maux. D’où aussi sans doute une tentation : la tentation de se faire une fierté de débusquer l’erreur, de la condamner et d’en triompher, comme si l’on prouvait ainsi que l’on jouit d’une grâce spéciale.
Non seulement, dit-il, ce n’est pas en étant mise sous surveillance que la foi sera le mieux gardée mais voici que François s’adresse, au nom de l’authenticité de leur propre foi, à ceux qui ne sont ni catholiques ni chrétiens. Ainsi dans l’exhortation apostolique Laudate Deum , sur la crise climatique, donnée huit ans après Laudato si’ :
« Je ne veux pas manquer de rappeler aux fidèles catholiques les motivations qui naissent de leur foi. J’encourage les frères et sœurs des autres religions à faire de même, car nous savons que la foi authentique donne non seulement des forces au cœur humain, mais qu’elle transforme toute la vie, transfigure les objectifs personnels, éclaire la relation avec les autres et les liens avec toute la Création. »
Chrétienne ou non, la foi authentique, dit le pape, est transformation de la vie, conversion, y compris « conversion écologique ». Son authenticité n’est donc pas avant tout une question d’orthodoxie, d’appartenance à la véritable Église ou de profession de la vraie religion.
À Ajaccio, le Pape ne fit pas de vaine apologie de la foi chrétienne. Il ne prétendit pas que la politique moderne lui devrait tout ce qu’elle a de bon, des droits de l’homme à l’écologie en passant par la justice sociale. Il indiqua que c’est à ses fruits, à sa capacité d’engagement dans le monde et de témoignage universel, pour la croissance humaine, le progrès social et le soin de la Création, le tout sous le signe de la charité, que l’on reconnaît une foi chrétienne authentique. Nulle auto-célébration donc mais des critères de discernement et d’examen de conscience, en premier lieu bien sûr pour l’Église et les chrétiens.
Apparaît ainsi une image profondément renouvelée de la foi. Longtemps, en effet, on a tendu à l’isoler, en la distinguant trop des œuvres ou en n’imaginant pas que l’on puisse être martyr d’autre chose que de la foi. Or, à la suite de Benoît XVI, qui cherchait à mettre en relation systématique foi, espérance et charité, l’Église contemporaine déconfine la foi. En déclarant qu’« une foi fidèle à elle-même implique un engagement et un témoignage pour la croissance humaine, le progrès social et le soin de la Création, sous le signe de la charité », on redéfinit la foi comme foi opérante et on rapproche foi, espérance et charité jusqu’à les rendre indissociables.
[1] https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/Lettera-Francesco-al-Prefetto.html
[2] Alain Boureau, Satan hérétique. Histoire de la démonologie (1280-1330), Odile Jacob, 2004.
Conversion de la conversion
Depuis Jean XXIII et Paul VI, l’Église catholique ne prie plus pour que les Juifs perfides reconnaissent le Christ : elle prie pour que les Juifs, « à qui Dieu a parlé en premier », « progressent dans l’amour de son Nom et dans la fidélité à son Alliance », ce qui suppose que la nouvelle alliance n’abolit pas l’ancienne, que l’Église ne remplace pas la Synagogue.
Prononcés en 1054, les anathèmes entre Rome et Constantinople ont été levés en 1965 par Paul VI et le Patriarche Athénagoras [1]. En Allemagne, une commission de théologiens catholiques et luthériens conclut dans les années 1980 que les querelles du XVIe siècle, qu’elle avait été chargée de réexaminer, reposaient en partie sur des malentendus et n’avaient plus guère de sens [2].
Laudato si’ s’inspire du Patriarche Bartholomée. Fratelli tutti prolonge une déclaration commune du Pape et du Grand Imam d’Al-Azhar [3]. En 2020, Querida Amazonia appelait à « valoriser la mystique autochtone », marquant ainsi une inflexion majeure dans les relations entre l’ancien et le nouveau monde.
L’Église, bien sûr, n’a pas oublié la distinction monothéiste entre culte saint et prosternations impies. Au contraire : « dans la mesure où la foi est liée à la conversion, elle est l’opposé de l’idolâtrie » [4], écrit François dès sa première encyclique.
Cette insistance sur la conversion, sans laquelle la foi se rapproche dangereusement de l’idolâtrie, est bien dans la ligne de la redécouverte du kérygme : « convertissez-vous et croyez en l’évangile » (Mc 1, 15). Elle accroît en outre la portée libératrice de la distinction entre foi et idolâtrie : tandis que l’idolâtrie enferme, la foi, dans la mesure où elle est liée à la conversion, transforme la vie.
Alors que la distinction monothéiste entre foi et idolâtrie est avivée, sa charge explosive, manifeste dès le massacre des adorateurs du veau d’or (Ex 32, 25-29), est désamorcée. Tout en distinguant entre fidélité et infidélité, la distinction ne tend plus, ou ne devrait plus tendre, à opposer fidèles et infidèles. Elle ne tend plus, ou ne devrait plus tendre, à opposer brutalement les contre-religions abrahamiques entre elles ou à les opposer toutes ensemble aux « polythéismes » et « superstitions populaires ». Au lieu d’oppositions, s’ouvre une perspective de fraternisation et, plus radicalement, de réinterprétation du sens de la distinction monothéiste entre cultes saints et prosternations impies, ou entre vrai et faux dieux, foi et idolâtrie.
Comme si elle procédait à une sorte d’examen de conscience, la distinction monothéiste impose alors de distinguer entre une distinction monothéiste véritable, ou un monothéiste véritable, capable d’approcher les autres et d’établir avec eux une harmonie, et une fausse distinction monothéiste, ou un pseudo-monothéisme, qui éloigne des autres et sème le mépris, la haine ou la violence. C’est à opérer cette distinction religieuse entre des distinctions religieuses sages et folles que s’appliqua François à l’occasion d’une rencontre interreligieuse à Oulan-Bator, en 2023, lorsque pour la première fois, près de huit cents ans après l’envoi d’ambassades à la rencontre du Grand Khan, un évêque de Rome se rendit en personne en Mongolie.
Au cœur du monothéisme s’opère ainsi comme un mouvement de conversion de la conversion. La conversion perd son allure d’adhésion à une religion opposée à d’autres ; elle perd son allure d’enrôlement datable et définitif, une fois pour toutes, dont la rupture est apostasie.
Comme y insistait un franciscain spirituel du XIIIe siècle, Pierre de Jean Olivi, et comme y insiste François, la vraie foi n’est jamais acquise et ne peut se réduire à une habitude ; l’idée d’« une foi chevillée au corps » relève du paradoxe, voire du contresens. La conversion apparaît alors avant tout comme ce moment, appelé, sauf à tomber dans l’idolâtrie, à se répéter, où la foi s’interroge à nouveau sur sa fidélité. Elle est ce moment de reconversion qu’évoquait François à Ajaccio et que présuppose tout son message : la foi, « se intende essere pienamente fedele a sé stessa […] ».
Peut-être est-ce dans cette perspective de conversion de la conversion que l’on pourrait poursuivre la réhabilitation de la piété populaire. Pour la prendre tout à fait au sérieux, il faudrait d’abord supposer que la piété populaire elle aussi peut être fidèle ou infidèle à elle-même, en particulier en fonction de l’engagement et du témoignage qu’elle implique.
Autrement dit, il faudrait considérer que la piété populaire elle aussi peut se reconvertir et se renouveler dans ses propres termes, sans n’être que la religion des masses, implicite, voire irréfléchie, dont la religion savante, explicite, élaborée, reste la clé ou la norme. Il faudrait ensuite éviter de ne voir dans la piété populaire qu’une ressource pastorale et lui reconnaître une dignité proprement théologique, appelant certes un genre de théologie moins académique que celui de la théologie ordinaire.
Prononcés en 1054, les anathèmes entre Rome et Constantinople ont été levés en 1965 par Paul VI et le Patriarche Athénagoras [1]. En Allemagne, une commission de théologiens catholiques et luthériens conclut dans les années 1980 que les querelles du XVIe siècle, qu’elle avait été chargée de réexaminer, reposaient en partie sur des malentendus et n’avaient plus guère de sens [2].
Laudato si’ s’inspire du Patriarche Bartholomée. Fratelli tutti prolonge une déclaration commune du Pape et du Grand Imam d’Al-Azhar [3]. En 2020, Querida Amazonia appelait à « valoriser la mystique autochtone », marquant ainsi une inflexion majeure dans les relations entre l’ancien et le nouveau monde.
L’Église, bien sûr, n’a pas oublié la distinction monothéiste entre culte saint et prosternations impies. Au contraire : « dans la mesure où la foi est liée à la conversion, elle est l’opposé de l’idolâtrie » [4], écrit François dès sa première encyclique.
Cette insistance sur la conversion, sans laquelle la foi se rapproche dangereusement de l’idolâtrie, est bien dans la ligne de la redécouverte du kérygme : « convertissez-vous et croyez en l’évangile » (Mc 1, 15). Elle accroît en outre la portée libératrice de la distinction entre foi et idolâtrie : tandis que l’idolâtrie enferme, la foi, dans la mesure où elle est liée à la conversion, transforme la vie.
Alors que la distinction monothéiste entre foi et idolâtrie est avivée, sa charge explosive, manifeste dès le massacre des adorateurs du veau d’or (Ex 32, 25-29), est désamorcée. Tout en distinguant entre fidélité et infidélité, la distinction ne tend plus, ou ne devrait plus tendre, à opposer fidèles et infidèles. Elle ne tend plus, ou ne devrait plus tendre, à opposer brutalement les contre-religions abrahamiques entre elles ou à les opposer toutes ensemble aux « polythéismes » et « superstitions populaires ». Au lieu d’oppositions, s’ouvre une perspective de fraternisation et, plus radicalement, de réinterprétation du sens de la distinction monothéiste entre cultes saints et prosternations impies, ou entre vrai et faux dieux, foi et idolâtrie.
Comme si elle procédait à une sorte d’examen de conscience, la distinction monothéiste impose alors de distinguer entre une distinction monothéiste véritable, ou un monothéiste véritable, capable d’approcher les autres et d’établir avec eux une harmonie, et une fausse distinction monothéiste, ou un pseudo-monothéisme, qui éloigne des autres et sème le mépris, la haine ou la violence. C’est à opérer cette distinction religieuse entre des distinctions religieuses sages et folles que s’appliqua François à l’occasion d’une rencontre interreligieuse à Oulan-Bator, en 2023, lorsque pour la première fois, près de huit cents ans après l’envoi d’ambassades à la rencontre du Grand Khan, un évêque de Rome se rendit en personne en Mongolie.
Au cœur du monothéisme s’opère ainsi comme un mouvement de conversion de la conversion. La conversion perd son allure d’adhésion à une religion opposée à d’autres ; elle perd son allure d’enrôlement datable et définitif, une fois pour toutes, dont la rupture est apostasie.
Comme y insistait un franciscain spirituel du XIIIe siècle, Pierre de Jean Olivi, et comme y insiste François, la vraie foi n’est jamais acquise et ne peut se réduire à une habitude ; l’idée d’« une foi chevillée au corps » relève du paradoxe, voire du contresens. La conversion apparaît alors avant tout comme ce moment, appelé, sauf à tomber dans l’idolâtrie, à se répéter, où la foi s’interroge à nouveau sur sa fidélité. Elle est ce moment de reconversion qu’évoquait François à Ajaccio et que présuppose tout son message : la foi, « se intende essere pienamente fedele a sé stessa […] ».
Peut-être est-ce dans cette perspective de conversion de la conversion que l’on pourrait poursuivre la réhabilitation de la piété populaire. Pour la prendre tout à fait au sérieux, il faudrait d’abord supposer que la piété populaire elle aussi peut être fidèle ou infidèle à elle-même, en particulier en fonction de l’engagement et du témoignage qu’elle implique.
Autrement dit, il faudrait considérer que la piété populaire elle aussi peut se reconvertir et se renouveler dans ses propres termes, sans n’être que la religion des masses, implicite, voire irréfléchie, dont la religion savante, explicite, élaborée, reste la clé ou la norme. Il faudrait ensuite éviter de ne voir dans la piété populaire qu’une ressource pastorale et lui reconnaître une dignité proprement théologique, appelant certes un genre de théologie moins académique que celui de la théologie ordinaire.
[2] Les anathèmes du XVIème siècle sont-ils toujours actuels ? Les condamnations doctrinales du concile de Trente et des Réformateurs justifient-elles encore la division de nos Églises ?, Paris, Cerf, 1989.
[3] Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, 4 février 2019, https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
[4] Lumen fidei, 2013, §13.
L’apaisement de la crise antimoderniste
Tout ceci n’est imaginable qu’en raison de l’apaisement de la crise à travers laquelle l’Église s’opposa au « monde moderne », œuvre d’une « vaste conspiration d’hommes impies » selon Grégoire XVI (1831-1846) [1]. Longtemps, en réaction à la Révolution française et à ses répliques, Rome dénonça « l’indifférentisme », l’indifférence à la distinction entre vraie et fausses religions, que certains dénoncèrent encore autour de la première rencontre œcuménique d’Assise, en 1986, le « laïcisme », consécration de l’indifférentisme, et toutes sortes d’erreurs fatales à la foi, aux mœurs et à la société. Enfla ainsi une gigantesque querelle des Anciens et des Modernes.
Un catholicisme querelleur s’affirma alors, qui n’a nullement disparu et n’a qu’à relancer la crise dont il se nourrit pour se réaffirmer. Évidemment plus inspiré par la philosophie conservatrice d’un Bonald que par l’évangile, il était plus ancré dans le paysage idéologique qui se forma au XIXe siècle que dans la tradition théologique. En 1864, Pie IX (1846-1878) compila ainsi « les principales erreurs de notre temps » : anathème à qui dira, 80ème et ultime erreur condamnée, récapitulant l’ensemble des condamnations, que « le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne » [2] .
Au-delà de ce catholicisme intransigeant, la crise antimoderniste atteignit son paroxysme avec le catholicisme intégral promu par Pie X (1903-1914), canonisé en 1954, et dont le grand symbole fut la fête du Christ-Roi, instituée pour conjurer le laïcisme, « peste de notre époque » [3]. Le monde moderne, avait averti Pie X au début de son pontificat, était coupable du péché le plus grave : « à l’égard de Dieu, l’abandon et l’apostasie » [4]. Deux ans plus tard, le pape dénonçait la loi française de séparation des Églises et de l’État, « profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu’elle renie officiellement, en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte » [5].
La loi de 1905 ne fut pourtant pas l’œuvre d’un parti anticlérical. Au contraire, elle garantissait au clergé français, soustrait à l’autorité du gouvernement, des libertés nouvelles. Elle ne pose d’ailleurs nullement « en principe que la République ne reconnaît aucun culte ». Son Art. 2 dispose seulement, à propos des budgets publics, que « la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte », règle assortie d’exceptions afin d’assurer le libre exercice des cultes dans les écoles, les hôpitaux ou les prisons. Seul son Art. 1 pose un véritable principe : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
Du point de vue de la dogmatique du droit moderne, ce principe développe l’Art. 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Il va plus loin puisqu’il n’envisage pas la religion sous l’angle d’opinions mais sous celui de la conscience et du culte, ce qui respecte évidemment mieux l’expérience religieuse.
Du point de vue de l’idéologie de l’Église antimoderniste, il en allait tout autrement : Grégoire XVI et Pie IX avaient qualifié de « délire » l’idée que « la liberté de conscience et des cultes [soit] un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué ». Ce n’est qu’en 1965, avec le Concile de Vatican II, que l’Église se convertirait à la liberté de religion, qu’elle ramènerait alors à la dignité humaine et à la Révélation divine. C’est ce début d’apaisement de la crise antimoderniste que le pontificat de François prolonge. Or cet apaisement n’est pas simplement, comme on le dit souvent, un aggiornamento ou une modernisation de l’Église. Plus profondément, c’est un recul de la croyance au « monde moderne », qui paralysa tant l’Église et la Corse.
Un catholicisme querelleur s’affirma alors, qui n’a nullement disparu et n’a qu’à relancer la crise dont il se nourrit pour se réaffirmer. Évidemment plus inspiré par la philosophie conservatrice d’un Bonald que par l’évangile, il était plus ancré dans le paysage idéologique qui se forma au XIXe siècle que dans la tradition théologique. En 1864, Pie IX (1846-1878) compila ainsi « les principales erreurs de notre temps » : anathème à qui dira, 80ème et ultime erreur condamnée, récapitulant l’ensemble des condamnations, que « le Pontife Romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne » [2] .
Au-delà de ce catholicisme intransigeant, la crise antimoderniste atteignit son paroxysme avec le catholicisme intégral promu par Pie X (1903-1914), canonisé en 1954, et dont le grand symbole fut la fête du Christ-Roi, instituée pour conjurer le laïcisme, « peste de notre époque » [3]. Le monde moderne, avait averti Pie X au début de son pontificat, était coupable du péché le plus grave : « à l’égard de Dieu, l’abandon et l’apostasie » [4]. Deux ans plus tard, le pape dénonçait la loi française de séparation des Églises et de l’État, « profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu’elle renie officiellement, en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte » [5].
La loi de 1905 ne fut pourtant pas l’œuvre d’un parti anticlérical. Au contraire, elle garantissait au clergé français, soustrait à l’autorité du gouvernement, des libertés nouvelles. Elle ne pose d’ailleurs nullement « en principe que la République ne reconnaît aucun culte ». Son Art. 2 dispose seulement, à propos des budgets publics, que « la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte », règle assortie d’exceptions afin d’assurer le libre exercice des cultes dans les écoles, les hôpitaux ou les prisons. Seul son Art. 1 pose un véritable principe : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
Du point de vue de la dogmatique du droit moderne, ce principe développe l’Art. 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Il va plus loin puisqu’il n’envisage pas la religion sous l’angle d’opinions mais sous celui de la conscience et du culte, ce qui respecte évidemment mieux l’expérience religieuse.
Du point de vue de l’idéologie de l’Église antimoderniste, il en allait tout autrement : Grégoire XVI et Pie IX avaient qualifié de « délire » l’idée que « la liberté de conscience et des cultes [soit] un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et assuré dans tout État bien constitué ». Ce n’est qu’en 1965, avec le Concile de Vatican II, que l’Église se convertirait à la liberté de religion, qu’elle ramènerait alors à la dignité humaine et à la Révélation divine. C’est ce début d’apaisement de la crise antimoderniste que le pontificat de François prolonge. Or cet apaisement n’est pas simplement, comme on le dit souvent, un aggiornamento ou une modernisation de l’Église. Plus profondément, c’est un recul de la croyance au « monde moderne », qui paralysa tant l’Église et la Corse.
[1] Mirari vos, 1832, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k91116q/f244.item
[2] Syllabus errorum, 1864, https://fr.wikisource.org/wiki/Encyclique_Quanta_Cura_et_Le_Syllabus/Syllabus
[3] Quas primas, 1925, https://www.vatican.va/content/pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
[4] E supremi, 1903, https://www.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_04101903_e-supremi.html
[5] Vehementer nos, 1906, https://www.vatican.va/content/pius-x/fr/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_11021906_vehementer-nos.html
L’Église, la Corse et la reconquête de l’avenir
Si l’Église antimoderniste s’opposa tant au « monde moderne », c’est qu’elle y croyait dur comme fer, une même croyance (anti)moderniste faisant des cléricaux et des anticléricaux les plus intransigeants des frères ennemis, assez semblables au fond les uns aux autres. Car l’Église aussi croyait que « le monde moderne » rompait radicalement avec « le monde ancien », « où brillèrent pendant tant de siècles les splendeurs de la civilisation chrétienne », selon Pie XII [1]. Elle aussi prenait la Révolution française au pied de la lettre, comme si l’histoire avait vraiment été coupée en deux par l’abolition de l’Ancien régime, et des privilèges de l’Église ; elle regrettait un âge d’or, comme si on avait vraiment changé d’âge et que le passé était bel et bien révolu.
Il est certain que l’Église n’a pas inventé seule l’idée d’un monde moderne radicalement différent des autres. Il est certain néanmoins qu’elle a contribué, de façon décisive, à la formation et à la diffusion de la croyance au monde moderne, qu’elle a accréditée et propagée.
Quelle autre institution a pu la dramatiser autant et autant l’imprimer dans les esprits ? Quelle autre institution a alimenté autant de discours méta-historiques, sans aucune méthode historique, et souvent sans rigueur conceptuelle, sur la modernité, la sécularisation, la déchristianisation, le rationalisme, le nihilisme, le relativisme, etc. ? Pourtant, pour le dire avec Bruno Latour, anthropologue des Modernes qui fut d’abord un catholique cherchant à échapper à la crise (anti)moderniste et à ses litanies de généralités creuses : « il n’y a pas de monde moderne » [2].
Dans l’Église, la croyance au monde moderne conduit à s’enliser dans les faux combats. Ainsi de l’affrontement entre « conservateurs » et « progressistes », si souvent mis et remis en scène que l’on pourrait le croire capital alors que les notions mêmes de conservatisme et de progressisme, venues des conflits idéologiques des XIXe et XXe siècles, n’ont aucun sens chrétien, évangélique ou biblique.
Étrangère à sa vocation, l’alternative entre conservateurs et progressistes paralyse l’Église. C’est pourquoi sans doute elle est relativisée dans les entretiens du cardinal Bustillo, de Mgr Peña Parra, Substitut à la Secrétairie d’État, et de Nicolas Diat [3].
La croyance au moderne toucha également la Corse, même si les querelles théologico-idéologiques y furent moins dramatisées qu’à Rome ou Paris, et même si la piété populaire ne s’égara pas dans le zèle du catholicisme intégral. En Corse et dans le monde rural, en particulier au sud, la croyance au monde moderne tua l’espérance en accréditant l’idée de périphérie. Si l’exode rural frappa si fort, c’est sans doute aussi parce qu’il passa pour une fatalité. C’est qu’on crut aux lois d’airain du monde moderne, face auxquelles ùn si pudia fà nunda.
Si un riacquistu fut nécessaire, de l’avenir plus encore que de la culture, ou de la tradition mais d’une tradition vivante, revitalisée, renouvelée, créative, c’est qu’il fallut se libérer des fausses évidences. Comme le découvrit Tonì Casalonga dès les années 1960 : « “il n’y a pas de centre”, ni des arts ni des idées » [4]. Pas de centre et donc pas de périphéries, ou alors des lieux progressivement désertés et abandonnés. On peut se faire tout un monde à Pigna comme dans un quartier de Rome ; il n’y a pas plus d’avenir sur le continent que dans un village.
D’où l’importance pour les Corses d’aujourd’hui de campà quì, de continuer à habiter et de réhabiter leur pays. Comme le soulignait Benoît XVI [5], c’est là l’expérience même de l’espérance comme espérance vécue – comme patience, persévérance, constance, endurance, souci de faire durer le monde, un monde, un pays, même ou surtout contre toutes attentes.
Il est certain que l’Église n’a pas inventé seule l’idée d’un monde moderne radicalement différent des autres. Il est certain néanmoins qu’elle a contribué, de façon décisive, à la formation et à la diffusion de la croyance au monde moderne, qu’elle a accréditée et propagée.
Quelle autre institution a pu la dramatiser autant et autant l’imprimer dans les esprits ? Quelle autre institution a alimenté autant de discours méta-historiques, sans aucune méthode historique, et souvent sans rigueur conceptuelle, sur la modernité, la sécularisation, la déchristianisation, le rationalisme, le nihilisme, le relativisme, etc. ? Pourtant, pour le dire avec Bruno Latour, anthropologue des Modernes qui fut d’abord un catholique cherchant à échapper à la crise (anti)moderniste et à ses litanies de généralités creuses : « il n’y a pas de monde moderne » [2].
Dans l’Église, la croyance au monde moderne conduit à s’enliser dans les faux combats. Ainsi de l’affrontement entre « conservateurs » et « progressistes », si souvent mis et remis en scène que l’on pourrait le croire capital alors que les notions mêmes de conservatisme et de progressisme, venues des conflits idéologiques des XIXe et XXe siècles, n’ont aucun sens chrétien, évangélique ou biblique.
Étrangère à sa vocation, l’alternative entre conservateurs et progressistes paralyse l’Église. C’est pourquoi sans doute elle est relativisée dans les entretiens du cardinal Bustillo, de Mgr Peña Parra, Substitut à la Secrétairie d’État, et de Nicolas Diat [3].
La croyance au moderne toucha également la Corse, même si les querelles théologico-idéologiques y furent moins dramatisées qu’à Rome ou Paris, et même si la piété populaire ne s’égara pas dans le zèle du catholicisme intégral. En Corse et dans le monde rural, en particulier au sud, la croyance au monde moderne tua l’espérance en accréditant l’idée de périphérie. Si l’exode rural frappa si fort, c’est sans doute aussi parce qu’il passa pour une fatalité. C’est qu’on crut aux lois d’airain du monde moderne, face auxquelles ùn si pudia fà nunda.
Si un riacquistu fut nécessaire, de l’avenir plus encore que de la culture, ou de la tradition mais d’une tradition vivante, revitalisée, renouvelée, créative, c’est qu’il fallut se libérer des fausses évidences. Comme le découvrit Tonì Casalonga dès les années 1960 : « “il n’y a pas de centre”, ni des arts ni des idées » [4]. Pas de centre et donc pas de périphéries, ou alors des lieux progressivement désertés et abandonnés. On peut se faire tout un monde à Pigna comme dans un quartier de Rome ; il n’y a pas plus d’avenir sur le continent que dans un village.
D’où l’importance pour les Corses d’aujourd’hui de campà quì, de continuer à habiter et de réhabiter leur pays. Comme le soulignait Benoît XVI [5], c’est là l’expérience même de l’espérance comme espérance vécue – comme patience, persévérance, constance, endurance, souci de faire durer le monde, un monde, un pays, même ou surtout contre toutes attentes.
[1] Summi pontificatus, 1939, https://www.vatican.va/content/pius-xii/fr/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20101939_summi-pontificatus.html
[2] Bruno Latour, Irréductions, publié avec Pasteur : guerre et paix des microbes, La Découverte, 2001, p. 311.
[3] François Bustillo, Edgar Peña Parra, Nicolas Diat, Le cœur ne se divise pas. Conversation sur l’unité, Fayard, 2023.
[4] In Vannina Bernard-Leoni, Tonì Casalonga. D’arte è d’impegni, Albiana, 2022, p. 109.
[5] Benoît XVI, Spe salvi, 2007, §9.
Redécouvrir ce qui compte
Sans doute cependant n’a-t-on pas fini de se libérer des fausses évidences. La croyance au monde moderne peut pousser à vouloir s’y assimiler tout en cultivant un certain exotisme, un supplément d’âme, plutôt qu’à chercher à multiplier les microcosmes communiquant avec d’autres microcosmes. D’où aussi cette conscience divisée des Corses, dont Main basse sur une île ou Robba ont souligné les paradoxes – celui par exemple de la fierté d’un « peuple de bergers » où, dans une certaine indifférence, le pastoralisme a presque disparu et où l’affirmation de la cursitudine, d’une singularité, risque de se dégrader en étalage de cursichezza, en particularisme.
C’est que la croyance (anti)moderniste fait toujours obstacle au discernement. Elle obsède les esprits, fascinés par le cours du temps, ses époques et les crises qui les séparent, par le progrès de l’Humanité, les transformations des conditions de vie ou la décadence de l’Occident. Elle oublie « le moment venu » ou « le temps accompli » : « Jésus alla en Galilée proclamant l’évangile de Dieu et disant : le moment est venu et le royaume de Dieu se rapproche, convertissez-vous et croyez en l’évangile » (Mc 1, 14-15). En détournant du temps du kérygme, elle occulte la question décisive, celle que François rappela au Casone : « che cosa dobbiamo fare ? »
L’apaisement de la crise (anti)moderniste, il faut y insister, n’a rien d’une modernisation de l’Église ou d’une réconciliation de l’Église avec le monde moderne. S’il y a réconciliation, c’est de l’Église avec elle-même, avec sa vocation, qui n’est pas de contribuer au brouhaha idéologique. L’apaisement de la crise antimoderniste est plutôt un recul de la croyance aux lois de l’histoire. Au colloque d’Ajaccio, François démystifia justement ces superstitions :
…oggi, specialmente nei Paesi europei, la domanda su Dio sembra affievolirsi e ci si scopre sempre più indifferenti nei confronti della presenza e della sua Parola. Tuttavia, bisogna essere cauti nell’analisi di questo scenario, per non lasciarsi andare in considerazioni frettolose e giudizi ideologici che, talvolta ancora oggi, contrappongono cultura cristiana e cultura laica. Questo è uno sbaglio !
Le Pape coupa ainsi la racine de la croyance (anti)moderniste dans l’Église : le monde moderne n’est ni apostat, ni corrompu par l’indifférentisme propagé par une conspiration d’impies ; tout ceci n’est qu’un mauvais rêve, un scénario bâclé, qui occulte les questions qui comptent.
Or c’est bien de redécouvrir ce qui compte vraiment qu’ont besoin l’Église et la Corse. C’est Satan qui incita David, roi guerrier, à faire recenser Israël pour mesurer ses forces ; le geste déplut à Dieu, qui refusa que David élève le Temple et ne le permit qu’à son fils Salomon, le Pacifique (1 Ch 21-22).
Aujourd’hui encore, les nombres disent peu de choses de la vitalité de l’Église et de la Corse. Comme l’a montré Jean-Luc Luciani, on ne peut pas compter les poètes par agrégation, comme dans un recensement : il faut les pister par association ; apparaissent alors bien des poètes et même des poètes en un sens insoupçonné, ce qui oblige à se demander ce qu’est vraiment un poète. Il en va exactement de même dans l’Église, dont le grand danger n’est pas de voir fondre les effectifs de fidèles et de prêtres mais de n’être qu’une congrégation de « pseudomartyrs de Dieu » (1 Cor 15, 15) et dont le nouveau moment franciscain manifeste un renouveau plus qu’un déclin.
C’est que la croyance (anti)moderniste fait toujours obstacle au discernement. Elle obsède les esprits, fascinés par le cours du temps, ses époques et les crises qui les séparent, par le progrès de l’Humanité, les transformations des conditions de vie ou la décadence de l’Occident. Elle oublie « le moment venu » ou « le temps accompli » : « Jésus alla en Galilée proclamant l’évangile de Dieu et disant : le moment est venu et le royaume de Dieu se rapproche, convertissez-vous et croyez en l’évangile » (Mc 1, 14-15). En détournant du temps du kérygme, elle occulte la question décisive, celle que François rappela au Casone : « che cosa dobbiamo fare ? »
L’apaisement de la crise (anti)moderniste, il faut y insister, n’a rien d’une modernisation de l’Église ou d’une réconciliation de l’Église avec le monde moderne. S’il y a réconciliation, c’est de l’Église avec elle-même, avec sa vocation, qui n’est pas de contribuer au brouhaha idéologique. L’apaisement de la crise antimoderniste est plutôt un recul de la croyance aux lois de l’histoire. Au colloque d’Ajaccio, François démystifia justement ces superstitions :
…oggi, specialmente nei Paesi europei, la domanda su Dio sembra affievolirsi e ci si scopre sempre più indifferenti nei confronti della presenza e della sua Parola. Tuttavia, bisogna essere cauti nell’analisi di questo scenario, per non lasciarsi andare in considerazioni frettolose e giudizi ideologici che, talvolta ancora oggi, contrappongono cultura cristiana e cultura laica. Questo è uno sbaglio !
Le Pape coupa ainsi la racine de la croyance (anti)moderniste dans l’Église : le monde moderne n’est ni apostat, ni corrompu par l’indifférentisme propagé par une conspiration d’impies ; tout ceci n’est qu’un mauvais rêve, un scénario bâclé, qui occulte les questions qui comptent.
Or c’est bien de redécouvrir ce qui compte vraiment qu’ont besoin l’Église et la Corse. C’est Satan qui incita David, roi guerrier, à faire recenser Israël pour mesurer ses forces ; le geste déplut à Dieu, qui refusa que David élève le Temple et ne le permit qu’à son fils Salomon, le Pacifique (1 Ch 21-22).
Aujourd’hui encore, les nombres disent peu de choses de la vitalité de l’Église et de la Corse. Comme l’a montré Jean-Luc Luciani, on ne peut pas compter les poètes par agrégation, comme dans un recensement : il faut les pister par association ; apparaissent alors bien des poètes et même des poètes en un sens insoupçonné, ce qui oblige à se demander ce qu’est vraiment un poète. Il en va exactement de même dans l’Église, dont le grand danger n’est pas de voir fondre les effectifs de fidèles et de prêtres mais de n’être qu’une congrégation de « pseudomartyrs de Dieu » (1 Cor 15, 15) et dont le nouveau moment franciscain manifeste un renouveau plus qu’un déclin.
Retrouvez la première partie de cet article ici