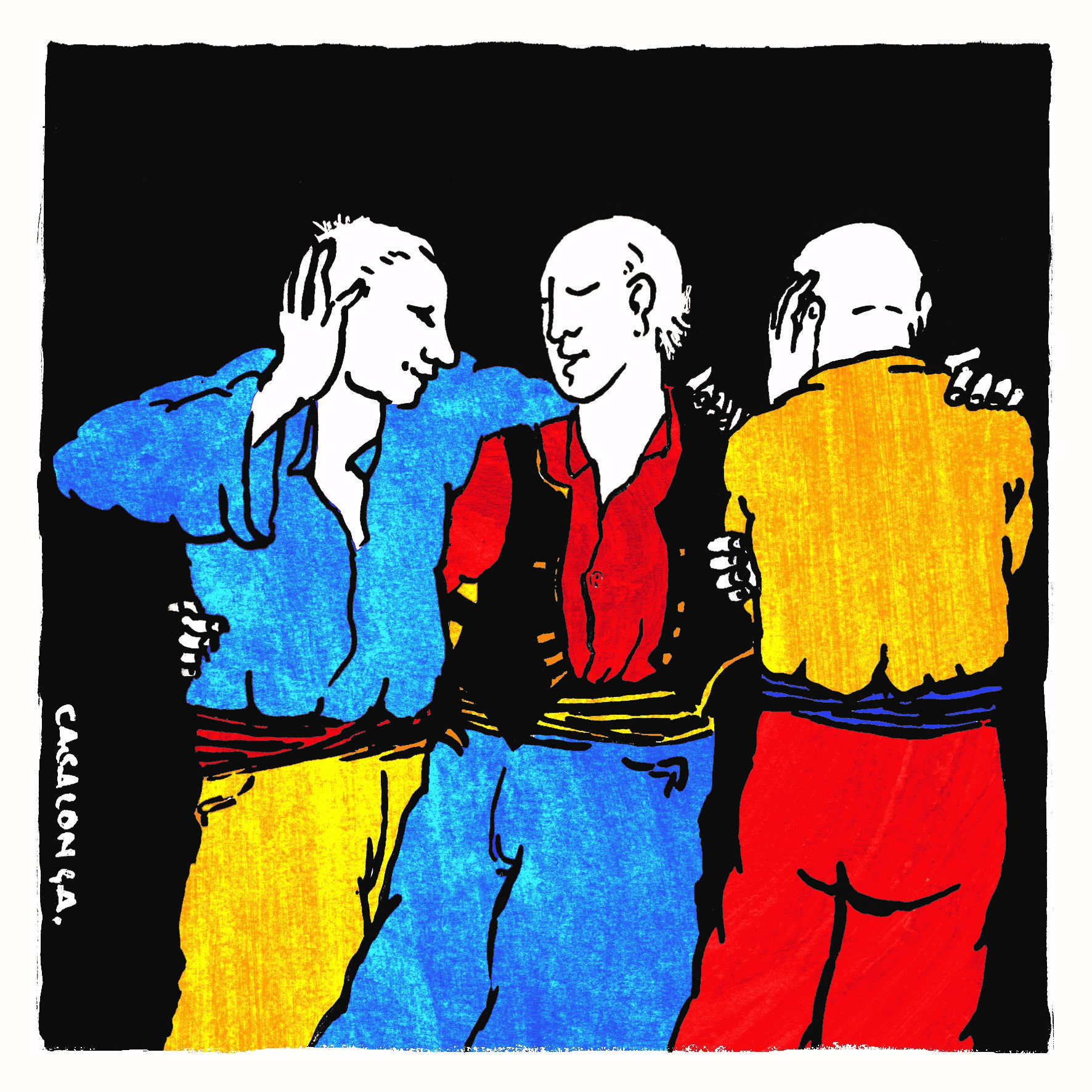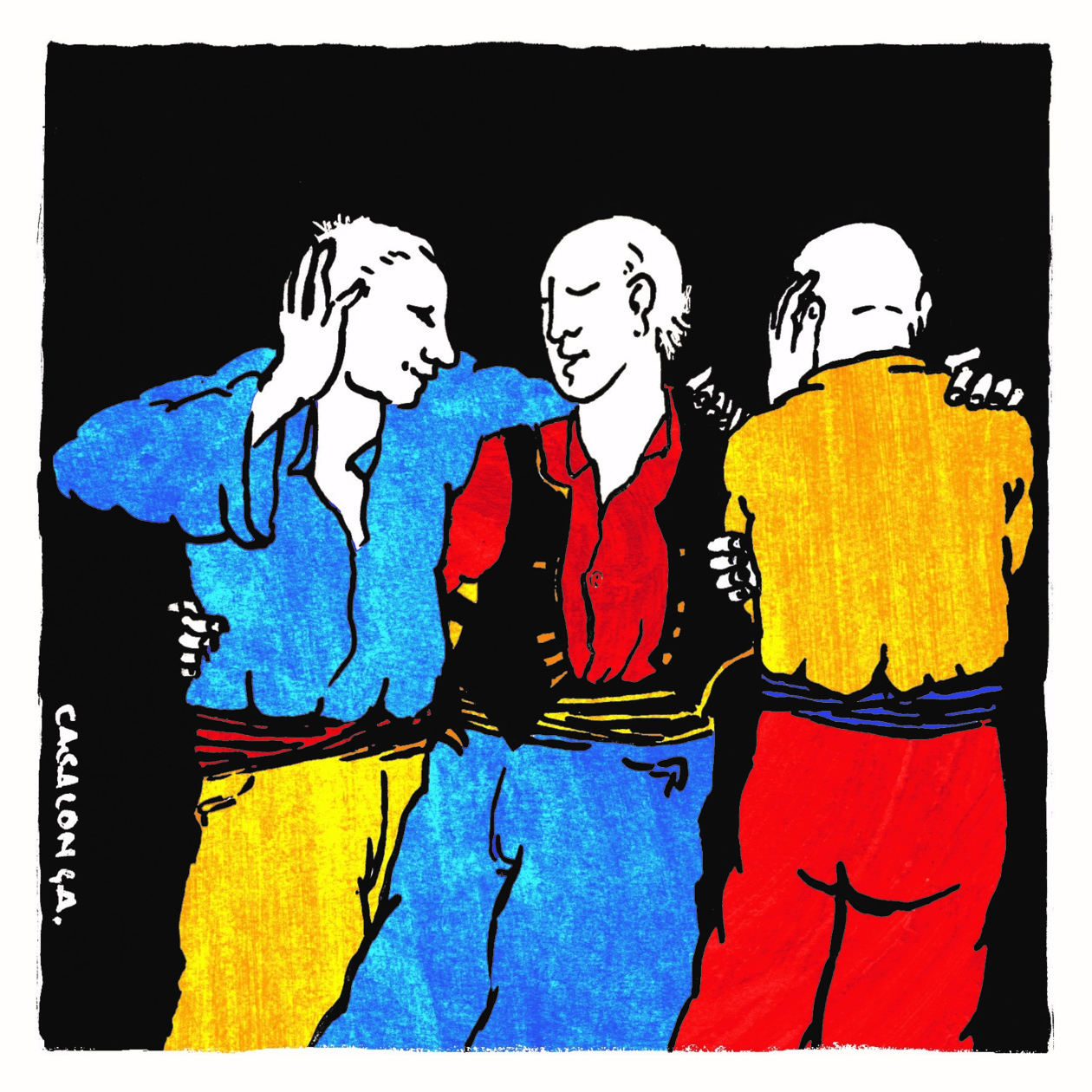Avoir affirmé, voici plus de trente ans, que la tradition n’était plus la même [1] n’a pas suffi à régler le problème. Bien au contraire, le débat est plus que jamais passionné, surtout lorsqu’il s’agit de musique, puisque s’est greffé le groupe culturel. L’inscription du cantu in paghjella sur la liste de sauvegarde d’urgence de l’Unesco [2] en est la preuve. Au lieu de voir dans cet event l’occasion d’affronter le maillage de questionnements à propos de la tradition, du patrimoine et de l’identité, du rôle politique de l’Institution, du poids considérable des médias, ou encore de compléter nos savoirs sur la polyphonie orale, il a déclenché une vague de contestations virulentes à l’encontre du dossier. Incompréhension et polémique, attitudes équivoques de certains conseillers territoriaux, tout ceci a largement hypothéqué le devenir de l’entreprise, en a empêché la réalisation [3].
Autrement dit, la tradition continuait à diviser et cela était prévisible. Il est peut-être temps aujourd’hui, presque quinze ans après, de faire un point à la fois sur l’intention qui a soutenu le projet et sur les attaques dont il a été l’objet. Mais le cadre restreint de ce texte n’en autorise que l’exposé succinct de l’historique, alors qu’il a révélé un mécanisme anthropologique profond de la société corse.
Autrement dit, la tradition continuait à diviser et cela était prévisible. Il est peut-être temps aujourd’hui, presque quinze ans après, de faire un point à la fois sur l’intention qui a soutenu le projet et sur les attaques dont il a été l’objet. Mais le cadre restreint de ce texte n’en autorise que l’exposé succinct de l’historique, alors qu’il a révélé un mécanisme anthropologique profond de la société corse.
[1] Lenclud G., 1987, « La tradition n’est plus ce qu’elle était », Terrain n° 9.
[2] La proclamation a été faite à Abou Dhabi en décembre 2009, en l’absence du représentant de la France.
[3] Hormis quelques ateliers d’apprentissage de a paghjella, aucune recherche n’a abouti. Les secondes journées d’étude prévues les 24-25/09/ 2010, Héritage intangible ou patrimoine immatériel ? Transmettre, oui, mais comment ?, en présence de Koïchiro Matsuura, ancien Directeur général de l’Unesco, ont dû être annulées.
Questions de légitimité
Rappelons d’abord qu’en 2005 a été adoptée, à l’unanimité par l’Assemblée de Corse, la demande de reconnaissance par l’Unesco d’une forme chantée dite traditionnelle, la polyphonie, initiative formulée par deux acteurs du riacquistu, Petru Guelfucci et Jean-Paul Poletti. Pour eux, sans doute, le prestigieux label Unesco légitimait le choix de a paghjella comme symbole des revendications de l’époque. Inscrite dans la Charte de l’Unesco par la Convention du 17/10/2003 (ratifiée par la France en 2006), apparaissait la nouvelle notion de patrimoine immatériel (traduction française d’intangible heritage) et le processus de patrimonialisation, que nous connaissons bien désormais, se mettait en place. Afin de poursuivre la démarche et de l’ouvrir sur la question fondamentale du devenir des traditions populaires, le Centre de Musiques Traditionnelles de Corse a organisé, en 2006, avec le soutien actif de la Collectivité territoriale de Corse et de la mairie d’Ajaccio, le Colloque La polyphonie corse traditionnelle peut-elle disparaître ? [1]
Pour les organisateurs, celui-ci devait constituer l’assise théorique d’une éventuelle politique culturelle à mettre en œuvre par la région Corse. La ratification de la Convention permettait de dégager les patrimoines du champ exclusif de l’Ethnologie et des Universités, et encourageait la création d’ un terrain commun de travail sur le sujet avec les acteurs culturels, en somme la société civile. De plus, il soulignait l’aspect international du problème de par le choix des intervenants. Bien évidemment, chaque nation s’interroge sur son patrimoine culturel, naturel, matériel ou immatériel, et ce constat internationalisait la réflexion tout en déterritorialisant les solutions à venir et à inventer.
Pour les organisateurs, celui-ci devait constituer l’assise théorique d’une éventuelle politique culturelle à mettre en œuvre par la région Corse. La ratification de la Convention permettait de dégager les patrimoines du champ exclusif de l’Ethnologie et des Universités, et encourageait la création d’ un terrain commun de travail sur le sujet avec les acteurs culturels, en somme la société civile. De plus, il soulignait l’aspect international du problème de par le choix des intervenants. Bien évidemment, chaque nation s’interroge sur son patrimoine culturel, naturel, matériel ou immatériel, et ce constat internationalisait la réflexion tout en déterritorialisant les solutions à venir et à inventer.
[1] La polyphonie corse traditionnelle peut-elle disparaître ?, 2008. Actes du Colloque sous la direction de M. Guelfucci et D. Salini, Editions Dumane.
Questions de stratégie
Deux types de candidature auprès de l’Unesco étaient possibles : une inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, simple reconnaissance d’une spécificité régionale française, et une inscription sur la liste de sauvegarde d’urgence. Seule la seconde, comme acte de souveraineté nationale, permettait de mener à bien le projet et de financer un programme conçu en deux volets : valoriser la transmission par la mise en place d’ateliers, et développer la recherche avec l’organisation de journées d’études et de séminaires internationaux. La forme polyphonie étant relativement rare en Méditerranée, cela aurait permis, par exemple, de compléter la cartographie des polyphonies de tradition orale en Méditerranée, en pointant la complexité de leurs histoires croisées.
D’abord la démarche a surpris. Le succès médiatique, international, des polyphonies corses était devenu la preuve de vitalité de la tradition. Sans réaliser que nous étions passés, justement au moment du riacquistu et de la très forte attraction de la scène, de fà si una paghjella aux polyphonies corses, la demande était incompréhensible. S’est immédiatement ravivée une multitude de questions, esquivées dans la précipitation euphorique du riacquistu, en particulier celles autour de la tradition. Et d’emblée se révélait toute l’ambiguïté du vocable, ce bien commun qui appartient, à la fois, à tous et à personne en particulier. La tradition serait cet ensemble non identifié de « tout ce qui remonte à la nuit des temps », dans lequel puisent les sociétés pour construire leurs histoires contemporaines. Elle renverrait à ce que m’apprend le passé et que je répète à mon tour. En somme, un héritage sans testament (R. Char) que l’on ne peut pas refuser et que l’on est dans l’obligation de transmettre, sans consignes, à tour de rôle.
Une fois décidé le type de candidature, il convenait d’élaborer le dossier, évidemment à partir de la tradition. Qu’est-ce qui est traditionnel et ne l’est pas ? Il fallait faire un choix, nécessairement arbitraire. Pour le corpus de référence, s’est tout naturellement imposé le premier collectage (1948) réalisé en Corse, le fonds Quilici, dans lequel étaient, sans doute, privilégiés i versi de Rusiu et de Sermanu [1]. De fait, ceux-ci étaient devenus traditionnels, parangons pour la transmission de la tradition. C’était déjà un parti-pris, mais ce cas particulier illustrait en même temps le poids politique des archives sonores et le rôle impérialiste de l’Institution. Désormais entreposé au Musée d’Anthropologie de la Corse, à Corti, ce fonds avait montré, de par son histoire, à quel point la culture d’un peuple est un enjeu des pouvoirs, et la législation sur les archives contraignante. Chanter sa musique ne veut pas dire que celle-ci est vôtre. Vous êtes l’informateur et l’enquêteur. Celui qui est missionné par une institution, genre ATP ou CNRS, doit déposer les enregistrements. Beaucoup d’entre nous ne sont jamais entendus.
D’abord la démarche a surpris. Le succès médiatique, international, des polyphonies corses était devenu la preuve de vitalité de la tradition. Sans réaliser que nous étions passés, justement au moment du riacquistu et de la très forte attraction de la scène, de fà si una paghjella aux polyphonies corses, la demande était incompréhensible. S’est immédiatement ravivée une multitude de questions, esquivées dans la précipitation euphorique du riacquistu, en particulier celles autour de la tradition. Et d’emblée se révélait toute l’ambiguïté du vocable, ce bien commun qui appartient, à la fois, à tous et à personne en particulier. La tradition serait cet ensemble non identifié de « tout ce qui remonte à la nuit des temps », dans lequel puisent les sociétés pour construire leurs histoires contemporaines. Elle renverrait à ce que m’apprend le passé et que je répète à mon tour. En somme, un héritage sans testament (R. Char) que l’on ne peut pas refuser et que l’on est dans l’obligation de transmettre, sans consignes, à tour de rôle.
Une fois décidé le type de candidature, il convenait d’élaborer le dossier, évidemment à partir de la tradition. Qu’est-ce qui est traditionnel et ne l’est pas ? Il fallait faire un choix, nécessairement arbitraire. Pour le corpus de référence, s’est tout naturellement imposé le premier collectage (1948) réalisé en Corse, le fonds Quilici, dans lequel étaient, sans doute, privilégiés i versi de Rusiu et de Sermanu [1]. De fait, ceux-ci étaient devenus traditionnels, parangons pour la transmission de la tradition. C’était déjà un parti-pris, mais ce cas particulier illustrait en même temps le poids politique des archives sonores et le rôle impérialiste de l’Institution. Désormais entreposé au Musée d’Anthropologie de la Corse, à Corti, ce fonds avait montré, de par son histoire, à quel point la culture d’un peuple est un enjeu des pouvoirs, et la législation sur les archives contraignante. Chanter sa musique ne veut pas dire que celle-ci est vôtre. Vous êtes l’informateur et l’enquêteur. Celui qui est missionné par une institution, genre ATP ou CNRS, doit déposer les enregistrements. Beaucoup d’entre nous ne sont jamais entendus.
[1] Il ne faut évidemment pas oublier le rôle de J. Chailley et du Père Danielou.
La tradition, mais laquelle?
Ceci dit, il ne suffit pas de décréter qu’une tradition appartient au peuple. Elle a aussi servi d’alibi pour la scène, elle est même devenue un sésame dans la grande entreprise commerciale de l’industrie culturelle internationale. Et parce qu’un bien commun ne se monnaie pas, c’est moins un désir de valorisation patrimoniale qu’avait révélé l’occupation de la SACEM (1981) que la volonté d’affirmer la création, autre notion floue, qui seule permettait la propriété intellectuelle et l’accès au droit d’auteur.
La sélection du fonds Quilici, déjà restreinte par le type de dossier, a obligatoirement écarté de nombreux échantillons. Et parce qu’en Corse, peut-être plus qu’ailleurs, la question patrimoniale est presque toujours envisagée de manière doloriste, sentimentale et émotionnelle, nostalgique dit B. Cassin, ceci a exacerbé la polémique. Avoir ou ne pas avoir été consulté lors de l’élaboration du projet était devenu un indice de reconnaissance ou non de sa propre traditionnalité, de son appartenance ou pas à l’histoire de la Corse. L’idée que l’institution -ou la récompense- accorde une légitimité a généré des frustrations, l’invidia aussi, et enfin, probablement le fait que le dossier ait été porté par deux femmes, ont fait de cet event un cas d’école qu’il conviendrait d’analyser sous l’angle anthropologique et non sous celui, exclusif, de l’émotion et du pathos.
La sélection du fonds Quilici, déjà restreinte par le type de dossier, a obligatoirement écarté de nombreux échantillons. Et parce qu’en Corse, peut-être plus qu’ailleurs, la question patrimoniale est presque toujours envisagée de manière doloriste, sentimentale et émotionnelle, nostalgique dit B. Cassin, ceci a exacerbé la polémique. Avoir ou ne pas avoir été consulté lors de l’élaboration du projet était devenu un indice de reconnaissance ou non de sa propre traditionnalité, de son appartenance ou pas à l’histoire de la Corse. L’idée que l’institution -ou la récompense- accorde une légitimité a généré des frustrations, l’invidia aussi, et enfin, probablement le fait que le dossier ait été porté par deux femmes, ont fait de cet event un cas d’école qu’il conviendrait d’analyser sous l’angle anthropologique et non sous celui, exclusif, de l’émotion et du pathos.