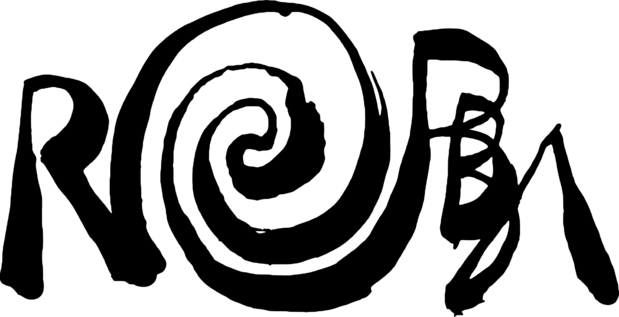En 2014, à l’invitation de l’Association de la cause freudienne, j’avais présenté une analyse personnelle du phénomène récurrent de la violence en Corse. En tant que doyen de la faculté des lettres, j’avais malheureusement vécu en 2010 la tragédie de la mort d’Antoine Casanova, étudiant en deuxième année d’italien : je l’avais ressentie d’autant plus durement que, d’une part, le malheur s’abattait sur la famille de la victime, sur celle de son jeune agresseur et sur la communauté universitaire, d’autre part, cet acte ruinait d’une certaine façon la conception que je pouvais me faire des fins de l’éducation dans une société démocratique et du rôle multiple de l’université au sein d’une région périphérique, longtemps assignée à résidence du point de vue de ses possibilités d’accès au savoir et à des formations de haut niveau.
Fin décembre 2024, comme une sorte d’implacable retour du même, la rixe meurtrière survenue dans un établissement connu d’Ajaccio a, selon l’analyse de Jean-Louis Fabiani (Corse Matin du 2 janvier 2025), brisé le moment d’unité vécu à l’occasion de la venue du pape François, qui plus est en pleine fête de Noël. Le Président Simeoni, dans la même édition, pose quant à lui la question suivante : « Comment la Corse peut-elle, à une semaine d’intervalle, offrir au monde le visage d’une terre de ferveur et de paix, et être à nouveau rattrapée par ses pires démons ? »
Je dois par honnêteté intellectuelle, indiquer la dimension subjective de la réflexion que je propose ici : il faut la considérer davantage comme une sorte d’essai que comme un travail au sens universitaire du terme, même si je me suis efforcé d’en respecter les canons.
Fin décembre 2024, comme une sorte d’implacable retour du même, la rixe meurtrière survenue dans un établissement connu d’Ajaccio a, selon l’analyse de Jean-Louis Fabiani (Corse Matin du 2 janvier 2025), brisé le moment d’unité vécu à l’occasion de la venue du pape François, qui plus est en pleine fête de Noël. Le Président Simeoni, dans la même édition, pose quant à lui la question suivante : « Comment la Corse peut-elle, à une semaine d’intervalle, offrir au monde le visage d’une terre de ferveur et de paix, et être à nouveau rattrapée par ses pires démons ? »
Je dois par honnêteté intellectuelle, indiquer la dimension subjective de la réflexion que je propose ici : il faut la considérer davantage comme une sorte d’essai que comme un travail au sens universitaire du terme, même si je me suis efforcé d’en respecter les canons.
Les formes de la violence en Corse
Selon Sampiero Sanguinetti, il existe trois formes de violence en Corse : « la violence crapuleuse des groupes affairistes et d’une certaine pègre, la violence politique qui n’est pas simplement la violence assumée par des mouvements nationalistes, et […] la violence ordinaire » [1].
Du point de vue de cette dernière, je dois dire qu’en tant que personne, j’ai depuis mon enfance été marqué, dans mon village d’origine, pour ne pas dire « au village », par une certaine forme d’agressivité et de tension dans les relations sociales, notamment à l’occasion des élections municipales et cantonales. Celle-ci avait pour caractéristique de contribuer à la structuration des relations entre les personnes, singulièrement à travers les discours et les commentaires qu’elle générait. En tant qu’enfant, avec d’autres, j’ai ressenti parfois l’hostilité sourde ou latente de personnes âgées pour la raison que je n’appartenais pas « à leur parti ». Enfin j’ai aussi été marqué, dans l’usage parlé du corse, par des expressions hyperboliques, les imprécations en particulier, si courantes dans la conversation ordinaire, dont je ne comprenais pas la dimension symbolique et que j’entendais personnellement au premier degré dans une force et une puissance qui me terrifiaient. En voici trois exemples : « Tù scià cecu » : puisses-tu devenir aveugle ; « Tù scià manghjatu da i corbi » : puisses-tu être dévoré par les corbeaux ; ou encore « Tù pigliessi una falata è mai più compie » : puisses-tu chuter dans un abîme sans fond.
Tout cela ne peut manquer d’avoir eu une incidence dans ma construction identitaire. Vivant à la campagne depuis de nombreuse années, un choix conçu dans ma jeunesse, j’ai eu également l’occasion de me rendre compte, assez tardivement mais à plusieurs reprises que, dans les relations interpersonnelles, des gens ordinaires, généralement sociables, sans aucun antécédent judiciaire, pouvaient adopter des comportements et des propos qui non seulement brisaient brutalement les rituels de la communication [2] mais laissaient éventuellement surgir ponctuellement et brièvement violence physique et violence verbale d’ordre performatif.
À partir de mon expérience personnelle, j’ai décidé de m’intéresser à cette hybris qui semble frapper l’île depuis de nombreuses années en m’efforçant de la comprendre au sens sociologique du terme : derrière des conduites à l’opposé des règles de vie en société, une logique collective se dissimulerait-elle et si oui, pourrait-on tenter d’en comprendre les ressorts ?
Le 6 mai 2013, Manuel Valls intervenait en tant que ministre de l’Intérieur sur les ondes de France Inter. Dans son dialogue avec une auditrice insulaire, s’exprimant à propos de la gîte mortifère provoquée par le banditisme, à l’époque, il n’hésita pas à parler d’une violence « enracinée dans la culture corse » (sic). Cette naturalisation du phénomène, qui avait interloqué Patrick Cohen, l’animateur de l’émission, comportait sa dose de stéréotype, pour ne pas dire de racisme décomplexé. Pourtant, le ministre n’avait peut-être pas complètement tort, quand bien même il se trompait en essentialisant cette violence en tant que trait distinctif définitif d’une communauté.
Pour aller plus loin, j’avais porté mon regard sur celle que Sanguinetti qualifiait plutôt d’ordinaire : si elle n’intéresse guère les médias, si elle apparaît peu visible, peu repérable, elle n’en demeure pas moins bien présente et préoccupante. L’hypothèse que je formule à l’égard de celle-ci est que, par sa vivacité et sa rémanence, elle constitue le soubassement permanent et discret des deux autres, celle de droit commun et celle politique, et qu’elle participe d’une forme d’instabilité dans le fonctionnement social quotidien de l’île.
Du point de vue de cette dernière, je dois dire qu’en tant que personne, j’ai depuis mon enfance été marqué, dans mon village d’origine, pour ne pas dire « au village », par une certaine forme d’agressivité et de tension dans les relations sociales, notamment à l’occasion des élections municipales et cantonales. Celle-ci avait pour caractéristique de contribuer à la structuration des relations entre les personnes, singulièrement à travers les discours et les commentaires qu’elle générait. En tant qu’enfant, avec d’autres, j’ai ressenti parfois l’hostilité sourde ou latente de personnes âgées pour la raison que je n’appartenais pas « à leur parti ». Enfin j’ai aussi été marqué, dans l’usage parlé du corse, par des expressions hyperboliques, les imprécations en particulier, si courantes dans la conversation ordinaire, dont je ne comprenais pas la dimension symbolique et que j’entendais personnellement au premier degré dans une force et une puissance qui me terrifiaient. En voici trois exemples : « Tù scià cecu » : puisses-tu devenir aveugle ; « Tù scià manghjatu da i corbi » : puisses-tu être dévoré par les corbeaux ; ou encore « Tù pigliessi una falata è mai più compie » : puisses-tu chuter dans un abîme sans fond.
Tout cela ne peut manquer d’avoir eu une incidence dans ma construction identitaire. Vivant à la campagne depuis de nombreuse années, un choix conçu dans ma jeunesse, j’ai eu également l’occasion de me rendre compte, assez tardivement mais à plusieurs reprises que, dans les relations interpersonnelles, des gens ordinaires, généralement sociables, sans aucun antécédent judiciaire, pouvaient adopter des comportements et des propos qui non seulement brisaient brutalement les rituels de la communication [2] mais laissaient éventuellement surgir ponctuellement et brièvement violence physique et violence verbale d’ordre performatif.
À partir de mon expérience personnelle, j’ai décidé de m’intéresser à cette hybris qui semble frapper l’île depuis de nombreuses années en m’efforçant de la comprendre au sens sociologique du terme : derrière des conduites à l’opposé des règles de vie en société, une logique collective se dissimulerait-elle et si oui, pourrait-on tenter d’en comprendre les ressorts ?
Le 6 mai 2013, Manuel Valls intervenait en tant que ministre de l’Intérieur sur les ondes de France Inter. Dans son dialogue avec une auditrice insulaire, s’exprimant à propos de la gîte mortifère provoquée par le banditisme, à l’époque, il n’hésita pas à parler d’une violence « enracinée dans la culture corse » (sic). Cette naturalisation du phénomène, qui avait interloqué Patrick Cohen, l’animateur de l’émission, comportait sa dose de stéréotype, pour ne pas dire de racisme décomplexé. Pourtant, le ministre n’avait peut-être pas complètement tort, quand bien même il se trompait en essentialisant cette violence en tant que trait distinctif définitif d’une communauté.
Pour aller plus loin, j’avais porté mon regard sur celle que Sanguinetti qualifiait plutôt d’ordinaire : si elle n’intéresse guère les médias, si elle apparaît peu visible, peu repérable, elle n’en demeure pas moins bien présente et préoccupante. L’hypothèse que je formule à l’égard de celle-ci est que, par sa vivacité et sa rémanence, elle constitue le soubassement permanent et discret des deux autres, celle de droit commun et celle politique, et qu’elle participe d’une forme d’instabilité dans le fonctionnement social quotidien de l’île.
[1] La violence en Corse XIXe-XXe siècles, 2010, Ajaccio, Albiana, p. 17.
[2] Ervin Goffman, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit.
Sur la violence « naturelle » des Corses : de la nature humaine
La violence fait partie intégrante de la nature humaine, elle est à l’origine du pouvoir. La scène des grands singes, dans le prologue du film 2000 ans Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick, en constitue une métaphore saisissante. Il faut se rendre à la raison : l’idéal rousseauiste de l’homme naturellement bon, corrompu par la société dans laquelle il est élevé, je schématise sans doute un peu, a bel et bien vécu. Tout d’abord, sur un plan théorique, Norbert Elias nous apprend que « la société sans individu et l’individu sans société sont deux choses qui n’existent pas » [1] : cela signifie qu’historiquement, l’une n’a pu aller sans l’autre, que donc si, à l’origine, était le verbe, à l’origine aussi était la violence puisque celle-ci, mettant en confrontation au moins deux individus, comporte par essence une dimension sociale.
Freud parle de la présence en l’homme d’une « ambivalence affective » (1915 : 11) [2] engendrée par l’existence de « penchants primitifs » (ibid.), mauvais par nature (l’égoïsme, la cruauté) que la société, par la culture et l’éducation, tente de contenir et de canaliser. L’envie, telle que la définit Mélanie Klein (1968) [3], correspond au désir premier d’appropriation vorace d’un objet (le sein maternel), dans le cadre de la pulsion de mort freudienne : une corrélation existe me semble-t-il ici avec a invidia, que l’on conjure par la prière de l’ochju.
Cette invidia dépasse largement l’idée même de jalousie : non seulement elle l’inclut mais elle suppose aussi l’idée d’appropriation de l’autre à travers la qualité dont on lui attribue la possession et que l’on considère ne pas avoir soi-même. Pour José Gil (1984) « L’envie est une force qui agit en deux sens contraires : elle tend à assimiler, à incorporer son objet, et elle tend aussi à le détruire » [4]. Si l’on vit ici depuis longtemps, que l’on maîtrise un tant soit peu les codes culturels en vigueur, on peut en saisir les manifestations à la fois furtives et radicales à travers une attitude, une façon de porter son regard sur l’autre, une certaine intonation et un non-dit difficilement refoulé.
Freud parle de la présence en l’homme d’une « ambivalence affective » (1915 : 11) [2] engendrée par l’existence de « penchants primitifs » (ibid.), mauvais par nature (l’égoïsme, la cruauté) que la société, par la culture et l’éducation, tente de contenir et de canaliser. L’envie, telle que la définit Mélanie Klein (1968) [3], correspond au désir premier d’appropriation vorace d’un objet (le sein maternel), dans le cadre de la pulsion de mort freudienne : une corrélation existe me semble-t-il ici avec a invidia, que l’on conjure par la prière de l’ochju.
Cette invidia dépasse largement l’idée même de jalousie : non seulement elle l’inclut mais elle suppose aussi l’idée d’appropriation de l’autre à travers la qualité dont on lui attribue la possession et que l’on considère ne pas avoir soi-même. Pour José Gil (1984) « L’envie est une force qui agit en deux sens contraires : elle tend à assimiler, à incorporer son objet, et elle tend aussi à le détruire » [4]. Si l’on vit ici depuis longtemps, que l’on maîtrise un tant soit peu les codes culturels en vigueur, on peut en saisir les manifestations à la fois furtives et radicales à travers une attitude, une façon de porter son regard sur l’autre, une certaine intonation et un non-dit difficilement refoulé.
[1] Norbert Elias, 1991, La société des individus, Paris, Fayard, p. 117.
[2] Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, publié dans l’ouvrage Essais de psychanalyse, publié en version électronique dans le cadre de la collection : "Les classiques des sciences sociales", fondée dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi.
[3] Envie et gratitude et autres essais, 1978, Paris, Gallimard.
[4] La Corse entre la liberté et la terreur, 1984, Paris, Essais Editions de la différence, p. 28.
La violence en Corse : la lutte de tous contre tous
La Corse est notoirement connue pour son taux d’homicides au XIXe siècle, principalement en raison de la vendetta, dont Mérimée a fait un topos littéraire. Mais les statistiques, très élevées par rapport à la moyenne européenne, nous situent au début des années 2000 au niveau des outre-mer. Cette unité dans l’éclatement géographique semble invalider l’hypothèse d’une Méditerranée mafieuse « par nature et par excellence » [1] selon la vision de Nicolas Giudici [2].
Ceci m’avait conduit à penser qu’il fallait mobiliser d’autres statistiques de nature économique et sociale pour tenter d’éclairer le phénomène. Or celles-ci attestent un différentiel négatif en matière de taux de pauvreté, de taux d’IVG, de pourcentage de familles monoparentales, de sorties précoces du système éducatif. Enfin, on sait que l’économie de la Corse repose pour une large part sur le tourisme et que ce dernier génère une forte spéculation sur le foncier. Celle-ci alimente notoirement une guerre ouverte pour la conquête de parts substantielles de marché.
Ainsi on comprend aisément pourquoi une explication culturelle stricto sensu, telle que l’avançait Manuel Valls en 2013 apparaissait tout de même un peu courte… Pour autant, il faut avoir à l’esprit que l’exercice de la violence fonctionne aussi comme mode ordinaire de régulation des conflits internes tout au long de l’histoire et particulièrement du XVIe au XVIIIe siècles selon Antoine-Marie Graziani [3].
L’esprit de faction, issu d’une organisation familiale endogène, dans une société marquée par le manque et la précarité, repose sur l’exercice de la violence « comme une condition nécessaire à sa survie » (Graziani, 2011 : 332). Générant une tension permanente entre les individus et les groupes, il va trouver à se redéployer sous la forme du clanisme politique à partir de la IIIe République, notamment lorsque l’accès à la jouissance des terres communales devient l’enjeu non-dit mais réel du pouvoir municipal. Si l’on devait résumer d’un trait la situation de la société corse jusqu’à la fin du XIXe siècle et même au-delà, on pourrait affirmer qu’elle correspond assez bien à la vision de Hobbes, selon laquelle la société repose sur la lutte de tous contre tous.
Ceci m’avait conduit à penser qu’il fallait mobiliser d’autres statistiques de nature économique et sociale pour tenter d’éclairer le phénomène. Or celles-ci attestent un différentiel négatif en matière de taux de pauvreté, de taux d’IVG, de pourcentage de familles monoparentales, de sorties précoces du système éducatif. Enfin, on sait que l’économie de la Corse repose pour une large part sur le tourisme et que ce dernier génère une forte spéculation sur le foncier. Celle-ci alimente notoirement une guerre ouverte pour la conquête de parts substantielles de marché.
Ainsi on comprend aisément pourquoi une explication culturelle stricto sensu, telle que l’avançait Manuel Valls en 2013 apparaissait tout de même un peu courte… Pour autant, il faut avoir à l’esprit que l’exercice de la violence fonctionne aussi comme mode ordinaire de régulation des conflits internes tout au long de l’histoire et particulièrement du XVIe au XVIIIe siècles selon Antoine-Marie Graziani [3].
L’esprit de faction, issu d’une organisation familiale endogène, dans une société marquée par le manque et la précarité, repose sur l’exercice de la violence « comme une condition nécessaire à sa survie » (Graziani, 2011 : 332). Générant une tension permanente entre les individus et les groupes, il va trouver à se redéployer sous la forme du clanisme politique à partir de la IIIe République, notamment lorsque l’accès à la jouissance des terres communales devient l’enjeu non-dit mais réel du pouvoir municipal. Si l’on devait résumer d’un trait la situation de la société corse jusqu’à la fin du XIXe siècle et même au-delà, on pourrait affirmer qu’elle correspond assez bien à la vision de Hobbes, selon laquelle la société repose sur la lutte de tous contre tous.
[1] Sanguinetti, 2010 : 15.
[2] Le crépuscule des Corses, 1997, Paris, Grasset.
[3] La violence dans les campagnes corses du XVIe au XVIIIe siècle, 2011, Ajaccio, Alain Piazzola.
Pour une approche sociologique et anthropologique de la violence
L’état de tension quasi permanent qui traverse les communautés et innerve leur vie au quotidien ne peut pas manquer de retentir sur la psychologie collective. Et ceci me conduit à présent à solliciter les travaux de Norbert Elias, particulièrement l’ouvrage intitulé La civilisation des mœurs (1973) [1], publié pour la première fois en 1939. L’auteur y déploie son concept fondamental de processus de civilisation.
On ne peut s’appesantir ici sur une analyse qui mériterait d’autres développements. Disons pour synthétiser que les sociétés européennes ont connu une dynamique civilisationnelle qui a généré « une interdépendance étroite entre structures sociales et structures émotionnelles » (1973 : 440).
Pour Elias, notre subjectivité individuelle et collective s’est construite au fil des siècles, nous ne sommes que l’aboutissement provisoire du capital d’expérience accumulé par l’humanité dans un espace-temps donné, l’Europe. Pour en faire la démonstration, Elias étudie plusieurs champs :
On ne peut s’appesantir ici sur une analyse qui mériterait d’autres développements. Disons pour synthétiser que les sociétés européennes ont connu une dynamique civilisationnelle qui a généré « une interdépendance étroite entre structures sociales et structures émotionnelles » (1973 : 440).
Pour Elias, notre subjectivité individuelle et collective s’est construite au fil des siècles, nous ne sommes que l’aboutissement provisoire du capital d’expérience accumulé par l’humanité dans un espace-temps donné, l’Europe. Pour en faire la démonstration, Elias étudie plusieurs champs :
- les manières de table
- la gestion des fonctions naturelles
- la gestion des relations sexuelles
- le langage
- les modifications de l’agressivité.
Tout ce qui relève de ces catégories a fait l’objet d’un long travail de la société sur elle-même. Ainsi a-t-il dépouillé les nombreux traités de bienséance, publiés en Europe à la Renaissance : tous convergent dans la définition d’une éducation formelle dans les mœurs de table et la gestion des fonctions naturelles, voire des fonctions sexuelles. Ils conduisent à une ritualisation de la vie quotidienne et contribuent à l’élaboration d’une sorte d’économie des pulsions.
À l’origine de cette production se trouve un processus qui, prenant naissance dans les cours seigneuriales, se développe historiquement en trois phases :
- une phase médiévale, dans laquelle on mange encore avec les mains ; celle-ci correspond à la présence et au triomphe de la chevalerie
- une phase curiale, durant laquelle, en France, dans un premier temps, les cours seigneuriales provinciales s’effondrent au bénéfice de la cour royale : une pression s’y exerce sur tous quant à l’évolution des mœurs de tables, sexuelles, langagières ; dans un second temps se produit une ouverture de la Cour aux hautes sphères de la bourgeoisie, à son tour acquise à la nouvelle subjectivité collective ; une homogénéisation progressive de la sensibilité collective se produit entre les deux sphères sociales par embourgeoisement de la noblesse et curialisation de la haute bourgeoisie (la production du théâtre classique français en fournit un bon exemple)
- une phase post-curiale d’expansion économique et politique de la bourgeoisie, qui diffuse sa sensibilité dans l’ensemble de la société ; celle-ci devient alors l’un des éléments indispensables de l’ascension sociale.
[1] Elias Norbert, 1973, La civilisation des mœurs, Paris, Calmann Lévy.
Elias et la Corse
Mais quelle relation faire alors entre Elias et la Corse ? En effet, les manières de table, la gestion des fonctions naturelles et sexuelles font partie du patrimoine commun européen et rien ne distingue un Corse d’un autre citoyen de l’Union de ce point de vue.
Vient alors la question de la gestion de l’agressivité, la dernière des catégories envisagées par l’auteur. Voici ce qu’il écrit à son propos : « Les vengeances familiales, les guerres privées, les vendettas n’étaient pas réservées aux nobles ; les villes du XVe siècle retentissaient également du vacarme des guerres entre familles et clans ennemis. Les bourgeois, les petites gens, les fabricants de bonnets, les bergers tiraient facilement le couteau » (1973 : 437). Cela signifie qu’en Europe sévissait alors une violence endémique et banale.
En ce qui concerne la Corse, on peut voir ainsi comment s’opère un processus de différenciation anthropologique et sociologique : cette violence au quotidien commence à refluer à partir de la Renaissance, elle a disparu pour ainsi dire à la fin du XVIIIe siècle tandis que la vendetta dure et perdure en Corse durant tout le XIXe.
Allons un peu plus loin dans la réflexion : la violence physique se traduit par des actes, mais bien souvent elle ne constitue que l’aboutissement d’un processus d’animosité et d’excitation pouvant relever, lui, de la violence ordinaire. Gestes déplacés, mots et discours malveillants et actions indirectes de même nature peuvent constituer alors le matériau d’une capitalisation plus ou moins rapide de l’agressivité latente ou ouverte. Le passage à l’acte a besoin d’un environnement cumulatif, dans le cadre des tensions entre familles. De ce point de vue, la violence ordinaire joue un rôle capital.
Vient alors la question de la gestion de l’agressivité, la dernière des catégories envisagées par l’auteur. Voici ce qu’il écrit à son propos : « Les vengeances familiales, les guerres privées, les vendettas n’étaient pas réservées aux nobles ; les villes du XVe siècle retentissaient également du vacarme des guerres entre familles et clans ennemis. Les bourgeois, les petites gens, les fabricants de bonnets, les bergers tiraient facilement le couteau » (1973 : 437). Cela signifie qu’en Europe sévissait alors une violence endémique et banale.
En ce qui concerne la Corse, on peut voir ainsi comment s’opère un processus de différenciation anthropologique et sociologique : cette violence au quotidien commence à refluer à partir de la Renaissance, elle a disparu pour ainsi dire à la fin du XVIIIe siècle tandis que la vendetta dure et perdure en Corse durant tout le XIXe.
Allons un peu plus loin dans la réflexion : la violence physique se traduit par des actes, mais bien souvent elle ne constitue que l’aboutissement d’un processus d’animosité et d’excitation pouvant relever, lui, de la violence ordinaire. Gestes déplacés, mots et discours malveillants et actions indirectes de même nature peuvent constituer alors le matériau d’une capitalisation plus ou moins rapide de l’agressivité latente ou ouverte. Le passage à l’acte a besoin d’un environnement cumulatif, dans le cadre des tensions entre familles. De ce point de vue, la violence ordinaire joue un rôle capital.
La violence ordinaire : une régression problématique
Or, je reviens à mon hypothèse initiale, cette violence n’a pas disparu et ne pourra régresser que difficilement. Pourquoi ?
Je voudrais d’abord en donner quelques exemples que j’ai pu vivre de manière directe ou indirecte. Un vieil oncle, aujourd’hui décédé, m’a rapporté une anecdote relative à sa propre jeunesse, avant la guerre de 14-18. Descendant « à la plaine », il est interpelé par un homme mûr qui lui tient des propos blessants. L’un et l’autre passent leur chemin, mon oncle n’accepte pas ce qu’il a entendu. Il est armé, fait assez banal à l’époque. Le soir, en remontant au village, il l’attend à un point où il pense le croiser de nouveau. « Ce soir-là, s’il était passé, j’aurais tiré », m’a-t-il déclaré. Vrai ou faux, peu importe : ce qui compte, me semble-t-il, c’est la dimension performative de l’assertion. À l’évidence, le tabou social de la violence légitime n’a pas fonctionné, dans le discours au moins. Il faut savoir que ce monsieur, très respectable au demeurant, a effectué par la suite une brillante carrière de fonctionnaire à Paris.
Assez récemment un ami a fait l’objet d’une tentative de strangulation, précédée d’un chapelet d’injures, pour un problème de passage de tout-à-l’égout, a priori assez facile à résoudre. L’agresseur était une personne de son propre village, qui est son voisin et qu’il connaît depuis toujours. Voici un autre fait : dans la région où j’habite, un jeune berger a carrément roué de coups une dame qui lui reprochait la présence réitérée de ses chèvres dans son jardin. Une vieille dame m’a dit, en confiance, que son mari n’avait qu’à faire « ce qu’il fallait », ni vu ni connu. Les propos me semblent aussi préoccupants, par leur violence performative, que les faits eux-mêmes. Il faut savoir que le père de cette vieille dame avait souffert d’une blessure à la tête subie en 14-18 et avait tué un de ses amis dans un moment de délire…
Voici des faits, indécelables, invisibles mais qui vécus par les acteurs eux-mêmes en disent parfois long sur un certain état de l’économie affective en Corse, sans généraliser.
Je voudrais d’abord en donner quelques exemples que j’ai pu vivre de manière directe ou indirecte. Un vieil oncle, aujourd’hui décédé, m’a rapporté une anecdote relative à sa propre jeunesse, avant la guerre de 14-18. Descendant « à la plaine », il est interpelé par un homme mûr qui lui tient des propos blessants. L’un et l’autre passent leur chemin, mon oncle n’accepte pas ce qu’il a entendu. Il est armé, fait assez banal à l’époque. Le soir, en remontant au village, il l’attend à un point où il pense le croiser de nouveau. « Ce soir-là, s’il était passé, j’aurais tiré », m’a-t-il déclaré. Vrai ou faux, peu importe : ce qui compte, me semble-t-il, c’est la dimension performative de l’assertion. À l’évidence, le tabou social de la violence légitime n’a pas fonctionné, dans le discours au moins. Il faut savoir que ce monsieur, très respectable au demeurant, a effectué par la suite une brillante carrière de fonctionnaire à Paris.
Assez récemment un ami a fait l’objet d’une tentative de strangulation, précédée d’un chapelet d’injures, pour un problème de passage de tout-à-l’égout, a priori assez facile à résoudre. L’agresseur était une personne de son propre village, qui est son voisin et qu’il connaît depuis toujours. Voici un autre fait : dans la région où j’habite, un jeune berger a carrément roué de coups une dame qui lui reprochait la présence réitérée de ses chèvres dans son jardin. Une vieille dame m’a dit, en confiance, que son mari n’avait qu’à faire « ce qu’il fallait », ni vu ni connu. Les propos me semblent aussi préoccupants, par leur violence performative, que les faits eux-mêmes. Il faut savoir que le père de cette vieille dame avait souffert d’une blessure à la tête subie en 14-18 et avait tué un de ses amis dans un moment de délire…
Voici des faits, indécelables, invisibles mais qui vécus par les acteurs eux-mêmes en disent parfois long sur un certain état de l’économie affective en Corse, sans généraliser.
Aux sources de la violence ordinaire
Tentons à présent d’expliquer les causes. La société rurale, l’étude d’Antoine-Marie Graziani le montre à l’envi, a donc connu une forme d’instabilité et de tension permanentes, se traduisant durant de longs siècles par une violence sociopolitique diffuse, qui aboutira notamment au processus révolutionnaire de la guerre de 40 ans au XVIIIe siècle.
Cette violence spécifique trouve à s’alimenter dans le terreau d’une tension et d’une agressivité verbales et non verbales, impossible à quantifier mais qui ne peut manquer d’exister comme source et comme instrument de préparation de la violence physique. Le développement des pratiques clanistes, à partir de la IIIe République, dans une société à base clanique, a contribué à entretenir une agressivité latente ou ouverte relevant de la violence ordinaire. Les rapports entre les individus reposant sur la force du groupe, chacun se sent dépositaire de la légitimité collective et chacun représente à la fois soi-même et les siens.
Donc, toute atteinte à un individu représente une atteinte au groupe, le premier et le second étant vécus comme peu différenciés. De plus, il ne faut sans doute pas mésestimer le rôle de l’invidia, dans des communautés où tout le monde se côtoie à longueur de journée. Cette fréquence des relations augmente, de fait, les risques de confrontation. Une autre explication, plus structurelle, peut aussi être mobilisée dans cette absence d’autolimitation de la violence et de l’agressivité.
Du fait de l’histoire singulière de la Corse et de son intégration tardive dans l’ensemble national, la bourgeoise insulaire n’a pas joué le rôle de la bourgeoisie nationale dans la phase post-curiale. Les élites locales, tout occupées qu'elles étaient de rejoindre l’élite nationale, n’ont pas cherché à exercer une influence au sens de celle dont parle Elias pour la cour embourgeoisée et la bourgeoisie curialisée. Quant à la bourgeoisie nationale, sortie victorieuse de la Révolution, elle était bien trop éloignée des réalités locales, surtout dans un cas aussi périphérique que celui de la Corse, pour tenter de dépasser le simple processus de captation des élites locales, qu’il lui suffisait de contrôler.
S’en est suivie, par voie de conséquence, une absence de diffusion par capillarité descendante d’une forme d’économie des pulsions, d’auto-contrôle de soi, largement imposée à la masse par l’éducation, par l’appel à l’ascension sociale individuelle et finalement intériorisée, dans la longue durée. Cela semble d’autant plus plausible que, Elias l’affirme, le processus de civilisation ne connaît pas forcément la linéarité, il ne se déploie jamais de façon univoque aux plans temporel et spatial pour telle ou telle société donnée.
Il faut avancer, pour terminer, une dernière réflexion. La Corse, société historiquement patrilinéaire, aux pratiques communautaires extrêmement poussées, a connu depuis sa véritable intégration à la France, sous la IIIe République, trois grands « idéaux-types » masculins. Selon Max Weber, l’idéal-type repose sur une sorte de synthèse-stylisation des conduites et des institutions sociales, il se traduit par une mise en icône d’attitudes génériques dans le comportement des acteurs sociaux et dans l’état des lois, des coutumes et des usages.
Le premier idéal-type est celui du « fonctionnaire », il concerne aussi les femmes : il s’est développé avec les besoins en employabilité générés par le développement de l’empire colonial, besoins qui ont constitué une solution durable à la résolution de la crise économique endémique que subissait alors l’île, avec un état de pauvreté généralisé. Le deuxième idéal-type est constitué par « le militaire », il est plus sexué : la tradition de mercenariat aux services des puissants de l’Europe relève d’une réalité multiséculaire, générée par le goût des armes, l’état de tension plus ou moins permanent régnant dans les communautés et entre elles et le poids d’une tradition belliqueuse. Enfin l’idéal-type du « gangster », archétype du virilisme et condensateur de toutes les formes potentielles de violence, qui s’est lui développé au XXe siècle avec l’expansion de la société industrielle et technologique.
Dans toutes les communes de l’île, hic et nunc, on peut opérer des regroupements d’individus en utilisant cette catégorisation. Dans la Corse d’aujourd’hui, le premier modèle a reflué sous les coups de boutoir de la décolonisation et en raison de la transformation de l’économie capitaliste régulée par l’État en marché libre, ouvert, concurrentiel et, à présent, mondialisé. Le deuxième modèle s’est vu marginalisé avec le reflux de l’Empire colonial et l’expansion des Trente glorieuses, à laquelle la France a alors consacré toute son énergie.
Enfin le troisième et dernier a connu, lui, un développement puissant et inattendu avec l’apparition, au début des années 80, de groupements violents, aux activités assimilables à celles d’association mafieuses : ils ont largement d’abord profité de la priorité répressive orientée vers la violence politique mais un autre phénomène a agi dans le sens de ses intérêts, l’expansion du tourisme et des activités qu’il générait dans son sillage, en particulier la croissance spectaculaire de l’immobilier et de ses profits ; enfin ses tenants n’ont pas eu les scrupules de leurs aînés quant à la protection de l’île face à l’élargissement du marché de la drogue, que leurs ascendants avaient tenu éloignée de nos rivages comme s’ils avaient voulu préserver une terre sanctuarisée.
Dans l’acte sanguinaire survenu après la Noël à Ajaccio, on peut sans doute reconnaître un enchevêtrement de rhizomes de nature différente : une redistribution des idéaux-types insulaires accompagnée d’une baisse de la garde quant à la gestion de l’économie des pulsions, elle-même générée par un surarmement banalisé, un recours aux produits illicites susceptibles de provoquer dans l’instant la chute de l’instance psychologique du surmoi, le tout sur fond de possible invidia dans le cadre de la manifestation d’une violence ordinaire qui, n’en doutons pas un instant, n’a pas dit, loin de là, son dernier mot, aussi longtemps que le corps social insulaire ne se livrera pas à un effort d’introspection aussi indispensable que salutaire pour tenter d’extirper la racine délétère qui menace la solidité de son ciment collectif.
Cette violence spécifique trouve à s’alimenter dans le terreau d’une tension et d’une agressivité verbales et non verbales, impossible à quantifier mais qui ne peut manquer d’exister comme source et comme instrument de préparation de la violence physique. Le développement des pratiques clanistes, à partir de la IIIe République, dans une société à base clanique, a contribué à entretenir une agressivité latente ou ouverte relevant de la violence ordinaire. Les rapports entre les individus reposant sur la force du groupe, chacun se sent dépositaire de la légitimité collective et chacun représente à la fois soi-même et les siens.
Donc, toute atteinte à un individu représente une atteinte au groupe, le premier et le second étant vécus comme peu différenciés. De plus, il ne faut sans doute pas mésestimer le rôle de l’invidia, dans des communautés où tout le monde se côtoie à longueur de journée. Cette fréquence des relations augmente, de fait, les risques de confrontation. Une autre explication, plus structurelle, peut aussi être mobilisée dans cette absence d’autolimitation de la violence et de l’agressivité.
Du fait de l’histoire singulière de la Corse et de son intégration tardive dans l’ensemble national, la bourgeoise insulaire n’a pas joué le rôle de la bourgeoisie nationale dans la phase post-curiale. Les élites locales, tout occupées qu'elles étaient de rejoindre l’élite nationale, n’ont pas cherché à exercer une influence au sens de celle dont parle Elias pour la cour embourgeoisée et la bourgeoisie curialisée. Quant à la bourgeoisie nationale, sortie victorieuse de la Révolution, elle était bien trop éloignée des réalités locales, surtout dans un cas aussi périphérique que celui de la Corse, pour tenter de dépasser le simple processus de captation des élites locales, qu’il lui suffisait de contrôler.
S’en est suivie, par voie de conséquence, une absence de diffusion par capillarité descendante d’une forme d’économie des pulsions, d’auto-contrôle de soi, largement imposée à la masse par l’éducation, par l’appel à l’ascension sociale individuelle et finalement intériorisée, dans la longue durée. Cela semble d’autant plus plausible que, Elias l’affirme, le processus de civilisation ne connaît pas forcément la linéarité, il ne se déploie jamais de façon univoque aux plans temporel et spatial pour telle ou telle société donnée.
Il faut avancer, pour terminer, une dernière réflexion. La Corse, société historiquement patrilinéaire, aux pratiques communautaires extrêmement poussées, a connu depuis sa véritable intégration à la France, sous la IIIe République, trois grands « idéaux-types » masculins. Selon Max Weber, l’idéal-type repose sur une sorte de synthèse-stylisation des conduites et des institutions sociales, il se traduit par une mise en icône d’attitudes génériques dans le comportement des acteurs sociaux et dans l’état des lois, des coutumes et des usages.
Le premier idéal-type est celui du « fonctionnaire », il concerne aussi les femmes : il s’est développé avec les besoins en employabilité générés par le développement de l’empire colonial, besoins qui ont constitué une solution durable à la résolution de la crise économique endémique que subissait alors l’île, avec un état de pauvreté généralisé. Le deuxième idéal-type est constitué par « le militaire », il est plus sexué : la tradition de mercenariat aux services des puissants de l’Europe relève d’une réalité multiséculaire, générée par le goût des armes, l’état de tension plus ou moins permanent régnant dans les communautés et entre elles et le poids d’une tradition belliqueuse. Enfin l’idéal-type du « gangster », archétype du virilisme et condensateur de toutes les formes potentielles de violence, qui s’est lui développé au XXe siècle avec l’expansion de la société industrielle et technologique.
Dans toutes les communes de l’île, hic et nunc, on peut opérer des regroupements d’individus en utilisant cette catégorisation. Dans la Corse d’aujourd’hui, le premier modèle a reflué sous les coups de boutoir de la décolonisation et en raison de la transformation de l’économie capitaliste régulée par l’État en marché libre, ouvert, concurrentiel et, à présent, mondialisé. Le deuxième modèle s’est vu marginalisé avec le reflux de l’Empire colonial et l’expansion des Trente glorieuses, à laquelle la France a alors consacré toute son énergie.
Enfin le troisième et dernier a connu, lui, un développement puissant et inattendu avec l’apparition, au début des années 80, de groupements violents, aux activités assimilables à celles d’association mafieuses : ils ont largement d’abord profité de la priorité répressive orientée vers la violence politique mais un autre phénomène a agi dans le sens de ses intérêts, l’expansion du tourisme et des activités qu’il générait dans son sillage, en particulier la croissance spectaculaire de l’immobilier et de ses profits ; enfin ses tenants n’ont pas eu les scrupules de leurs aînés quant à la protection de l’île face à l’élargissement du marché de la drogue, que leurs ascendants avaient tenu éloignée de nos rivages comme s’ils avaient voulu préserver une terre sanctuarisée.
Dans l’acte sanguinaire survenu après la Noël à Ajaccio, on peut sans doute reconnaître un enchevêtrement de rhizomes de nature différente : une redistribution des idéaux-types insulaires accompagnée d’une baisse de la garde quant à la gestion de l’économie des pulsions, elle-même générée par un surarmement banalisé, un recours aux produits illicites susceptibles de provoquer dans l’instant la chute de l’instance psychologique du surmoi, le tout sur fond de possible invidia dans le cadre de la manifestation d’une violence ordinaire qui, n’en doutons pas un instant, n’a pas dit, loin de là, son dernier mot, aussi longtemps que le corps social insulaire ne se livrera pas à un effort d’introspection aussi indispensable que salutaire pour tenter d’extirper la racine délétère qui menace la solidité de son ciment collectif.