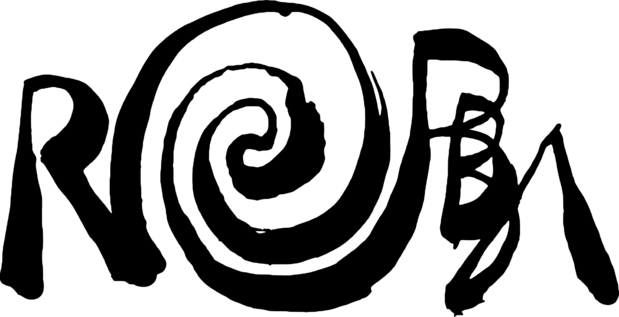Le Pape François est donc venu en Corse. S’è sentito a casa et beaucoup de Corses ont dû se sentir en plein air, au cœur du monde. Soudain en effet, la Corse n’était plus enfermée dans le factionnalisme et la violence ; elle sentait passer sur elle un souffle de fraternité. Une semaine plus tard, lorsqu’à l’avant-veille de Noël un nouveau meurtre fut commis, c’est à « l’esprit du 15 décembre » que le cardinal Bustillo appela à s’accrocher ; c’est lui aussi que rappela Gilles Simeoni dans ses vœux, pour appeler la Corse à se libérer de ses démons – le culte des armes, le mythe du voyou, le fléau de la drogue et les dérives mafieuses.
Le 15 décembre, la Corse n’était plus cette île qui ira toujours de mal en pis ou dont beaucoup crurent, au XXe s. surtout, qu’elle n’irait jamais nulle part, comme si de l’an mil à nos jours « Corsica non hebbe bene né si crede che ne haverà mai », « sibene a Idio non è cosa imposibile » [1]. Elle n’était plus cette île qui refuse d’aller là où d’autres l’ont décidé mais qui ne sait ni vers où se tourner ni comment sortir des sentiers battus, ceux dont le Pape s’inquiétait au Casone qu’on s’y enfonce alors qu’ils ne mènent à rien : « Io vedevo in questi giorni a Roma, per le strade, tanta gente che va a fare le spese, le spese, con l’ansia del consumismo, che poi svanisce e lascia niente »; ceux encore, réprouvés par le Pape au colloque d’Ajaccio mais empruntés d’Orient en Occident, d’une religiosité détournée pour « rafforzare la propria identità in modo polemico, alimentando i particolarismi, le contrapposizioni, gli atteggiamenti escludenti ».
Le 15 décembre, la Corse n’était plus assignée à une position périphérique, réduite aux clichés de l’arriération, de la modernisation ou de l’authenticité factice. Elle était saluée comme un peuple parmi les peuples, petit mais vivant, assez pour qu’on l’encourage à avoir confiance en lui et à penser à ce qu’il a, lui aussi, à apporter au monde. Comme si se dénouait le nœud d’une granitula traversant l’île, selon le symbole de Robba, la Corse vécut ainsi le 15 décembre une journée de libération, sinon de rédemption, et d’espérance joyeuse.
Le 15 décembre, la Corse n’était plus cette île qui ira toujours de mal en pis ou dont beaucoup crurent, au XXe s. surtout, qu’elle n’irait jamais nulle part, comme si de l’an mil à nos jours « Corsica non hebbe bene né si crede che ne haverà mai », « sibene a Idio non è cosa imposibile » [1]. Elle n’était plus cette île qui refuse d’aller là où d’autres l’ont décidé mais qui ne sait ni vers où se tourner ni comment sortir des sentiers battus, ceux dont le Pape s’inquiétait au Casone qu’on s’y enfonce alors qu’ils ne mènent à rien : « Io vedevo in questi giorni a Roma, per le strade, tanta gente che va a fare le spese, le spese, con l’ansia del consumismo, che poi svanisce e lascia niente »; ceux encore, réprouvés par le Pape au colloque d’Ajaccio mais empruntés d’Orient en Occident, d’une religiosité détournée pour « rafforzare la propria identità in modo polemico, alimentando i particolarismi, le contrapposizioni, gli atteggiamenti escludenti ».
Le 15 décembre, la Corse n’était plus assignée à une position périphérique, réduite aux clichés de l’arriération, de la modernisation ou de l’authenticité factice. Elle était saluée comme un peuple parmi les peuples, petit mais vivant, assez pour qu’on l’encourage à avoir confiance en lui et à penser à ce qu’il a, lui aussi, à apporter au monde. Comme si se dénouait le nœud d’une granitula traversant l’île, selon le symbole de Robba, la Corse vécut ainsi le 15 décembre une journée de libération, sinon de rédemption, et d’espérance joyeuse.
[1] Chronique de Giovanni della Grossa, ms. Benelli, f. 119, §§a-b.
Comme une bénédiction
Il y eut pourtant aussi, passée la première surprise à l’idée que le Pape vienne en Corse, un certain vertige. Pour la première fois, un pape est venu en Corse !, s’est-on étonné sans trop savoir que dire de ce simple fait. Si l’on en reste interloqué, c’est qu’on adopte trop vite un point de vue trop insulaire sur la venue de François, qui fut vécue aussi comme un honneur pour la Corse, une reconnaissance de sa singularité.
On va trop vite, en s’arrêtant trop tôt, mais on n’a pas tort, bien sûr. On cherche le sens de cette sorte de bénédiction de l’île, le sens de ce que le Pape y pressentit, y entraperçut, y devina, et qui l’attira, le toucha, et dont il encouragea le développement.
La Corse aussi a beaucoup à donner, plus encore qu’à garder. Son évêque le proclame et le Pape l’a confirmé en s’intéressant à elle et en opposant, au Casone, deux vies : la vie les mains fermées, qui refuse de donner et finira par la mort, et la vie les mains ouvertes, qui donne, se donne et dément le triomphe de la mort. « O mort ! o Enfer ! Où est ta victoire ? » (I Cor 15, 55).
La Corse, suggéra donc le Pape, échappera aux ténèbres en partageant son trésor. On le sent bien sans savoir clairement de quoi il s’agit. On croit déjà à une précieuse singularité mais on commence seulement à comprendre ce qui en fait la valeur et on ne la comprend pas encore pleinement.
Croire pour tenir et comprendre, de plus en plus et jamais une fois pour toutes : ainsi va la foi biblique (Is 7, 9). On ne comprendra pas beaucoup plus pourtant si l’on voit avant tout le 15 décembre comme un jour unique dans l’histoire de la Corse.
Geste apostolique, le voyage du Pape prend sens d’abord à travers l’histoire de l’Église, une Église dont le regard change, dont le visage change, qui poursuit ses propres fins et qui cherche aussi son trésor et ses mots, mots nouveaux et mots renouvelés, pour inviter à le partager. Par là, le 15 décembre fait écho à bien d’autres jours, à des siècles entiers, qui lui font écho en retour.
Pour prendre la mesure de l’événement, il faut donc s’efforcer de voir la Corse avec les yeux de l’Église et l’Église depuis la Corse. Entre l’Église et la Corse, ni identité ni ressemblance mais des différences qui s’attirent ; nul trésor indivis mais le pressentiment d’une complémentarité. L’Église, on n’en doute guère, a beaucoup à donner à la Corse.
La Corse aussi, devons-nous croire, à beaucoup à donner à l’Église ; en témoigne la contribution de Jean-Charles Adami au colloque d’Ajaccio. C’est pour déployer cette complémentarité qu’il faut s’efforcer de passer et repasser d’une perspective à l’autre sans réduire l’une à l’autre. Le plus simple est de cultiver l’amitié et l’expérience partagées qui, le 15 décembre, furent plus sensibles que jamais.
Pour l’Église comme pour la Corse, ce 15 décembre, pourrait-on hasarder, fut d’abord un jour de recul de l’incrédulité et de la dureté, voire de l’hostilité. Incrédulité, dureté ou méfiance dans l’Église, en particulier envers la religion populaire. Incrédulité, dureté ou agacement en Corse et parmi les nations, qui écoutent davantage les appels à la guerre qui s’élèvent en leur sein que les appels de l’Église à la paix Incrédulité, dureté ou insensibilité générales envers le monde, un monde qu’on ne peut comprendre tant que prédominent le mépris ou l’indifférence à son endroit ; il y a là une attitude de facture religieuse très sulfureuse, très ancienne et très actuelle, une sorte d’hérésie invétérée dont l’Église en Corse est bien placée pour se défaire et appeler à se défaire.
On va trop vite, en s’arrêtant trop tôt, mais on n’a pas tort, bien sûr. On cherche le sens de cette sorte de bénédiction de l’île, le sens de ce que le Pape y pressentit, y entraperçut, y devina, et qui l’attira, le toucha, et dont il encouragea le développement.
La Corse aussi a beaucoup à donner, plus encore qu’à garder. Son évêque le proclame et le Pape l’a confirmé en s’intéressant à elle et en opposant, au Casone, deux vies : la vie les mains fermées, qui refuse de donner et finira par la mort, et la vie les mains ouvertes, qui donne, se donne et dément le triomphe de la mort. « O mort ! o Enfer ! Où est ta victoire ? » (I Cor 15, 55).
La Corse, suggéra donc le Pape, échappera aux ténèbres en partageant son trésor. On le sent bien sans savoir clairement de quoi il s’agit. On croit déjà à une précieuse singularité mais on commence seulement à comprendre ce qui en fait la valeur et on ne la comprend pas encore pleinement.
Croire pour tenir et comprendre, de plus en plus et jamais une fois pour toutes : ainsi va la foi biblique (Is 7, 9). On ne comprendra pas beaucoup plus pourtant si l’on voit avant tout le 15 décembre comme un jour unique dans l’histoire de la Corse.
Geste apostolique, le voyage du Pape prend sens d’abord à travers l’histoire de l’Église, une Église dont le regard change, dont le visage change, qui poursuit ses propres fins et qui cherche aussi son trésor et ses mots, mots nouveaux et mots renouvelés, pour inviter à le partager. Par là, le 15 décembre fait écho à bien d’autres jours, à des siècles entiers, qui lui font écho en retour.
Pour prendre la mesure de l’événement, il faut donc s’efforcer de voir la Corse avec les yeux de l’Église et l’Église depuis la Corse. Entre l’Église et la Corse, ni identité ni ressemblance mais des différences qui s’attirent ; nul trésor indivis mais le pressentiment d’une complémentarité. L’Église, on n’en doute guère, a beaucoup à donner à la Corse.
La Corse aussi, devons-nous croire, à beaucoup à donner à l’Église ; en témoigne la contribution de Jean-Charles Adami au colloque d’Ajaccio. C’est pour déployer cette complémentarité qu’il faut s’efforcer de passer et repasser d’une perspective à l’autre sans réduire l’une à l’autre. Le plus simple est de cultiver l’amitié et l’expérience partagées qui, le 15 décembre, furent plus sensibles que jamais.
Pour l’Église comme pour la Corse, ce 15 décembre, pourrait-on hasarder, fut d’abord un jour de recul de l’incrédulité et de la dureté, voire de l’hostilité. Incrédulité, dureté ou méfiance dans l’Église, en particulier envers la religion populaire. Incrédulité, dureté ou agacement en Corse et parmi les nations, qui écoutent davantage les appels à la guerre qui s’élèvent en leur sein que les appels de l’Église à la paix Incrédulité, dureté ou insensibilité générales envers le monde, un monde qu’on ne peut comprendre tant que prédominent le mépris ou l’indifférence à son endroit ; il y a là une attitude de facture religieuse très sulfureuse, très ancienne et très actuelle, une sorte d’hérésie invétérée dont l’Église en Corse est bien placée pour se défaire et appeler à se défaire.
Un nouveau moment franciscain
Écartées par un sursaut de foi, d’espérance et de charité, l’incrédulité et la dureté ne laissent pas la place à une crédulité doucereuse mais à la tradition vigoureuse, à la tradition qui pense, aux traditions qui pensent. Le 15 décembre, l’Église et la Corse croyaient l’une en l’autre et se tendaient la main pour partager leurs trésors.
Qu’elles s’inspirent de l’esprit du 15 décembre, qu’elles se méfient de leur incrédulité, et l’Église et la Corse, l’Église et les nations, pourront s’aider à comprendre les signes des temps et la clameur de la terre et des pauvres, selon une étonnante formule de Laudato si’, à laquelle il faudra revenir et qui fut empruntée, sans l’indiquer ni le cacher, à un théologien sanctionné naguère.
Ce n’est pas n’importe quel pape qui est venu en Corse et il n’est pas venu n’importe quand, ni n’importe où. Pour la première fois, huit siècles après sa mort, le Pontife romain porte le nom de saint François d’Assise. Son pontificat insuffle à travers l’Église et le monde un nouvel esprit franciscain.
À peine élu, François entreprit ainsi auprès de nouveaux lépreux, à Lampedusa, un long pèlerinage en Méditerranée. Deux ans plus tard, il intitula son encyclique Laudato si’ d’après le Cantique des créatures de saint François : « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra » ; donnée la veille de la fête du Poverello, son encyclique suivante, Fratelli Tutti, esquisse une sorte de franciscanisme politique [1].
C’est ce pape qui a rendu visite à l’Église de Dieu qui séjourne en Corse, selon l’antique formule de l’épître de Clément adressée, une soixantaine d’années après la prédication du Christ, à l’Église de Dieu en séjour à Corinthe au nom de l’Église de Dieu en séjour à Rome [2]. C’est ce pape, successeur de Pierre, de Clément et de tant d’autres, qui est venu à la rencontre des Corses, qui ne séjournent pas sur leur île comme étrangers et voyageurs (1 P 2,11) mais s’attachent et se lient à une terre parsemée d’anciens couvents franciscains dont l’un d’eux, en Orezza, fut un haut lieu de sa liberté. C’est ce pape qui, après le départ des derniers franciscains dans l’île, choisit un autre frère mineur pour y être évêque et continuer à y entretenir une certaine spiritualité.
Le 15 décembre, l’homélie de François suivit le fil d’une question posée dans l’évangile du jour par la foule entourant Jean Baptiste (Lc 3, 10-18) : « Che cosa dobbiamo fare ? ». Le Pape est depuis longtemps rentré à Rome et Noël est déjà loin. Le carême approche, temps de conversion, et reste cette question : « Che cosa dobbiamo fare? È una domanda da ascoltare con attenzione, perché esprime il desiderio di rinnovare la vita », souligna le Pape, qui ajouta : « Chi si ritiene giusto non si rinnova ».
Qu’elles s’inspirent de l’esprit du 15 décembre, qu’elles se méfient de leur incrédulité, et l’Église et la Corse, l’Église et les nations, pourront s’aider à comprendre les signes des temps et la clameur de la terre et des pauvres, selon une étonnante formule de Laudato si’, à laquelle il faudra revenir et qui fut empruntée, sans l’indiquer ni le cacher, à un théologien sanctionné naguère.
Ce n’est pas n’importe quel pape qui est venu en Corse et il n’est pas venu n’importe quand, ni n’importe où. Pour la première fois, huit siècles après sa mort, le Pontife romain porte le nom de saint François d’Assise. Son pontificat insuffle à travers l’Église et le monde un nouvel esprit franciscain.
À peine élu, François entreprit ainsi auprès de nouveaux lépreux, à Lampedusa, un long pèlerinage en Méditerranée. Deux ans plus tard, il intitula son encyclique Laudato si’ d’après le Cantique des créatures de saint François : « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra » ; donnée la veille de la fête du Poverello, son encyclique suivante, Fratelli Tutti, esquisse une sorte de franciscanisme politique [1].
C’est ce pape qui a rendu visite à l’Église de Dieu qui séjourne en Corse, selon l’antique formule de l’épître de Clément adressée, une soixantaine d’années après la prédication du Christ, à l’Église de Dieu en séjour à Corinthe au nom de l’Église de Dieu en séjour à Rome [2]. C’est ce pape, successeur de Pierre, de Clément et de tant d’autres, qui est venu à la rencontre des Corses, qui ne séjournent pas sur leur île comme étrangers et voyageurs (1 P 2,11) mais s’attachent et se lient à une terre parsemée d’anciens couvents franciscains dont l’un d’eux, en Orezza, fut un haut lieu de sa liberté. C’est ce pape qui, après le départ des derniers franciscains dans l’île, choisit un autre frère mineur pour y être évêque et continuer à y entretenir une certaine spiritualité.
Le 15 décembre, l’homélie de François suivit le fil d’une question posée dans l’évangile du jour par la foule entourant Jean Baptiste (Lc 3, 10-18) : « Che cosa dobbiamo fare ? ». Le Pape est depuis longtemps rentré à Rome et Noël est déjà loin. Le carême approche, temps de conversion, et reste cette question : « Che cosa dobbiamo fare? È una domanda da ascoltare con attenzione, perché esprime il desiderio di rinnovare la vita », souligna le Pape, qui ajouta : « Chi si ritiene giusto non si rinnova ».
[2] V. le commentaire de la formule dans la conférence de carême donnée par Giorgio Agamben à Notre-Dame de Paris le 8 mars 2009.
Rinnovare la vita
Tous les Corses, évidemment, ne sont pas catholiques ou chrétiens. Une petite communauté orthodoxe s’est installée dans l’île il y a trois cents ans et le protestantisme y est présent depuis le XIXe s. ; certains Corses sont juifs, ou ont des origines juives, ou veulent croire qu’ils ont des origines juives ; d’autres sont musulmans ; d’autres agnostiques ou athées. En Méditerranée pourtant, la question reprise par le Pape se propose à tous et chacun – pratiquants ou non pratiquants, chrétiens, juifs ou musulmans, croyants ou incroyants.
Les religions abrahamiques, en effet, n’apportent pas de réponses particulières, auxquelles certains croiraient et d’autres non, à des questions universelles et aussi vieilles que l’homme sur le sens de la vie, la mort, l’au-delà, etc. Elles procèdent d’une expérience religieuse très particulière, souligna François au colloque d’Ajaccio, qui naquit entre le Proche-Orient et la Méditerranée. Surtout, c’est une question nouvelle, critique, qu’apportent les religions du Livre, ces « contre-religions » comme les appelait l’égyptologue Jan Assmann : où est la vraie vie, libérée des idoles et des faux dieux ?
Pour les religions plus anciennes, la question frise l’absurde. Elle travaille tant les contre-religions au contraire qu’elle se retourne en elles, entre elles et contre elles. Que l’on songe à la méfiance protestante envers le catholicisme, au rejet athée du monothéisme, qui en relance l’interrogation (a)théologique, ou aux polémiques autour de la laïcité. Que l’on songe aux hésitations des pasteurs face à la religion populaire, d’où l’intérêt du colloque d’Ajaccio.
Inévitable, pour nous, la distinction entre vrais et faux dieux apparaît dans le Livre de l’Exode, entre la sortie d’Égypte, le don des Dix Commandements et le culte du veau d’or. Lui fait écho, dans l’évangile, la dernière tentation du Christ, quand Satan lui montra les royaumes du monde et lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi » ; à quoi le Christ répondit : « Va-t’en Satan !, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul » (Mt 4, 9-10).
C’est par cette distinction entre un culte saint et des prosternations impies que les contre-religions abrahamiques tendent autant à bouleverser le quotidien, en brisant les idoles, et à s’inscrire dans le quotidien, en servant leur dieu. Libératrice, la distinction est la mère de la fidélité monothéiste. Explosive, elle peut devenir celle aussi d’un zèle égaré ; son archétype est le massacre, ordonné par Moïse saisi d’indignation, de trois mille adorateurs du veau d’or (Ex 32, 25-29). Que faire alors pour vivre vraiment, libérés des faux dieux et de l’instinct de se tourner contre notre prochain ou contre les idoles, la vague religiosité ou les fausses valeurs, croit-on, dont il nous encombre ?
C’est une question de spiritualité, de vie et de mort spirituelles, de fidélité et de tentations, de liberté et d’esclavage. Il ne s’agit pas simplement en effet de savoir quels rites ou quelles valeurs respecter mais, de façon plus brûlante, de savoir comment changer de vie et pour vivre quoi. Ainsi s’est affirmé le franciscanisme, faisant vœu d’épouser la très haute pauvreté, selon une Règle de vie dont la formulation, l’approbation et l’observance divisèrent l’Église et l’Ordre lui-même. Huit siècles plus tard, c’est encore de règle ou de style de vie qu’il fut question au Casone.
« Che cosa dobbiamo fare ? » La question se pose au cœur de l’Église où se mêlent, suggéra Benoît XVI, l’Église du Christ et l’Église de l’Antéchrist, ou du moins l’Église véritable et ses défigurations [2]. Elle se pose dans l’Église où François a désigné le cléricalisme comme la source des abus les plus graves, dont d’autres rejettent la faute sur les errements du monde moderne [3]. Mais elle retentit autant hors de l’Église, ou sur son parvis, au fond ou dans ses chapelles latérales, comme dans cette Corse que l’on dit plus pratiquante que croyante, à la différence du Continent, et où l’on voudrait vivre libre – mais pour quoi faire ? – et « vivre ici » – mais pour y vivre quoi ?
Les religions abrahamiques, en effet, n’apportent pas de réponses particulières, auxquelles certains croiraient et d’autres non, à des questions universelles et aussi vieilles que l’homme sur le sens de la vie, la mort, l’au-delà, etc. Elles procèdent d’une expérience religieuse très particulière, souligna François au colloque d’Ajaccio, qui naquit entre le Proche-Orient et la Méditerranée. Surtout, c’est une question nouvelle, critique, qu’apportent les religions du Livre, ces « contre-religions » comme les appelait l’égyptologue Jan Assmann : où est la vraie vie, libérée des idoles et des faux dieux ?
Pour les religions plus anciennes, la question frise l’absurde. Elle travaille tant les contre-religions au contraire qu’elle se retourne en elles, entre elles et contre elles. Que l’on songe à la méfiance protestante envers le catholicisme, au rejet athée du monothéisme, qui en relance l’interrogation (a)théologique, ou aux polémiques autour de la laïcité. Que l’on songe aux hésitations des pasteurs face à la religion populaire, d’où l’intérêt du colloque d’Ajaccio.
Inévitable, pour nous, la distinction entre vrais et faux dieux apparaît dans le Livre de l’Exode, entre la sortie d’Égypte, le don des Dix Commandements et le culte du veau d’or. Lui fait écho, dans l’évangile, la dernière tentation du Christ, quand Satan lui montra les royaumes du monde et lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi » ; à quoi le Christ répondit : « Va-t’en Satan !, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul » (Mt 4, 9-10).
C’est par cette distinction entre un culte saint et des prosternations impies que les contre-religions abrahamiques tendent autant à bouleverser le quotidien, en brisant les idoles, et à s’inscrire dans le quotidien, en servant leur dieu. Libératrice, la distinction est la mère de la fidélité monothéiste. Explosive, elle peut devenir celle aussi d’un zèle égaré ; son archétype est le massacre, ordonné par Moïse saisi d’indignation, de trois mille adorateurs du veau d’or (Ex 32, 25-29). Que faire alors pour vivre vraiment, libérés des faux dieux et de l’instinct de se tourner contre notre prochain ou contre les idoles, la vague religiosité ou les fausses valeurs, croit-on, dont il nous encombre ?
C’est une question de spiritualité, de vie et de mort spirituelles, de fidélité et de tentations, de liberté et d’esclavage. Il ne s’agit pas simplement en effet de savoir quels rites ou quelles valeurs respecter mais, de façon plus brûlante, de savoir comment changer de vie et pour vivre quoi. Ainsi s’est affirmé le franciscanisme, faisant vœu d’épouser la très haute pauvreté, selon une Règle de vie dont la formulation, l’approbation et l’observance divisèrent l’Église et l’Ordre lui-même. Huit siècles plus tard, c’est encore de règle ou de style de vie qu’il fut question au Casone.
« Che cosa dobbiamo fare ? » La question se pose au cœur de l’Église où se mêlent, suggéra Benoît XVI, l’Église du Christ et l’Église de l’Antéchrist, ou du moins l’Église véritable et ses défigurations [2]. Elle se pose dans l’Église où François a désigné le cléricalisme comme la source des abus les plus graves, dont d’autres rejettent la faute sur les errements du monde moderne [3]. Mais elle retentit autant hors de l’Église, ou sur son parvis, au fond ou dans ses chapelles latérales, comme dans cette Corse que l’on dit plus pratiquante que croyante, à la différence du Continent, et où l’on voudrait vivre libre – mais pour quoi faire ? – et « vivre ici » – mais pour y vivre quoi ?
[1] Agamben, Le Mystère du mal. Benoît XVI et les fin des temps, Bayard, 2017 ; voir aussi les propos de Benoît XVI à l’audience générale du 22 avril 2009.
[2] Lettre du Pape François au Peuple de Dieu, 20/08/2018.
O Corsica ! Arrizzati ! Renouveler l’Église, ou le message d’Ajaccio
Reste à approcher en effet une certaine plénitude de l’espérance, ni remise à l’au-delà ni limitée à soi et ses proches. Ici-bas et entre deux continents, à Marseille, en 2023, dix ans après Lampedusa, François haussa ainsi le ton : « la mare nostrum crie justice, avec ses rivages où, d’un côté, règnent l’opulence, le consumérisme et le gaspillage et, de l’autre, la pauvreté et la précarité ». L’Église, qui depuis plus de cinquante ans rappelle aux gens de l’opulence leurs devoirs envers les gens de la faim, a son port d’attache dans « un style de vie scandaleusement évangélique », ajouta-t-il [1].
À Ajaccio, où François vint bénir plutôt qu’interpeller, son ton n’était pas celui, plus prophétique que sacerdotal, de Lampedusa et de Marseille, de Laudato si’ et Tutti Fratelli. Il ne parla ni d’injustices ni de cris de justice, ni de pauvres ni de migrants, ni de trafics ni de maffia, ni de sœur notre mère la Terre ni de fraternité universelle. Certains en furent certainement déçus, à commencer par ceux qu’on intimide parce qu’ils tentent de faire entendre les cris de la terre et des pauvres. Sans doute pensèrent-ils que des appels à la paix ne suffiraient pas à faire fuir les nouveaux démons de la Corse.
Sans doute la paix ne peut-elle être que le thème premier de la prédication de l’Église en Corse, ouvrant la voie à d’autres attentes qui renforceront en retour la paix, à commencer par la justice avec laquelle la paix va main dans la main (Is 32, 17). Et en effet le Pape proposa au colloque d’Ajaccio une réponse étonnamment ramassée et même complète, d’une certaine façon, aux questions « que faire ? » et « que vivre ? » telles que l’Église ne peut éviter de se les poser elle-même :
« se intende essere pienamente fedele a sé stessa (la fede) comporta un impegno e una testimonianza verso tutti, per la crescita umana, il progresso sociale e la cura del creato, nel segno della carità ».
Au cœur du voyage de François, ces paroles prononcées condensent, semble-t-il, les orientations fondamentales de son pontificat et de l’Église d’aujourd’hui. On entend, si l’on tend l’oreille, qu’elles sont scandaleusement évangéliques. Elles appellent en effet l’Église elle-même à une ré-évangélisation radicale, trop radicale sans doute pour ne pas susciter de tensions bien plus profondes que les conflits entre conservateurs et progressistes, sur des questions de rites et de mœurs, qui occupent le devant de la scène catholique.
À Ajaccio, le Pape redit d’abord qu’aucun engagement sans charité ne vient de Dieu ni ne conduit à Dieu. Sans charité, l’humanisme, le progressisme ou l’écologie ne sont que des élégances, ou pire, craint l’Église. De là le principal motif de la sanction, dans les années 1980, de la théologie de la libération dont provient l’expression de clameur de la Terre et des pauvres reprises dans Laudato si’ [2] ; elle aurait trop négligé, selon le cardinal Ratzinger, de concevoir la liberté sous le signe de la charité [3].
Là n’est pourtant pas le souci premier de François, qui évoque l’engagement et le témoignage pour la croissance humaine, le progrès social et la protection de la Création comme le signe indispensable d’une vraie foi et non comme un atour dont la foi puisse se parer ou se passer. Son message principal est que la foi fidèle à elle-même est une foi qui œuvre et œuvre sous le signe de la charité. Qu’on le prenne au sérieux et l’on devra en conclure que, sans charité, la défense de la foi, de l’Église ou du christianisme ne tend qu’à l’hérésie, au schisme et à l’idolâtrie.
À Ajaccio, François repoussa ainsi une fois encore la « mondanité spirituelle » dont il avait dénoncé dans sa première exhortation apostolique les « attitudes apparemment opposées mais avec la même prétention de ‘‘dominer l’espace de l’Église” » [4]. Il rappela cette vérité première déjà exprimée par saint Paul : sans charité, le zèle n’est rien ; « j’aurais beau avoir la foi à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » (I Cor 13, 2-3).
Apparaît ici l’immense effort de recentrage kérygmatique d’une Église qui cherche à se réformer et, plus crucialement, à se renouveler, à s’évangéliser et se laisser évangéliser au contact des créatures. Le kérygme, terme biblique, c’est la proclamation de la Bonne Nouvelle et la Bonne Nouvelle proclamée.
Antérieur à toute élaboration dogmatique, c’est le cœur du message chrétien. Irréductible aux doctrines qui se résument, s’enseignent et se transmettent, c’est ce que l’Église se reconnaît pour mission de redécouvrir, d’approfondir et d’annoncer à nouveau. C’est ce qui l’oblige à « une constante attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté » [5].
Comme le suggérera la prochaine partie, les paroles de François sont grosses d’une nouvelle annonce qui peut résonner fortement en Corse, la toucher spécialement, et s’y renouveler puissamment. C’est qu’elles approfondissent l’idée même de la foi, d’une façon qui ne peut qu’aider l’Église et la Corse à mieux se comprendre alors que les Corses peuvent sembler à leurs prêtres plus pratiquants que croyante ; c’est qu’elles sont le signe d’un apaisement de la crise entre l’Église romaine et « le monde moderne » qui fit enfler en plein XXe s. une querelle des Anciens et des Modernes qui rebondit encore, dont la Corse a assez souffert et qui n’aide pas à lire les signes des temps ; c’est qu’elles témoignent aussi que l’Église recommence à lire les signes des lieux, des régions, des pays, des terres, de la Création et des créatures, et que l’Église en Corse, auprès des Corses, et les Corses autour de l’Église, de près ou de loin, peuvent ouvrir les voies d’une piété insulaire envers « sora nostra matre Terra » et, pourquoi pas ?, d’une contribution depuis la Corse à la nouvelle théologie depuis la Méditerranée.
À Ajaccio, où François vint bénir plutôt qu’interpeller, son ton n’était pas celui, plus prophétique que sacerdotal, de Lampedusa et de Marseille, de Laudato si’ et Tutti Fratelli. Il ne parla ni d’injustices ni de cris de justice, ni de pauvres ni de migrants, ni de trafics ni de maffia, ni de sœur notre mère la Terre ni de fraternité universelle. Certains en furent certainement déçus, à commencer par ceux qu’on intimide parce qu’ils tentent de faire entendre les cris de la terre et des pauvres. Sans doute pensèrent-ils que des appels à la paix ne suffiraient pas à faire fuir les nouveaux démons de la Corse.
Sans doute la paix ne peut-elle être que le thème premier de la prédication de l’Église en Corse, ouvrant la voie à d’autres attentes qui renforceront en retour la paix, à commencer par la justice avec laquelle la paix va main dans la main (Is 32, 17). Et en effet le Pape proposa au colloque d’Ajaccio une réponse étonnamment ramassée et même complète, d’une certaine façon, aux questions « que faire ? » et « que vivre ? » telles que l’Église ne peut éviter de se les poser elle-même :
« se intende essere pienamente fedele a sé stessa (la fede) comporta un impegno e una testimonianza verso tutti, per la crescita umana, il progresso sociale e la cura del creato, nel segno della carità ».
Au cœur du voyage de François, ces paroles prononcées condensent, semble-t-il, les orientations fondamentales de son pontificat et de l’Église d’aujourd’hui. On entend, si l’on tend l’oreille, qu’elles sont scandaleusement évangéliques. Elles appellent en effet l’Église elle-même à une ré-évangélisation radicale, trop radicale sans doute pour ne pas susciter de tensions bien plus profondes que les conflits entre conservateurs et progressistes, sur des questions de rites et de mœurs, qui occupent le devant de la scène catholique.
À Ajaccio, le Pape redit d’abord qu’aucun engagement sans charité ne vient de Dieu ni ne conduit à Dieu. Sans charité, l’humanisme, le progressisme ou l’écologie ne sont que des élégances, ou pire, craint l’Église. De là le principal motif de la sanction, dans les années 1980, de la théologie de la libération dont provient l’expression de clameur de la Terre et des pauvres reprises dans Laudato si’ [2] ; elle aurait trop négligé, selon le cardinal Ratzinger, de concevoir la liberté sous le signe de la charité [3].
Là n’est pourtant pas le souci premier de François, qui évoque l’engagement et le témoignage pour la croissance humaine, le progrès social et la protection de la Création comme le signe indispensable d’une vraie foi et non comme un atour dont la foi puisse se parer ou se passer. Son message principal est que la foi fidèle à elle-même est une foi qui œuvre et œuvre sous le signe de la charité. Qu’on le prenne au sérieux et l’on devra en conclure que, sans charité, la défense de la foi, de l’Église ou du christianisme ne tend qu’à l’hérésie, au schisme et à l’idolâtrie.
À Ajaccio, François repoussa ainsi une fois encore la « mondanité spirituelle » dont il avait dénoncé dans sa première exhortation apostolique les « attitudes apparemment opposées mais avec la même prétention de ‘‘dominer l’espace de l’Église” » [4]. Il rappela cette vérité première déjà exprimée par saint Paul : sans charité, le zèle n’est rien ; « j’aurais beau avoir la foi à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » (I Cor 13, 2-3).
Apparaît ici l’immense effort de recentrage kérygmatique d’une Église qui cherche à se réformer et, plus crucialement, à se renouveler, à s’évangéliser et se laisser évangéliser au contact des créatures. Le kérygme, terme biblique, c’est la proclamation de la Bonne Nouvelle et la Bonne Nouvelle proclamée.
Antérieur à toute élaboration dogmatique, c’est le cœur du message chrétien. Irréductible aux doctrines qui se résument, s’enseignent et se transmettent, c’est ce que l’Église se reconnaît pour mission de redécouvrir, d’approfondir et d’annoncer à nouveau. C’est ce qui l’oblige à « une constante attention pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa permanente nouveauté » [5].
Comme le suggérera la prochaine partie, les paroles de François sont grosses d’une nouvelle annonce qui peut résonner fortement en Corse, la toucher spécialement, et s’y renouveler puissamment. C’est qu’elles approfondissent l’idée même de la foi, d’une façon qui ne peut qu’aider l’Église et la Corse à mieux se comprendre alors que les Corses peuvent sembler à leurs prêtres plus pratiquants que croyante ; c’est qu’elles sont le signe d’un apaisement de la crise entre l’Église romaine et « le monde moderne » qui fit enfler en plein XXe s. une querelle des Anciens et des Modernes qui rebondit encore, dont la Corse a assez souffert et qui n’aide pas à lire les signes des temps ; c’est qu’elles témoignent aussi que l’Église recommence à lire les signes des lieux, des régions, des pays, des terres, de la Création et des créatures, et que l’Église en Corse, auprès des Corses, et les Corses autour de l’Église, de près ou de loin, peuvent ouvrir les voies d’une piété insulaire envers « sora nostra matre Terra » et, pourquoi pas ?, d’une contribution depuis la Corse à la nouvelle théologie depuis la Méditerranée.
[1] Discours du Saint-Père au Palais du Pharo , 23/09/2023.
[2] Laudato si’, §49 en particulier. La formule reprend le titre d’un livre d’un des théologiens de la libération les plus connus, Leonardo Boff, Ecología : grito de la Tierra, grito de los pobres, Trotta, 1996.
[3] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Libertatis Nuntius, 1984.
[4] Evangelii Gaudium , 24/11/2013, §95.
[5] Evangelii Gaudium §41
[4] Evangelii Gaudium , 24/11/2013, §95.
[5] Evangelii Gaudium §41
Pour aller plus loin
Pierre-Yves Condé de Rocca Serra est sociologue et juriste, maître de conférences en science politique à l'Université Bourgogne Europe, et il a participé aux travaux de la Chaire Laudato si'. Pour une nouvelle exploration de la Terre établie en 2021-2024 par le Collège des Bernardins et confiée à Grégory Quenet, professeur d'histoire environnementale