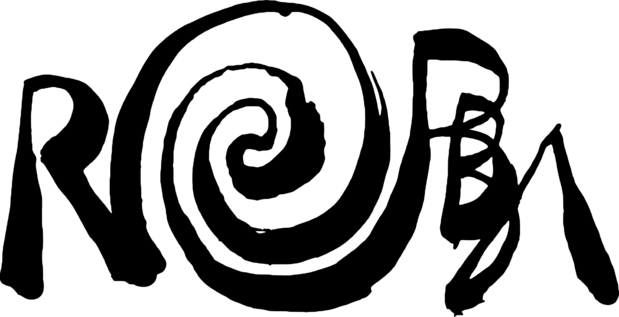Vannina Micheli-Rechtman :
Chère Antonia, j’ai découvert ton projet Primour qui est un travail tout à fait original autour de la figure de Médée ; peux-tu nous le présenter ?
Mais avant ça, rappelons que Médée est la fille d'Aétès, roi de Colchide, et souvent décrite comme une sorcière ou une prêtresse, capable de manipuler les forces surnaturelles grâce à ses connaissances magiques. Sa première grande apparition dans la mythologie se situe dans l’épopée des Argonautes. Elle tombe amoureuse de Jason, héros venu chercher la Toison d’or. Médée, par amour, trahit sa famille et aide Jason grâce à ses pouvoirs magiques. Elle contribue notamment à vaincre les épreuves imposées par son père et à déjouer les pièges du serpent gardien de la Toison. Médée est un personnage emblématique de la mythologie grecque et une figure centrale dans plusieurs récits antiques, notamment dans la tragédie Médée d'Euripide. Son histoire est celle d'une femme complexe, décrite à la fois comme aimante, rusée et vengeresse. Elle incarne des thématiques puissantes, telles que l'amour, la trahison, la vengeance, l'exil, et la place des femmes dans une société patriarcale.
Chère Antonia, j’ai découvert ton projet Primour qui est un travail tout à fait original autour de la figure de Médée ; peux-tu nous le présenter ?
Mais avant ça, rappelons que Médée est la fille d'Aétès, roi de Colchide, et souvent décrite comme une sorcière ou une prêtresse, capable de manipuler les forces surnaturelles grâce à ses connaissances magiques. Sa première grande apparition dans la mythologie se situe dans l’épopée des Argonautes. Elle tombe amoureuse de Jason, héros venu chercher la Toison d’or. Médée, par amour, trahit sa famille et aide Jason grâce à ses pouvoirs magiques. Elle contribue notamment à vaincre les épreuves imposées par son père et à déjouer les pièges du serpent gardien de la Toison. Médée est un personnage emblématique de la mythologie grecque et une figure centrale dans plusieurs récits antiques, notamment dans la tragédie Médée d'Euripide. Son histoire est celle d'une femme complexe, décrite à la fois comme aimante, rusée et vengeresse. Elle incarne des thématiques puissantes, telles que l'amour, la trahison, la vengeance, l'exil, et la place des femmes dans une société patriarcale.
Antonia Taddei :
Dans la version d’Euripide, qui est la plus connue, de retour à Corinthe, Jason trahit Médée : il la quitte pour épouser la fille du Roi de Corinthe. Alors Médée, par désespoir amoureux tue leurs enfants.
Il y a deux ou trois ans, en repensant à Médée, j’ai eu une intuition très forte : j’ai deviné que Médée n’avait pas tué ses enfants. J’en étais certaine : une femme ne fait pas ça ! L’infanticide existe, malheureusement, mais il n’est pas spécialement féminin, et ses ressorts ne sont pas le désespoir amoureux, cela relève de la psychiatrie ou cela est lié à des contextes très particuliers et effroyables : ainsi des femmes esclaves ont pu choisir de ne pas laisser vivre l’esclavage à leurs enfants. Concernant Médée, j’ai vérifié et j’ai découvert que l’infanticide est une invention d’Euripide : dans toutes les versions archaïques du mythe, Médée ne tuait pas ses enfants. Médée a la même racine que « médecine ». Heureusement, sa vraie nature est restée écrite dans son nom : Médée est une soignante, une femme savante, une sage-femme. La rendre infanticide est une défiguration de l’image de la femme soignante et de notre nature humaine qui est soignante.
J’en discutais avec Vannina Bernard-Leoni et lui expliquais que nous devons soigner notre représentation du soin, l’élargir. Les philosophes du « care » proposent justement que le soin soit au cœur de notre projet de société. Je lui disais, qu’il est symptomatique que le mot « care » n’ait pas été traduit en français. C’est alors que Vannina m’a dit qu’en corse, on pourrait traduire « care » par « primura ». Cela m’a amené à créer le néologisme « primour ». Ce pourrait être le deuxième mot français inspiré du corse - le premier étant « maquis ».
Mais il faut que Vannina nous raconte pourquoi et comment elle a choisi « primura » pour traduire « care » !
Dans la version d’Euripide, qui est la plus connue, de retour à Corinthe, Jason trahit Médée : il la quitte pour épouser la fille du Roi de Corinthe. Alors Médée, par désespoir amoureux tue leurs enfants.
Il y a deux ou trois ans, en repensant à Médée, j’ai eu une intuition très forte : j’ai deviné que Médée n’avait pas tué ses enfants. J’en étais certaine : une femme ne fait pas ça ! L’infanticide existe, malheureusement, mais il n’est pas spécialement féminin, et ses ressorts ne sont pas le désespoir amoureux, cela relève de la psychiatrie ou cela est lié à des contextes très particuliers et effroyables : ainsi des femmes esclaves ont pu choisir de ne pas laisser vivre l’esclavage à leurs enfants. Concernant Médée, j’ai vérifié et j’ai découvert que l’infanticide est une invention d’Euripide : dans toutes les versions archaïques du mythe, Médée ne tuait pas ses enfants. Médée a la même racine que « médecine ». Heureusement, sa vraie nature est restée écrite dans son nom : Médée est une soignante, une femme savante, une sage-femme. La rendre infanticide est une défiguration de l’image de la femme soignante et de notre nature humaine qui est soignante.
J’en discutais avec Vannina Bernard-Leoni et lui expliquais que nous devons soigner notre représentation du soin, l’élargir. Les philosophes du « care » proposent justement que le soin soit au cœur de notre projet de société. Je lui disais, qu’il est symptomatique que le mot « care » n’ait pas été traduit en français. C’est alors que Vannina m’a dit qu’en corse, on pourrait traduire « care » par « primura ». Cela m’a amené à créer le néologisme « primour ». Ce pourrait être le deuxième mot français inspiré du corse - le premier étant « maquis ».
Mais il faut que Vannina nous raconte pourquoi et comment elle a choisi « primura » pour traduire « care » !
Vannina Bernard-Leoni :
C’est important de réfléchir sur les langues et leur façon de dire le monde. J’adore notamment les « intraduisibles », ces mots-concept qui sont quasiment impossibles à traduire sans déperdition de sens. Le Dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin est un merveilleux recueil qui rappelle le lien profond entre pensée et langue. Je rêve souvent d’un projet qui rassemble et analyse les intraduisibles corses…
Bref, « primura » me semble faire partie de ces mots. À vrai dire, à première vue, il est très proche de son cousin italien « premura » mais l’évolution linguistique du corse en « primura » (avec un phénomène de fermeture classique du son « e » en « i ») fait entendre « primu », « premier » et connote une dimension de priorisation, qui lui donne une force singulière que l’usage consacre.
Dans une époque où on a parfois du mal à se souvenir de l’essentiel, c’est un mot-boussole ! Dans « primura », ce qui est puissant, c’est que la question du soin passe par la priorisation. « Hè di primura ! » : c’est ce qui est important, prioritaire, ce à quoi on doit consacrer du temps et du soin. C’est ce qui compte le plus, qui doit passer avant le reste.
Dans l’esprit comme dans l’usage, ça me paraît pouvoir rendre le concept de « care » que le français a finalement renoncé à traduire. On est bien entre disposition morale et pratique sociale. Et c’est d’ailleurs un mot qui vit et qui est repéré comme concept. Je me suis récemment rendu compte que la mutuelle de la Corse a choisi de baptiser son magazine Primura
Voilà ce qu’en dit Infcor :
Definizione : Cura, sollicitudine in i cunfronti di qualchidunu o di qualcosa: un affare di primura.- Urgenza, furia, fretta.- Attu spuntaneu; sguardu attente, affettuosu, affezziunosu : ti ringraziu di e to primure.
Etimulugia : da u lat. premere
En italien, voilà quelques éléments glanés dans le dictionnaire Treccani :
1. Cura, sollecitudine verso persona, cosa, affare o problema che sta molto a cuore.
Atto di attenzione affettuosa con cui tale sollecitudine si manifesta; spesso al plurale : la ringrazio delle primure usatemi; aveva tutte le primure possibili per i suoi genitori.
2. Estensione : Urgenza, fretta.
Di premura, come locuzione : urgente o, anche, importante, che preme, che sta a cuore : è un affare di premura.
Antonia : Nos échanges ont donné naissance à une enquête-création sur le soin, la protection en Corse…
VBL : Oui, on va essayer de repérer ce qui en Corse, « hè di primura », ce qui fait l’objet de cette « primura ». Traditionnellement, le corpus littéraire l’atteste, les Corses témoignent force primura au-delà de leur communauté familiale, amicale ou « paisana ». Le lien qui circule naturellement entre locu & populu, ce qu’Augustin Berque appelle la relation mésologique, l’ont conduit à « primourer » aussi le vivant non humain. Côté animaux, on pourrait évoquer U Lamentu di Fasgianu, ou A morte di Filicone, et côté végétaux, il y a dans un texte comme U Lamentu di castagnu et plus largement dans les innombrables autres poèmes dédiés au châtaignier la marque d’une sacrée sollicitude.
Aujourd’hui, face aux intenses défis écologiques, on pourrait considérer que cette primura prend d’autres formes et qu’un de ses avatars se perçoit dans le combat mené pour le fleuve Tavignanu, et en particulier dans toutes les démarches entreprises pour que sa personnalité juridique soit reconnue. Ce ne sont que des intuitions, des recoupements, mais une enquête artistique devrait permettre de les approfondir.
Mais Vannina toi qui est psychiatre, psychanalyste et philosophe, quel regard portes-tu sur Medea ?
C’est important de réfléchir sur les langues et leur façon de dire le monde. J’adore notamment les « intraduisibles », ces mots-concept qui sont quasiment impossibles à traduire sans déperdition de sens. Le Dictionnaire des intraduisibles de Barbara Cassin est un merveilleux recueil qui rappelle le lien profond entre pensée et langue. Je rêve souvent d’un projet qui rassemble et analyse les intraduisibles corses…
Bref, « primura » me semble faire partie de ces mots. À vrai dire, à première vue, il est très proche de son cousin italien « premura » mais l’évolution linguistique du corse en « primura » (avec un phénomène de fermeture classique du son « e » en « i ») fait entendre « primu », « premier » et connote une dimension de priorisation, qui lui donne une force singulière que l’usage consacre.
Dans une époque où on a parfois du mal à se souvenir de l’essentiel, c’est un mot-boussole ! Dans « primura », ce qui est puissant, c’est que la question du soin passe par la priorisation. « Hè di primura ! » : c’est ce qui est important, prioritaire, ce à quoi on doit consacrer du temps et du soin. C’est ce qui compte le plus, qui doit passer avant le reste.
Dans l’esprit comme dans l’usage, ça me paraît pouvoir rendre le concept de « care » que le français a finalement renoncé à traduire. On est bien entre disposition morale et pratique sociale. Et c’est d’ailleurs un mot qui vit et qui est repéré comme concept. Je me suis récemment rendu compte que la mutuelle de la Corse a choisi de baptiser son magazine Primura
Voilà ce qu’en dit Infcor :
Definizione : Cura, sollicitudine in i cunfronti di qualchidunu o di qualcosa: un affare di primura.- Urgenza, furia, fretta.- Attu spuntaneu; sguardu attente, affettuosu, affezziunosu : ti ringraziu di e to primure.
Etimulugia : da u lat. premere
En italien, voilà quelques éléments glanés dans le dictionnaire Treccani :
1. Cura, sollecitudine verso persona, cosa, affare o problema che sta molto a cuore.
Atto di attenzione affettuosa con cui tale sollecitudine si manifesta; spesso al plurale : la ringrazio delle primure usatemi; aveva tutte le primure possibili per i suoi genitori.
2. Estensione : Urgenza, fretta.
Di premura, come locuzione : urgente o, anche, importante, che preme, che sta a cuore : è un affare di premura.
Antonia : Nos échanges ont donné naissance à une enquête-création sur le soin, la protection en Corse…
VBL : Oui, on va essayer de repérer ce qui en Corse, « hè di primura », ce qui fait l’objet de cette « primura ». Traditionnellement, le corpus littéraire l’atteste, les Corses témoignent force primura au-delà de leur communauté familiale, amicale ou « paisana ». Le lien qui circule naturellement entre locu & populu, ce qu’Augustin Berque appelle la relation mésologique, l’ont conduit à « primourer » aussi le vivant non humain. Côté animaux, on pourrait évoquer U Lamentu di Fasgianu, ou A morte di Filicone, et côté végétaux, il y a dans un texte comme U Lamentu di castagnu et plus largement dans les innombrables autres poèmes dédiés au châtaignier la marque d’une sacrée sollicitude.
Aujourd’hui, face aux intenses défis écologiques, on pourrait considérer que cette primura prend d’autres formes et qu’un de ses avatars se perçoit dans le combat mené pour le fleuve Tavignanu, et en particulier dans toutes les démarches entreprises pour que sa personnalité juridique soit reconnue. Ce ne sont que des intuitions, des recoupements, mais une enquête artistique devrait permettre de les approfondir.
Mais Vannina toi qui est psychiatre, psychanalyste et philosophe, quel regard portes-tu sur Medea ?
VMR : Pour ma part, je trouve que Médée est une figure fascinante, qui prête à de nombreuses interprétations, d’ailleurs elle a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, théâtrales, et cinématographiques : Euripide, Sénèque, Corneille, Anouilh, Christa Wolf et un film, celui de Pasolini. Elle est tantôt perçue comme une victime de l’oppression patriarcale, tantôt comme une incarnation du mal. Des auteurs comme Jean Anouilh et Heiner Müller ont revisité son histoire, en mettant en avant des thèmes contemporains tels que l’émancipation féminine ou les conséquences de l’exil. C’est aussi une figure intemporelle qui interroge sur la nature humaine, les limites de la justice, et la complexité des relations humaines. Elle illustre à quel point l’amour, la trahison et la vengeance peuvent transformer un individu en une figure tragique et universelle.
Antonia semble souhaiter restaurer l’identité première de Médée, et s’intéresser aux versions de Médée d’avant le texte d’Euripide. Ça m’intéresse qu’elle souligne que « Médée » ait la même racine que « médecine », qu’elle était à l'origine sage-femme, et qu’en la défigurant, c'est la sagesse elle-même qui a été dénaturée, coupée de sa fonction soignante, aimante : Médée c'est Terre/Mère et médiation, elle indique le milieu au sens de l’équilibre, et c'est aussi la petite fille du soleil.
Antonia, comment comprends-tu toutes ces facettes de Médée ?
Antonia semble souhaiter restaurer l’identité première de Médée, et s’intéresser aux versions de Médée d’avant le texte d’Euripide. Ça m’intéresse qu’elle souligne que « Médée » ait la même racine que « médecine », qu’elle était à l'origine sage-femme, et qu’en la défigurant, c'est la sagesse elle-même qui a été dénaturée, coupée de sa fonction soignante, aimante : Médée c'est Terre/Mère et médiation, elle indique le milieu au sens de l’équilibre, et c'est aussi la petite fille du soleil.
Antonia, comment comprends-tu toutes ces facettes de Médée ?
Antonia :
Oui, Médée est fascinante. Je cherche à comprendre cette fascination : il s’agit d’un figement. Cette image de l’infanticide est si forte, si puissante : nous n’arrivons pas à nous en détacher. Or le mythe doit être pluriel, sa nature est la plasticité, à chaque génération de s’en emparer et de participer à forger notre conscience. Nous cherchons, supposément, à faire évoluer notre société, à écrire de nouveaux « récits », et dans le même temps, nous restons « enfermés » dans une représentation de la femme qui est effroyablement dangereuse. Cela ne nous fait pas du bien.
En tant que dramaturge, je m’intéresse à la catharsis qui est le pouvoir supposément soignant du théâtre. Nous montrer des horreurs nous purifierait, préviendrait ces crimes ? J’ai réuni un groupe pluridisciplinaire pour ce projet et je travaille avec Donata Hoesch, sage-femme et psychologue et Sylvie Démoulin, infirmière et anthropologue sur ces questions. La recherche sur le traumatisme est claire : nous montrer des horreurs renforce nos traumas, et nous fige, nous rendant incapables de changer.
Que veut-on ? Continuer à représenter ad nauseam l’histoire improbable de cette femme infanticide, ou pourrions-nous créer, inventer ensemble des représentations qui nous rassurent, qui renforcent notre capacité aimante, soignante ? La force du personnage de Médée restauré dans son nature première est en effet d’incarner à la fois la figure du soin : Médée est médecienne [1], d’incarner la médiation, et de représenter la Terre Mère (Médée était probablement à l’origine une divinité, la Terre mère).
Conjuguer ces trois figures me semble important. Le fait que le verbe primurà soit réflexif et se conjugue seulement au pluriel répond à ce besoin de "conjugaison" : nous nous primourons [2]. Cela exprime magistralement que le soin est un équilibre entre nous, nous et le milieu dont nous sommes, il est prévention, protection. Ici encore la culture corse a beaucoup à nous enseigner.
Avec Nathalie Goedert, chercheure en Droit à l’Université de Corse, nous avons commencé l’enquête dans le cadre de sa proposition « Sensible Droit ». Le Droit est fondé sur nos récits, sur nos paradigmes, Nathalie défend une proposition qui peut sembler de prime à bord surprenante : elle propose de réinventer le Droit par une approche sensible, culturelle, artistique.
En fait, c’est évident, ce n’est que par une approche sensible que l’équilibre, la justesse, l’harmonie peuvent être trouvés. La recherche de l’harmonie est le fondement du Droit, cela demande de l’observation, de l’écoute, de la compréhension de nos inter-relations, de la médiation : c’est « médéen » [3].
Oui, Médée est fascinante. Je cherche à comprendre cette fascination : il s’agit d’un figement. Cette image de l’infanticide est si forte, si puissante : nous n’arrivons pas à nous en détacher. Or le mythe doit être pluriel, sa nature est la plasticité, à chaque génération de s’en emparer et de participer à forger notre conscience. Nous cherchons, supposément, à faire évoluer notre société, à écrire de nouveaux « récits », et dans le même temps, nous restons « enfermés » dans une représentation de la femme qui est effroyablement dangereuse. Cela ne nous fait pas du bien.
En tant que dramaturge, je m’intéresse à la catharsis qui est le pouvoir supposément soignant du théâtre. Nous montrer des horreurs nous purifierait, préviendrait ces crimes ? J’ai réuni un groupe pluridisciplinaire pour ce projet et je travaille avec Donata Hoesch, sage-femme et psychologue et Sylvie Démoulin, infirmière et anthropologue sur ces questions. La recherche sur le traumatisme est claire : nous montrer des horreurs renforce nos traumas, et nous fige, nous rendant incapables de changer.
Que veut-on ? Continuer à représenter ad nauseam l’histoire improbable de cette femme infanticide, ou pourrions-nous créer, inventer ensemble des représentations qui nous rassurent, qui renforcent notre capacité aimante, soignante ? La force du personnage de Médée restauré dans son nature première est en effet d’incarner à la fois la figure du soin : Médée est médecienne [1], d’incarner la médiation, et de représenter la Terre Mère (Médée était probablement à l’origine une divinité, la Terre mère).
Conjuguer ces trois figures me semble important. Le fait que le verbe primurà soit réflexif et se conjugue seulement au pluriel répond à ce besoin de "conjugaison" : nous nous primourons [2]. Cela exprime magistralement que le soin est un équilibre entre nous, nous et le milieu dont nous sommes, il est prévention, protection. Ici encore la culture corse a beaucoup à nous enseigner.
Avec Nathalie Goedert, chercheure en Droit à l’Université de Corse, nous avons commencé l’enquête dans le cadre de sa proposition « Sensible Droit ». Le Droit est fondé sur nos récits, sur nos paradigmes, Nathalie défend une proposition qui peut sembler de prime à bord surprenante : elle propose de réinventer le Droit par une approche sensible, culturelle, artistique.
En fait, c’est évident, ce n’est que par une approche sensible que l’équilibre, la justesse, l’harmonie peuvent être trouvés. La recherche de l’harmonie est le fondement du Droit, cela demande de l’observation, de l’écoute, de la compréhension de nos inter-relations, de la médiation : c’est « médéen » [3].
[1] Mot qui désignait une femme médecin jusqu’à ce que l’Académie Française décide de réserver les noms de métiers prestigieux seulement au masculin.
[2] Je dois cette belle explication de l’usage du verbe primurà à Ghjacumina Acquaviva que je remercie.
[3] Cf. « Le Droit ? Une partition ! » https://imaj.hypotheses.org/4477
VMR : J’ai toujours été intéressée par le livre de Christa Wolf, Médée : voix, paru en 1996.
En effet, dans ce roman, Christa Wolf réinterprète le mythe en donnant une perspective féministe et postmoderne. Elle réhabilite Médée, en la présentant non pas comme une meurtrière, mais comme une victime de manipulations politiques et de calomnies. L’infanticide n’a pas dans cette version. Le roman est construit comme une polyphonie de voix qui offrent différentes perspectives sur Médée, révélant une femme forte, savante, et persécutée. La marginalisation des femmes, la manipulation politique, et la réinterprétation des mythes sont alors vus sous un prisme contemporain.
Qu’en penses-tu Antonia ?
En effet, dans ce roman, Christa Wolf réinterprète le mythe en donnant une perspective féministe et postmoderne. Elle réhabilite Médée, en la présentant non pas comme une meurtrière, mais comme une victime de manipulations politiques et de calomnies. L’infanticide n’a pas dans cette version. Le roman est construit comme une polyphonie de voix qui offrent différentes perspectives sur Médée, révélant une femme forte, savante, et persécutée. La marginalisation des femmes, la manipulation politique, et la réinterprétation des mythes sont alors vus sous un prisme contemporain.
Qu’en penses-tu Antonia ?
Antonia :
Le roman de Christa Wolf est en effet excellent. Toutefois, j’ai regretté qu’il s’agisse d’un roman et non d’une pièce de théâtre : Médée est une figure théâtrale centrale. C’est sûrement l’une des pièces les plus jouées, les plus enseignées dans les cours de théâtre. Toujours pour la même raison, parce que ce personnage est fascinant. Il est donc important que sa réhabilitation ait lieu au théâtre.
Le mythe a été perverti, dénaturé, jusqu’à être inversé : Médée, Terre-Mère, médiatrice, médecienne a été faite d’abord fratricide, puis parricide puis infanticide ! Arrivé à l’infanticide : on ne pouvait pas faire pire, alors on en est resté là ! Ainsi, comme tu l’as rappelé, il y a eu de très nombreuses versions depuis Euripide, mais Médée y est toujours infanticide au théâtre.
J’ai entrepris une enquête dramaturgique d’après les fragments des versions archaïques, notamment à partir du travail magistral de Alain Moreau Le mythe de Jason et Médée . J’ai écrit une pièce sous la forme d’une enquête à la fois dramaturgique et poétique : j’ai tenté de construire des images pour contrer la représentation d’Euripide, pour soigner notre imaginaire, pour montrer le courage, la puissance soignante à l’œuvre.
Les enfants sont morts, Médée invoque son grand-père, Hélios, et lui demande de la brûler, petite fille du soleil, elle absorbe la lumière par tous les pores de sa peau, des racines lui poussent sous ses pieds ce qui lui permet de rejoindre ses enfants sous la terre.
Voilà le genre de force surnaturelle dont les soignantes sont capables. Malheureusement, elles sont humaines, elles ne se métamorphosent pas en arbre, elles brûlent : le nombre de burn out dans le secteur de la santé est effroyable. Le secteur santé et action sociale présente le taux de mortalité par suicide le plus élevé [1]. La tragédie contemporaine se joue là : de jour, de nuit, des soignantes, hommes et femmes s’épuisent à la tâche pour nous soigner. Aujourd’hui, ce sont eux qui ont le plus grand besoin de soin. Comment notre monde pourrait-il se porter bien, si les soignants sont maltraités ?
Dans la pièce que nous sommes en train de créer, nous menons avec Cathy Pollini, chorégraphe, Alma Rechtman, musicienne, et Vannina Bernard-Leoni une enquête artistique pour chercher comment restaurer notre nature soignante. Notre nature primoureuse qui inclut le soin aux humains et le soin à la nature. Nous sommes des êtres soignants, lorsque nous ne le sommes pas, c’est que nous n’allons pas bien. A cela un remède : s’arrêter, se reposer. Se pourrait-il que la tragédie s’arrête là ? Je le crois : reposez-vous, faites-vous du bien !
Il y a en Corse une merveilleuse intelligence du rythme, des rites. Rites et rythmes ont même racine.
Vannina BL, comment pourrions-nous avec notre projet Primour réinventer nos rites, nos rythmes, réinventer leur intelligence sensible ?
Le roman de Christa Wolf est en effet excellent. Toutefois, j’ai regretté qu’il s’agisse d’un roman et non d’une pièce de théâtre : Médée est une figure théâtrale centrale. C’est sûrement l’une des pièces les plus jouées, les plus enseignées dans les cours de théâtre. Toujours pour la même raison, parce que ce personnage est fascinant. Il est donc important que sa réhabilitation ait lieu au théâtre.
Le mythe a été perverti, dénaturé, jusqu’à être inversé : Médée, Terre-Mère, médiatrice, médecienne a été faite d’abord fratricide, puis parricide puis infanticide ! Arrivé à l’infanticide : on ne pouvait pas faire pire, alors on en est resté là ! Ainsi, comme tu l’as rappelé, il y a eu de très nombreuses versions depuis Euripide, mais Médée y est toujours infanticide au théâtre.
J’ai entrepris une enquête dramaturgique d’après les fragments des versions archaïques, notamment à partir du travail magistral de Alain Moreau Le mythe de Jason et Médée . J’ai écrit une pièce sous la forme d’une enquête à la fois dramaturgique et poétique : j’ai tenté de construire des images pour contrer la représentation d’Euripide, pour soigner notre imaginaire, pour montrer le courage, la puissance soignante à l’œuvre.
Les enfants sont morts, Médée invoque son grand-père, Hélios, et lui demande de la brûler, petite fille du soleil, elle absorbe la lumière par tous les pores de sa peau, des racines lui poussent sous ses pieds ce qui lui permet de rejoindre ses enfants sous la terre.
Voilà le genre de force surnaturelle dont les soignantes sont capables. Malheureusement, elles sont humaines, elles ne se métamorphosent pas en arbre, elles brûlent : le nombre de burn out dans le secteur de la santé est effroyable. Le secteur santé et action sociale présente le taux de mortalité par suicide le plus élevé [1]. La tragédie contemporaine se joue là : de jour, de nuit, des soignantes, hommes et femmes s’épuisent à la tâche pour nous soigner. Aujourd’hui, ce sont eux qui ont le plus grand besoin de soin. Comment notre monde pourrait-il se porter bien, si les soignants sont maltraités ?
Dans la pièce que nous sommes en train de créer, nous menons avec Cathy Pollini, chorégraphe, Alma Rechtman, musicienne, et Vannina Bernard-Leoni une enquête artistique pour chercher comment restaurer notre nature soignante. Notre nature primoureuse qui inclut le soin aux humains et le soin à la nature. Nous sommes des êtres soignants, lorsque nous ne le sommes pas, c’est que nous n’allons pas bien. A cela un remède : s’arrêter, se reposer. Se pourrait-il que la tragédie s’arrête là ? Je le crois : reposez-vous, faites-vous du bien !
Il y a en Corse une merveilleuse intelligence du rythme, des rites. Rites et rythmes ont même racine.
Vannina BL, comment pourrions-nous avec notre projet Primour réinventer nos rites, nos rythmes, réinventer leur intelligence sensible ?
[1] Source : Santé publique France.
VBL: Pendant longtemps, j’ai regardé le théâtre surtout à travers la question du texte. Juste comme une forme littéraire. Ce n’est que très récemment que j’ai mieux perçu et compris la dimension politique d’une expérience partagée. La force d’un espace-temps commun à mobiliser pour faire communauté. Et à partir de là, prendre des forces pour refaire société. C’est ce qui me plaît et m’attire dans le théâtre et dans les formes participatives : cette façon de se représenter, de se présenter les choses à nouveau. Pour régénérer une relation. Faire des choses ensemble, c’est fondateur. Le vivre ensemble, ça ne se décrète pas ! ça s’éprouve dans le faire ensemble, dans le ressentir ensemble, dans le marcher ensemble, dans le manger ensemble…
Et toi Vannina, en tant que philosophe et médecin, peux-tu nous dire comment les mythes nous habitent, comment ils participent à notre construction mentale ?
Et toi Vannina, en tant que philosophe et médecin, peux-tu nous dire comment les mythes nous habitent, comment ils participent à notre construction mentale ?
VMR :
Ta question est essentielle car la relation entre les mythes et la psychanalyse est une thématique importante. En effet, elle révèle comment les structures narratives ancestrales et les récits culturels éclairent les mécanismes de l'inconscient. Freud et Lacan, figures centrales de la psychanalyse, ont tous deux exploré les liens entre les mythes et la psyché humaine, bien que leurs approches diffèrent.
Freud voit dans les mythes une expression collective de l’inconscient, un reflet des conflits psychiques universels. Le mythe d'Œdipe, par exemple, est central dans sa théorie. Il montre comment, dans le complexe d’Œdipe, un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, désir et rivalité envers les figures parentales se jouent inconsciemment. Les mythes permettent de mettre en lumière les pulsions humaines fondamentales, notamment celles liées à la sexualité et à l’agressivité.
La pensée de Jacques Lacan, influencée par Freud mais également enrichie par la linguistique, la philosophie et l'anthropologie, engage une relecture des mythes et met l’accent sur leur dimension structurelle et leur fonction dans le discours.
Par exemple, Lacan aborde le mythe d’Antigone dans son Séminaire VII : L'éthique de la psychanalyse. Antigone représente, pour Lacan, la figure du désir pur, c’est-à-dire, la fidélité absolue à son désir, même au prix de la mort. Elle incarne une position éthique où le sujet reste fidèle à son désir au-delà des compromis imposés par la société ou le pouvoir. Par cette analyse, Lacan montre comment le mythe met en scène les tensions entre l’ordre symbolique (la loi de Créon) et le réel du désir (l’engagement d’Antigone envers sa famille). Pour Lacan, les mythes ne sont donc pas simplement des récits révélant de l’expression des conflits psychiques universels, mais des constructions symboliques qui deviennent des points d’accès à la compréhension des mécanismes du langage et du réel, tout en éclairant les tensions entre loi, désir et jouissance dans la vie humaine.
Ta question est essentielle car la relation entre les mythes et la psychanalyse est une thématique importante. En effet, elle révèle comment les structures narratives ancestrales et les récits culturels éclairent les mécanismes de l'inconscient. Freud et Lacan, figures centrales de la psychanalyse, ont tous deux exploré les liens entre les mythes et la psyché humaine, bien que leurs approches diffèrent.
Freud voit dans les mythes une expression collective de l’inconscient, un reflet des conflits psychiques universels. Le mythe d'Œdipe, par exemple, est central dans sa théorie. Il montre comment, dans le complexe d’Œdipe, un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, désir et rivalité envers les figures parentales se jouent inconsciemment. Les mythes permettent de mettre en lumière les pulsions humaines fondamentales, notamment celles liées à la sexualité et à l’agressivité.
La pensée de Jacques Lacan, influencée par Freud mais également enrichie par la linguistique, la philosophie et l'anthropologie, engage une relecture des mythes et met l’accent sur leur dimension structurelle et leur fonction dans le discours.
Par exemple, Lacan aborde le mythe d’Antigone dans son Séminaire VII : L'éthique de la psychanalyse. Antigone représente, pour Lacan, la figure du désir pur, c’est-à-dire, la fidélité absolue à son désir, même au prix de la mort. Elle incarne une position éthique où le sujet reste fidèle à son désir au-delà des compromis imposés par la société ou le pouvoir. Par cette analyse, Lacan montre comment le mythe met en scène les tensions entre l’ordre symbolique (la loi de Créon) et le réel du désir (l’engagement d’Antigone envers sa famille). Pour Lacan, les mythes ne sont donc pas simplement des récits révélant de l’expression des conflits psychiques universels, mais des constructions symboliques qui deviennent des points d’accès à la compréhension des mécanismes du langage et du réel, tout en éclairant les tensions entre loi, désir et jouissance dans la vie humaine.
Antonia
Merci pour cet éclairage à partir de la philosophie et de la psychanalyse, j’y vois une confirmation de la nécessité de dépoussiérer nos mythes, pour qu’il joue un rôle structurant.
Pour moi, il y a dans la culture corse quelque chose de très campé ! fondé sur une intuition forte : on ne nous raconte pas n’importe quoi ! Et cela est certainement lié au fait que nous avons ce sens très fort des priorités, de ce qui doit être primouré. Nous savons aussi, que pour faire commun, nous devons nous réinventer, nous apprendre les uns les autres à être primoureux à nouveau.
Primuremuci ! Primourons-nous !
Merci pour cet éclairage à partir de la philosophie et de la psychanalyse, j’y vois une confirmation de la nécessité de dépoussiérer nos mythes, pour qu’il joue un rôle structurant.
Pour moi, il y a dans la culture corse quelque chose de très campé ! fondé sur une intuition forte : on ne nous raconte pas n’importe quoi ! Et cela est certainement lié au fait que nous avons ce sens très fort des priorités, de ce qui doit être primouré. Nous savons aussi, que pour faire commun, nous devons nous réinventer, nous apprendre les uns les autres à être primoureux à nouveau.
Primuremuci ! Primourons-nous !
Pour aller plus loin
Antonia Taddei est co-directrice de la compagnie Xtnt, spécialiste de créations pluridisciplinaires et participatives. Elle a conçu des programmes artistiques innovants, notamment pour Mons, Capitale Européenne de la Culture, impliquant plus de 900 habitants. Actuellement, elle travaille sur des projets en France, Angleterre et Sénégal et également en Corse où elle crée Primour.
Vannina Micheli-Rechtman est médecin psychiatre, psychanalyste et philosophe. Présidente d'Espace Analytique et chercheure associée à l'Université Paris Diderot- Paris Cité. Elle est spécialiste des troubles des conduites alimentaires et des représentations du corps et des images contemporaines. A publié Les Nouvelles beautés fatales- Les troubles des conduites alimentaires comme pathologies de l’image. (Erès, 2022) La Psychanalyse face à ses détracteurs (Flammarion 2010), a co-dirigé Du Cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé ( Eres 2013).
Vannina Micheli-Rechtman est médecin psychiatre, psychanalyste et philosophe. Présidente d'Espace Analytique et chercheure associée à l'Université Paris Diderot- Paris Cité. Elle est spécialiste des troubles des conduites alimentaires et des représentations du corps et des images contemporaines. A publié Les Nouvelles beautés fatales- Les troubles des conduites alimentaires comme pathologies de l’image. (Erès, 2022) La Psychanalyse face à ses détracteurs (Flammarion 2010), a co-dirigé Du Cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé ( Eres 2013).