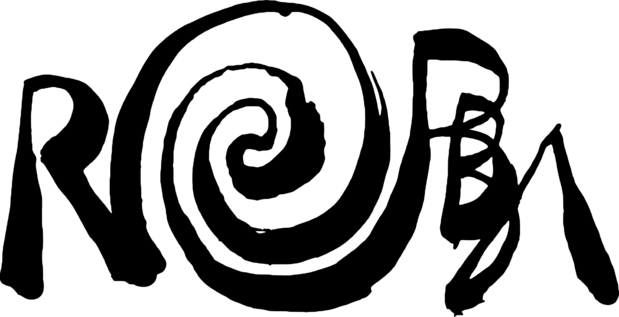Robba : À quand remonte la pratique de la mandoline en Corse ?
Antoine-Marie Leonelli : Née en Italie, pendant la Renaissance, la mandoline a connu un âge d’or en Europe à partir des années 1880 et la Corse a largement vécu cette formidable aventure musicale.
L’essor de l’instrument s’explique en partie techniquement à mes yeux : si la mandoline devient si populaire, c’est notamment parce qu’elle est plus facile d’accès que le violon : ça sonne vite et bien. Cela ouvre une possibilité de répertoires variés : classique, traditionnel ou contemporain. On peut citer des compositions de Vivaldi, Scarlatti, Beethoven, Mozart, Johann Nepomuk Hummel, puis à l’époque romantique Munier, Calace …
La presse de l’époque révèle que les formations insulaires étaient nombreuses. Constitués sous la forme d’estudiantines, ces ensembles à plectre comprenaient les différents membres de la famille des cordes pincées : mandoline, mandole, mandoloncelle et guitare. C’est l’équivalent du quatuor à cordes frottées composé du violon, alto et violoncelle. Ce qui est intéressant avec le concept d’estudiantine, c’est qu’il permettait en même temps d’apprendre la musique de façon collective et de participer à un petit orchestre pour les occasions festives de la communauté. On jouait et on apprenait. On y apprenait notamment à lire la musique écrite.
L’Estudiantina Ajaccienne est la plus ancienne société musicale de Corse, créée en 1909 – et elle est toujours en activité. Alors présidée par un certain Pierre Zonza, l’Estudiantina Ajaccienne parrainera une Estudiantine à Corti, presque exclusivement féminine, dans les années 1920.
D’un point de vue plus académique, c’est au Conservatoire de musique de Marseille que fut créée la première classe de mandoline en Europe, juste après la Première guerre mondiale. Elle fut confiée à l'un des plus célèbres mandolinistes de l'époque, Laurent Fantauzzi (1875-1941), ami de Saint-Saëns et Massenet, né en Italie. Les descendants de Laurent Fantauzzi, les Luccioni, vivent en Corse et font apprécier les œuvres de Fantauzzi sur l'île.
Un autre mandoliniste de cette époque a lui aussi marqué l’île d’une empreinte indélébile : François Menichetti (1894-1969), compositeur, chef d'orchestre et mandoliniste bastiais connu sous le pseudonyme de François de Toga.
Antoine-Marie Leonelli : Née en Italie, pendant la Renaissance, la mandoline a connu un âge d’or en Europe à partir des années 1880 et la Corse a largement vécu cette formidable aventure musicale.
L’essor de l’instrument s’explique en partie techniquement à mes yeux : si la mandoline devient si populaire, c’est notamment parce qu’elle est plus facile d’accès que le violon : ça sonne vite et bien. Cela ouvre une possibilité de répertoires variés : classique, traditionnel ou contemporain. On peut citer des compositions de Vivaldi, Scarlatti, Beethoven, Mozart, Johann Nepomuk Hummel, puis à l’époque romantique Munier, Calace …
La presse de l’époque révèle que les formations insulaires étaient nombreuses. Constitués sous la forme d’estudiantines, ces ensembles à plectre comprenaient les différents membres de la famille des cordes pincées : mandoline, mandole, mandoloncelle et guitare. C’est l’équivalent du quatuor à cordes frottées composé du violon, alto et violoncelle. Ce qui est intéressant avec le concept d’estudiantine, c’est qu’il permettait en même temps d’apprendre la musique de façon collective et de participer à un petit orchestre pour les occasions festives de la communauté. On jouait et on apprenait. On y apprenait notamment à lire la musique écrite.
L’Estudiantina Ajaccienne est la plus ancienne société musicale de Corse, créée en 1909 – et elle est toujours en activité. Alors présidée par un certain Pierre Zonza, l’Estudiantina Ajaccienne parrainera une Estudiantine à Corti, presque exclusivement féminine, dans les années 1920.
D’un point de vue plus académique, c’est au Conservatoire de musique de Marseille que fut créée la première classe de mandoline en Europe, juste après la Première guerre mondiale. Elle fut confiée à l'un des plus célèbres mandolinistes de l'époque, Laurent Fantauzzi (1875-1941), ami de Saint-Saëns et Massenet, né en Italie. Les descendants de Laurent Fantauzzi, les Luccioni, vivent en Corse et font apprécier les œuvres de Fantauzzi sur l'île.
Un autre mandoliniste de cette époque a lui aussi marqué l’île d’une empreinte indélébile : François Menichetti (1894-1969), compositeur, chef d'orchestre et mandoliniste bastiais connu sous le pseudonyme de François de Toga.
Robba: Comment se transmettait la pratique de la mandoline sur une île sans conservatoire ?
AML: À Corte par exemple, les mandolinistes et guitaristes amateurs ont toujours été très nombreux depuis un siècle, comme en témoignent les instruments suspendus dans les nombreux bars de la ville, transmettant cette pratique de génération en génération, le plus souvent d’oreille, sans avoir besoin de partitions toujours difficiles à obtenir. Cette tradition orale a permis l’éclosion de nombreux talents, qui pouvaient laisser libre cours à leur interprétation et leur imagination, finalement sans être bridés par l’écriture.
À partir des années 1930 ce sont les différentes formations folkloriques qui ont valorisé la mandoline en Corse comme A Serinata Aiaccina à Ajaccio, I Machjaghjoli et I Marinari à Bastia ; tandis qu’à Corte, le remarquable travail de Jacques Luciani et de la Mannella di Corti dans les années 1950, ont également contribué à perpétuer la pratique de cet instrument et la diffusion de son répertoire jusqu’aux années 1980.
Ces formations ont été des lieux d’adaptation de répertoires : ainsi la tradition orale corse a adopté et adapté des morceaux venus d’ailleurs. On peut citer Niña Pancha de José Garcia qui est devenue Nina Panca ou e frittelle, paso doble en introduction des sérénades cortenaises ; ou Flocon de Neige de G. Ginhoux, devenu Vendanges en Balagne. Doux murmure s’est mué en Valsu di i sartori ou Valse en do ou encore Tarentella avec a Mannella. Nuits florentines de Mario Macciochi a été rebaptisé Notte curtinese.
Pour vos beaux yeux bleus de Jean Giannoni est devenue Valsu curtinese par la grâce d’a Mannella qui a aussi transformé Napoli de E. Mezacapo en Corsica valse ! Ce sont des pièces majeures pour la mandoline en Corse.
AML: À Corte par exemple, les mandolinistes et guitaristes amateurs ont toujours été très nombreux depuis un siècle, comme en témoignent les instruments suspendus dans les nombreux bars de la ville, transmettant cette pratique de génération en génération, le plus souvent d’oreille, sans avoir besoin de partitions toujours difficiles à obtenir. Cette tradition orale a permis l’éclosion de nombreux talents, qui pouvaient laisser libre cours à leur interprétation et leur imagination, finalement sans être bridés par l’écriture.
À partir des années 1930 ce sont les différentes formations folkloriques qui ont valorisé la mandoline en Corse comme A Serinata Aiaccina à Ajaccio, I Machjaghjoli et I Marinari à Bastia ; tandis qu’à Corte, le remarquable travail de Jacques Luciani et de la Mannella di Corti dans les années 1950, ont également contribué à perpétuer la pratique de cet instrument et la diffusion de son répertoire jusqu’aux années 1980.
Ces formations ont été des lieux d’adaptation de répertoires : ainsi la tradition orale corse a adopté et adapté des morceaux venus d’ailleurs. On peut citer Niña Pancha de José Garcia qui est devenue Nina Panca ou e frittelle, paso doble en introduction des sérénades cortenaises ; ou Flocon de Neige de G. Ginhoux, devenu Vendanges en Balagne. Doux murmure s’est mué en Valsu di i sartori ou Valse en do ou encore Tarentella avec a Mannella. Nuits florentines de Mario Macciochi a été rebaptisé Notte curtinese.
Pour vos beaux yeux bleus de Jean Giannoni est devenue Valsu curtinese par la grâce d’a Mannella qui a aussi transformé Napoli de E. Mezacapo en Corsica valse ! Ce sont des pièces majeures pour la mandoline en Corse.
Robba: À partir des années 1970, le regard sur les groupes folkloriques et sur la mandoline a changé…
AML: Oui, le Riacquistu s’est construit sur une sorte d’anathème jeté sur ces formations, qui ont été ringardisées, et la mandoline a été une victime collatérale. L’époque n’a malheureusement pas posé un regard très objectif sur cet instrument, focalisant davantage sur la cètera, dont la découverte alors récente nourrissait beaucoup d’espoirs – et de fantasmes.
Il faut savoir que la mandoline a été créée sensiblement au même moment et au même endroit que le violon, à savoir dans l’Italie de la Renaissance. Il existait alors plusieurs types de mandolines (génoise, milanaise, …) mais c’est la « napolitaine » qui s’est imposée. Elle est accordée comme le violon, avec des cordes doubles et métalliques. On la joue avec un plectre ou médiator ; en corse « a piuma ».
Malgré cette origine commune, les acteurs et militants culturels de l’époque ne l’ont pas considérée comme un instrument digne d’intérêt. Comme le quadrille, elle semblait être jugée comme un apport trop récent et a été à ce titre écartée. Je pense qu’ils n’ont pas mesuré le caractère traditionnel et populaire de pratiques qui faisaient pourtant complètement partie du paysage musical de notre île.
Il faut néanmoins toujours nuancer, car on entend quand même un peu de mandoline dans des morceaux de Canta u pòpulu corsu, à l’initiative de Minicale, ou dans des titres des Chjami Aghjalesi…
AML: Oui, le Riacquistu s’est construit sur une sorte d’anathème jeté sur ces formations, qui ont été ringardisées, et la mandoline a été une victime collatérale. L’époque n’a malheureusement pas posé un regard très objectif sur cet instrument, focalisant davantage sur la cètera, dont la découverte alors récente nourrissait beaucoup d’espoirs – et de fantasmes.
Il faut savoir que la mandoline a été créée sensiblement au même moment et au même endroit que le violon, à savoir dans l’Italie de la Renaissance. Il existait alors plusieurs types de mandolines (génoise, milanaise, …) mais c’est la « napolitaine » qui s’est imposée. Elle est accordée comme le violon, avec des cordes doubles et métalliques. On la joue avec un plectre ou médiator ; en corse « a piuma ».
Malgré cette origine commune, les acteurs et militants culturels de l’époque ne l’ont pas considérée comme un instrument digne d’intérêt. Comme le quadrille, elle semblait être jugée comme un apport trop récent et a été à ce titre écartée. Je pense qu’ils n’ont pas mesuré le caractère traditionnel et populaire de pratiques qui faisaient pourtant complètement partie du paysage musical de notre île.
Il faut néanmoins toujours nuancer, car on entend quand même un peu de mandoline dans des morceaux de Canta u pòpulu corsu, à l’initiative de Minicale, ou dans des titres des Chjami Aghjalesi…
Robba: Mais comment est-il possible de définir ce qu’est un instrument traditionnel ?
AML: La cètera et la mandoline ne sont pas à opposer ni à mettre en concurrence, mais la mandoline est un instrument de la tradition, transmis de génération en génération, sans interruption. De son côté, la cètera a suscité beaucoup d’intérêt, de recherche et de re-création ; cette démarche est tout à fait intéressante mais les enquêtes n’ont pu combler toutes les lacunes. Peu d’instruments ont été retrouvés, aucune trace dans les archives sonores historiques, aucun témoin vivant en capacité de jouer de façon traditionnelle.
Aucune partition retrouvée. Seul le manuscrit de Stefano Allegrini datant de 1720 retrouvé au couvent de Marcassu en Balagne témoigne d’une pratique populaire et recense une trentaine de danses. Malheureusement, il s’agit de tablatures (sans notations rythmiques) et l’accordage initial de l’instrument n’est pas mentionné, ce qui rend le document difficile à exploiter. De plus, parmi la dizaine d’instruments retrouvés, on peut constater d’importantes différences de lutherie, au niveau du manche en particulier : certaines possèdent un tempérament égal, d’autres un tempérament inégal, avec frettage chromatique et parfois diatonique.
La tradition de la cètera n’a hélas pas été maintenue, et malgré les suggestions et le remarquable travail di e Voce di u Cumune, l’accordage de l’époque n’a pas pu être clairement identifié. C’est pour cette raison que je préfère parler d’instrument patrimonial et de réserver celui de traditionnel pour ceux dont la pratique n’a pas connu d’interruption longue.
Depuis, différents accords ont été proposés, des cistres ont été reconstruits, des modèles (ceterine et ceterone) ont été inventés et certains compositeurs ont même écrit pour cette cètera dont la sonorité des corde métalliques doublées nous ramène à notre mandoline, à la guitare portugaise ou encore au bouzouki grec…
AML: La cètera et la mandoline ne sont pas à opposer ni à mettre en concurrence, mais la mandoline est un instrument de la tradition, transmis de génération en génération, sans interruption. De son côté, la cètera a suscité beaucoup d’intérêt, de recherche et de re-création ; cette démarche est tout à fait intéressante mais les enquêtes n’ont pu combler toutes les lacunes. Peu d’instruments ont été retrouvés, aucune trace dans les archives sonores historiques, aucun témoin vivant en capacité de jouer de façon traditionnelle.
Aucune partition retrouvée. Seul le manuscrit de Stefano Allegrini datant de 1720 retrouvé au couvent de Marcassu en Balagne témoigne d’une pratique populaire et recense une trentaine de danses. Malheureusement, il s’agit de tablatures (sans notations rythmiques) et l’accordage initial de l’instrument n’est pas mentionné, ce qui rend le document difficile à exploiter. De plus, parmi la dizaine d’instruments retrouvés, on peut constater d’importantes différences de lutherie, au niveau du manche en particulier : certaines possèdent un tempérament égal, d’autres un tempérament inégal, avec frettage chromatique et parfois diatonique.
La tradition de la cètera n’a hélas pas été maintenue, et malgré les suggestions et le remarquable travail di e Voce di u Cumune, l’accordage de l’époque n’a pas pu être clairement identifié. C’est pour cette raison que je préfère parler d’instrument patrimonial et de réserver celui de traditionnel pour ceux dont la pratique n’a pas connu d’interruption longue.
Depuis, différents accords ont été proposés, des cistres ont été reconstruits, des modèles (ceterine et ceterone) ont été inventés et certains compositeurs ont même écrit pour cette cètera dont la sonorité des corde métalliques doublées nous ramène à notre mandoline, à la guitare portugaise ou encore au bouzouki grec…
Robba: À l’inverse pour la mandoline on a des traces écrites ?
AML: Quand nous avons créé l’association Mandeo, Claire Luzi, mandoliniste professionnelle et nièce du célèbre Charles Luzi, nous a fait don des cahiers de musique de son grand-oncle, à l’époque où il performait au sein l’Estudiantina Ajaccienne.
En 2020, avec Bernard Pazzoni j’ai réalisé l’inventaire du fonds Pierre Zonza, partitions déposées par l’Estudiantine Ajaccienne au Musée de la Corse. Puis avec Sandrine Luigi et Livia-Maria Bartoli, nous avons réalisé l’inventaire du fonds musical Prelà de Bastia. Ce fonds s’ajoute à celui de Sébastien Colombani, mandoliniste de l’Estudiantine Ajaccienne et compositeur, déjà présent au Musée de la Corse depuis les années 2000.
En tout, ce sont plus de 1000 titres joués par les différents estudiantines de l’île qui y sont représentées. Cette ressource considérable démontre la vivacité des orchestres présents en Corse. En effet, les pièces de François Menighetti et Laurent Fantauzzi y sont présentes aux cotés de compositeurs très populaires aussi pour orchestres à plectres comme C. Munier, M. Macciochi, A. Manetti et E. Mezacapo.
On constate également la présence des standards de la musique « classiques » comme W. A. Mozart, Verdi, Rossini, Puccini, Schubert, et ce répertoire (sous forme de partitions, matériels et conducteurs, réorchestré pour mandoline, mandole, mandoloncelle et guitare) atteste la richesse et la mixité des répertoires pratiqués par les mandolinistes insulaires au début du XXe siècle.
AML: Quand nous avons créé l’association Mandeo, Claire Luzi, mandoliniste professionnelle et nièce du célèbre Charles Luzi, nous a fait don des cahiers de musique de son grand-oncle, à l’époque où il performait au sein l’Estudiantina Ajaccienne.
En 2020, avec Bernard Pazzoni j’ai réalisé l’inventaire du fonds Pierre Zonza, partitions déposées par l’Estudiantine Ajaccienne au Musée de la Corse. Puis avec Sandrine Luigi et Livia-Maria Bartoli, nous avons réalisé l’inventaire du fonds musical Prelà de Bastia. Ce fonds s’ajoute à celui de Sébastien Colombani, mandoliniste de l’Estudiantine Ajaccienne et compositeur, déjà présent au Musée de la Corse depuis les années 2000.
En tout, ce sont plus de 1000 titres joués par les différents estudiantines de l’île qui y sont représentées. Cette ressource considérable démontre la vivacité des orchestres présents en Corse. En effet, les pièces de François Menighetti et Laurent Fantauzzi y sont présentes aux cotés de compositeurs très populaires aussi pour orchestres à plectres comme C. Munier, M. Macciochi, A. Manetti et E. Mezacapo.
On constate également la présence des standards de la musique « classiques » comme W. A. Mozart, Verdi, Rossini, Puccini, Schubert, et ce répertoire (sous forme de partitions, matériels et conducteurs, réorchestré pour mandoline, mandole, mandoloncelle et guitare) atteste la richesse et la mixité des répertoires pratiqués par les mandolinistes insulaires au début du XXe siècle.
Robba: Vous, à titre personnel comment avez-vous rencontré la mandoline ?
AML: Corte a été une sorte de petit conservatoire de la mandoline ! Grâce bien sûr à A Mannella mais aussi grâce à la présence fréquente dans les bars de mandolines et de mandolinistes qui ont été de véritables passeurs. Ils étaient très présents jusque dans les années 1980, et encore visibles dans les années 2000. En tant que Cortenais, je suis sans doute un fruit de cette tradition musicale !
Je voudrais citer Petru Filippi (di Rocca), Antoine Blanchenoix (Murghjinu), Antoine Albertini (colosse), Martin Pellicciotti, Gaston Pieri, Ange Toma et ses enfant Tony et Don-Jean, Ernest Agostini, François Bacchioni, Christian Ori, Marius Garsi (tonton Ninì), Lulu Costa, Ghjuacchinu Martinetti, Dumè Gambini, Battì de Nobili, Noël Martelli, Paul Natalini d’Erbaghjolu et tant d’autres…
Tonton Ninì, membre d’a Mannella, a été le premier à me mettre une guitare dans les mains. Chez lui, il y avait toutes sortes d’instruments de musique du monde et ça me fascinait. Avec quelques membres du groupe cortenais (comme feu Bébé Mariani et Silvè Zuccarelli (Machjerolu), il avait repris le flambeau du festival folklorique du regretté Jacques Luciani. Il avait, entre autres, une mandoline dont il jouait occasionnellement.
Après que le père Noël de mes 10 ans eut déposé une guitare électrique au pied du sapin, j’ai fini par aborder la guitare classique, avec Christian Filori ; puis le violon traditionnel et la mandoline, aux ateliers du Musée de la Corse à l’adolescence, avec Bernard Pazzoni pour le violon et René Vallecalle pour la mandoline.
De 16 à 26 ans, j’ai beaucoup travaillé le violon et notamment avec Minicale… mais je n’ai jamais totalement délaissé la mandoline: je l’ai utilisée dans Canta u Pòpulu Corsu, Tutti in Piazza, Caramusa, Voce Ventu ou I Surghjenti, Chjar’di Luna…
Robba: Le projet de festival des Notte di a Mandulina naît en 2017, vous y pensiez depuis longtemps ?
AML: À Corte, on a tous en mémoire le festival folklorique de Jacques Luciani, qui assurait le lien entre la tradition portée par A Mannella et les cultures invitées qui permettaient de découvrir chaque année des musiques et des danses venues d’ailleurs.
Aujourd’hui encore, si les Cortenais sont sensibles à ces échanges et curieux de ces formes musicales, c’est grâce à l’héritage culturel que ce festival a laissé dans les mémoires. Cela a certainement eu un effet positif sur ma propre trajectoire.
Un autre moment-clef qui a conduit à la création du festival, c’est la rencontre avec Patrick Vaillant. Musicien et arrangeur de talent, qui s’intéresse au patrimoine musical traditionnel provençal. En Corse, il était connu parce qu’il avait signé l’arrangement d’a Moresca (2001) de Jackie Micaelli.
Bref, il vient animer un stage de mandoline, on discute, on découvre qu’il a créé le Front de libération de la mandoline ! L’idée nous amuse d’abord et nous inspire ensuite. En 2013, il nous invite, Antoine Belgodere, Minicale, Batti de Nobili et Jean-Brice Cordier, à son festival Mandopolis, dans l’arrière-pays niçois, à Puget-Théniers où il a réussi à fidéliser un public pour un rendez-vous estival exclusivement autour de cet instrument à cordes. Ça nous a marqués, notamment le dispositif des « impromptus » qu’on a repris ensuite pour nos Notte di a mandulina : le principe de balades musicales à travers les rues.
Puis avec Tàlcini, on a été invités au festival Berlioz, en Isère, en 2015 : on avait orienté notre programme autour de la mandoline. Cela nous a conduits, à notre retour, à retrouver Ange Lanzalavi que nous ne fréquentions qu’occasionnellement. Après, ça s’est enchaîné parce qu’on avait envie de structurer quelque chose autour de la mandoline.
L’association Mandeo a été créée fin 2017 : dès février 2018, on a participé à l’organisation de la première Académie Internationale de mandoline en Corse, et en août, la première édition du festival sur l’esplanade San Teòfalu. Très modeste, sur une seule soirée, mais déjà 600 personnes ! Première grosse surprise !
Et très majoritairement des Cortenais, deuxième très grosse surprise ! On a vraiment mesuré à ce moment-là leur attachement à la mandoline. Le son de ce si petit instrument et l’évocation du répertoire qui lui était associé avaient provoqué une émotion extraordinaire ! La joie de réentendre ces notes trémolées était palpable. On aurait dit que le festival avait toujours existé, et que ce rendez-vous était familier. On a compris qu’il fallait poursuivre et développer.
AML: À Corte, on a tous en mémoire le festival folklorique de Jacques Luciani, qui assurait le lien entre la tradition portée par A Mannella et les cultures invitées qui permettaient de découvrir chaque année des musiques et des danses venues d’ailleurs.
Aujourd’hui encore, si les Cortenais sont sensibles à ces échanges et curieux de ces formes musicales, c’est grâce à l’héritage culturel que ce festival a laissé dans les mémoires. Cela a certainement eu un effet positif sur ma propre trajectoire.
Un autre moment-clef qui a conduit à la création du festival, c’est la rencontre avec Patrick Vaillant. Musicien et arrangeur de talent, qui s’intéresse au patrimoine musical traditionnel provençal. En Corse, il était connu parce qu’il avait signé l’arrangement d’a Moresca (2001) de Jackie Micaelli.
Bref, il vient animer un stage de mandoline, on discute, on découvre qu’il a créé le Front de libération de la mandoline ! L’idée nous amuse d’abord et nous inspire ensuite. En 2013, il nous invite, Antoine Belgodere, Minicale, Batti de Nobili et Jean-Brice Cordier, à son festival Mandopolis, dans l’arrière-pays niçois, à Puget-Théniers où il a réussi à fidéliser un public pour un rendez-vous estival exclusivement autour de cet instrument à cordes. Ça nous a marqués, notamment le dispositif des « impromptus » qu’on a repris ensuite pour nos Notte di a mandulina : le principe de balades musicales à travers les rues.
Puis avec Tàlcini, on a été invités au festival Berlioz, en Isère, en 2015 : on avait orienté notre programme autour de la mandoline. Cela nous a conduits, à notre retour, à retrouver Ange Lanzalavi que nous ne fréquentions qu’occasionnellement. Après, ça s’est enchaîné parce qu’on avait envie de structurer quelque chose autour de la mandoline.
L’association Mandeo a été créée fin 2017 : dès février 2018, on a participé à l’organisation de la première Académie Internationale de mandoline en Corse, et en août, la première édition du festival sur l’esplanade San Teòfalu. Très modeste, sur une seule soirée, mais déjà 600 personnes ! Première grosse surprise !
Et très majoritairement des Cortenais, deuxième très grosse surprise ! On a vraiment mesuré à ce moment-là leur attachement à la mandoline. Le son de ce si petit instrument et l’évocation du répertoire qui lui était associé avaient provoqué une émotion extraordinaire ! La joie de réentendre ces notes trémolées était palpable. On aurait dit que le festival avait toujours existé, et que ce rendez-vous était familier. On a compris qu’il fallait poursuivre et développer.

Talcini, ©Joseph Casanova / Mandeo
Robba: Comment construisez-vous la programmation du festival ?
AML: Grâce à la mandoline, on peut amener le public à découvrir des répertoires qui pourraient lui sembler étrangers. Mais parce que c’est de la mandoline, les gens vont être curieux et écouter du classique ou autre.
Notre objectif c’est que tout le monde trouve son bonheur. Il y a bien sûr un public qu’on pourrait qualifier de conservateur, qu’il faut considérer : ils viennent pour les morceaux corses spécifiques ou pour les joueurs identifiés : Notte curtinese, sperenze perse… Bien sûr, on aime faire la promotion des artistes corses dans la mesure du possible : les Vallecalle, Ange Lanzalavi, Minicale… mais on va aussi toujours vers de la découverte et on ouvre également aux autre instruments pincés (cetera, oud, harpe, banjo...).
Pour les têtes d’affiche, évidemment, on mise sur la qualité : c’est là que tu peux faire converger les publics. Nous avons des invités de renommée internationale, dont le talent et la virtuosité peuvent mettre tout le monde d’accord. Une énergie passe.
L’année dernière, les Vénézuéliens c’était incroyable ! Nous n’avions jamais vu une telle communion avec le public. Cette édition a connu son pic de fréquentation, nous avons dépassé les 1500 personnes sur le week-end !
AML: Grâce à la mandoline, on peut amener le public à découvrir des répertoires qui pourraient lui sembler étrangers. Mais parce que c’est de la mandoline, les gens vont être curieux et écouter du classique ou autre.
Notre objectif c’est que tout le monde trouve son bonheur. Il y a bien sûr un public qu’on pourrait qualifier de conservateur, qu’il faut considérer : ils viennent pour les morceaux corses spécifiques ou pour les joueurs identifiés : Notte curtinese, sperenze perse… Bien sûr, on aime faire la promotion des artistes corses dans la mesure du possible : les Vallecalle, Ange Lanzalavi, Minicale… mais on va aussi toujours vers de la découverte et on ouvre également aux autre instruments pincés (cetera, oud, harpe, banjo...).
Pour les têtes d’affiche, évidemment, on mise sur la qualité : c’est là que tu peux faire converger les publics. Nous avons des invités de renommée internationale, dont le talent et la virtuosité peuvent mettre tout le monde d’accord. Une énergie passe.
L’année dernière, les Vénézuéliens c’était incroyable ! Nous n’avions jamais vu une telle communion avec le public. Cette édition a connu son pic de fréquentation, nous avons dépassé les 1500 personnes sur le week-end !

Ricardo Sandoval quartet, ©Joseph Casanova / Mandeo
Robba: Mais l’association Mandeo ne se contente pas d’organiser un festival n’est-ce pas ?
Le spectacle vivant, c’est très bien mais ça ne fait pas tout ! Le volet formation est un enjeu majeur que nous développons depuis quelques années. On a une petite école qui s’est d’ailleurs structurée en estudiantine depuis cette année, avec une quinzaine d’élèves âgés de 20 à 80 ans.
Il ne suffit pas d’entendre de la belle mandoline, il faut créer les conditions de son apprentissage et de sa transmission. L’idée c’est de réunir et de dynamiser les forces vives de la mandoline en Corse. Même hors Corte bien sûr ! On a reçu des dons de mandolines et de guitares, de partitions et ressources documentaires des quatre coins de l’île. La recherche doit se poursuivre autour de cette histoire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y a une formidable solidarité pour défendre la mandoline sur l’île et ça nous motive beaucoup.
On travaille aussi sur des projets de compositions pour la mandoline, avec l’école de Mandeo, et avec Tàlcini qui est notre formation scénique, surtout depuis que notre idole Ange Lanzalavi a décidé de se joindre à nous ! C’est le plus bel encouragement que nous avons reçu depuis la création de l’association.
Côté perspectives, on a appris avec beaucoup de bonheur la création d’une nouvelle association Estudiantina autour de René Vallecalle à Bastia, que nous soutenons du mieux que nous pouvons. On travaille à l’ouverture d’une classe de mandoline au conservatoire régional, et on essaie de faire une petite place à la mandoline au sein du diplôme de musique traditionnelle qui vient d’ouvrir à l’Université de Corse.
Je suis persuadé que la mandoline a encore de belles pages à écrire. Une tradition vivante se nourrit de tout ce qu’elle touche et de tout ce qui lui plaît. C’est ça qui fait sens !
Propos recueillis par Vannina Bernard-Leoni
Le spectacle vivant, c’est très bien mais ça ne fait pas tout ! Le volet formation est un enjeu majeur que nous développons depuis quelques années. On a une petite école qui s’est d’ailleurs structurée en estudiantine depuis cette année, avec une quinzaine d’élèves âgés de 20 à 80 ans.
Il ne suffit pas d’entendre de la belle mandoline, il faut créer les conditions de son apprentissage et de sa transmission. L’idée c’est de réunir et de dynamiser les forces vives de la mandoline en Corse. Même hors Corte bien sûr ! On a reçu des dons de mandolines et de guitares, de partitions et ressources documentaires des quatre coins de l’île. La recherche doit se poursuivre autour de cette histoire et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y a une formidable solidarité pour défendre la mandoline sur l’île et ça nous motive beaucoup.
On travaille aussi sur des projets de compositions pour la mandoline, avec l’école de Mandeo, et avec Tàlcini qui est notre formation scénique, surtout depuis que notre idole Ange Lanzalavi a décidé de se joindre à nous ! C’est le plus bel encouragement que nous avons reçu depuis la création de l’association.
Côté perspectives, on a appris avec beaucoup de bonheur la création d’une nouvelle association Estudiantina autour de René Vallecalle à Bastia, que nous soutenons du mieux que nous pouvons. On travaille à l’ouverture d’une classe de mandoline au conservatoire régional, et on essaie de faire une petite place à la mandoline au sein du diplôme de musique traditionnelle qui vient d’ouvrir à l’Université de Corse.
Je suis persuadé que la mandoline a encore de belles pages à écrire. Une tradition vivante se nourrit de tout ce qu’elle touche et de tout ce qui lui plaît. C’est ça qui fait sens !
Propos recueillis par Vannina Bernard-Leoni