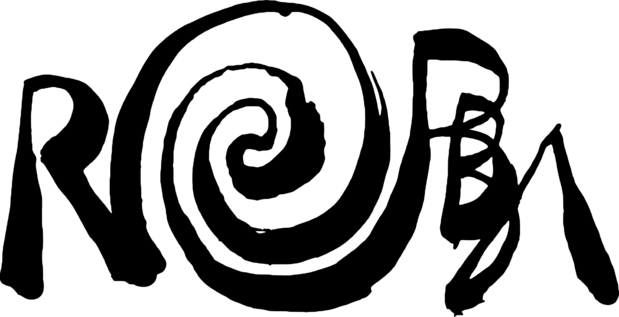André Kertesz, Corsica 1932
Selon Richard Rechtman, qui a déjà contribué à notre revue, "l’ethnopsychiatrie place l’ethnos, c’est-à-dire l’ethnique, et donc la culture, au cœur de sa réflexion et s’appuie pour une part sur les développements de l’ethnologie et de l’anthropologie. Mais si l’ethnologie et l’anthropologie en tant que sciences de l’homme et de la société apportent une connaissance des autres cultures, c’est-à-dire de la façon dont les hommes pensent et habitent les univers symboliques qui constituent le monde dans lequel ils vivent et meurent, l’ethnopsychiatrie se focalise sur les dimensions pathologiques du comportement et de la vie psychique dans ces mêmes univers culturels" [1].
Toutefois, cette démarche ne saurait impliquer une sorte de déresponsabilisation des individus et groupes coupables d'actes ou discours violents. Aussi saillant soit-il, un trait culturel ne saurait leur servir d'explication générale et définitive, et -ce faisant- de circonstance atténuante ou d'excuse pour leurs auteurs.
Dans un article publié dans le numéro 7 de la revue Cuntrasti, en 1987, intitulé "Ethnopsychiatria?", le docteur Jean-Pierre Rumen, psychiatre et psychanalyse, affirmait à la fois l'intérêt de la démarche ethnopsychiatrique et les exigences scientifiques sur lesquelles celle-ci doit nécessairement se fonder. Il mettait aussi en garde contre toute tentative d'essentialisation du rapport des Corses à la violence.
Nous reproduisons ici quelques extraits qui nous paraissent particulièrement susceptibles d'alimenter la réflexion à ce sujet.
[1] "Introduction à l’ethnopsychiatrie", in Vassilis Kapsambelis (dir.), Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l’adulte, Paris, PUF, 2012, p. 213.
Toutefois, cette démarche ne saurait impliquer une sorte de déresponsabilisation des individus et groupes coupables d'actes ou discours violents. Aussi saillant soit-il, un trait culturel ne saurait leur servir d'explication générale et définitive, et -ce faisant- de circonstance atténuante ou d'excuse pour leurs auteurs.
Dans un article publié dans le numéro 7 de la revue Cuntrasti, en 1987, intitulé "Ethnopsychiatria?", le docteur Jean-Pierre Rumen, psychiatre et psychanalyse, affirmait à la fois l'intérêt de la démarche ethnopsychiatrique et les exigences scientifiques sur lesquelles celle-ci doit nécessairement se fonder. Il mettait aussi en garde contre toute tentative d'essentialisation du rapport des Corses à la violence.
Nous reproduisons ici quelques extraits qui nous paraissent particulièrement susceptibles d'alimenter la réflexion à ce sujet.
[1] "Introduction à l’ethnopsychiatrie", in Vassilis Kapsambelis (dir.), Manuel de psychiatrie clinique et psychopathologique de l’adulte, Paris, PUF, 2012, p. 213.
Ethnopsychiatria?
Qu’un malaise politique, une difficulté générale à vivre puissent avoir un retentissement individuel, ou même que la pathologie individuelle puisse être exprimée sur un mode social, ne saurait sans un solide travail d’étayage dépasser le stade d’hypothèse. C’est pourtant un pas qui est rapidement franchi. On affirme sans hésiter « la nature ethnopsychiatrique de la crise que nous connaissons chez nous, Corses » [Casanova J.-C., Azamberti V., « Le nègre blanc ou l’illusion du choix possible », Cuntrasti, n° 1, février 1983, pp. 23-39] et, dans la foulée, « nous pouvons constater en Corse une grande fréquence des troubles où la perturbation de l’identité du soi est extrême » [Bellone H., Casanova J.-C., « La crise d’identité dans la Corse d’aujourd’hui », Cuntrasti, n° 2, mai 1983, pp. 61-76].
La thèse qui sous-tend ces propositions est claire : confronté au conflit entre la culture ancestrale et la culture extérieure, colonisatrice, le sujet ne peut résoudre la contradiction du conflit ethnique. S’ensuit un conflit intrapsychique, source de perturbations. On ne fournit toutefois pas d’exemples cliniques. Or, la pratique quotidienne ne met pas en évidence plus de schizophrénies, plus d’états de dépersonnalisation psychotique ou névrotique qu’ailleurs. Quelques formes cliniques particulières à l’île semblent en fait se circonscrire à des formes de schizophrénies simples, dépressives, abouliques, dans la continuité de ces infinies fatigues dont parle Giudicelli [NDLR : le psychiatre Sébastien Giudicelli, décédé en 2020 ].
Il apparaît bien qu’il faut distinguer le « malaise corse » événementiel et politique, d’un malaise individuel qui serait en rapport avec les difficultés à vivre le précédent. […].
La question de la violence en Corse est particulièrement épineuse. Il est certain que l’île partage avec d’autres îles méditerranéennes le triste privilège d’un nombre important d’homicides (on est toutefois loin des 27 meurtres connus à Orsosolo en Sardaigne, entre 1950 et 1954) Cagnetta F., [Bandits d’Orgosolo, Paris, Buchet-Chastel, 1963]. La violence est même parfois légitimée comme recours politique au nom de l’histoire et de la culture. Mon expérience personnelle d’expert pénal me permet toutefois d’affirmer n’avoir jamais eu l’occasion de déresponsabiliser un meurtrier corse pour une affection mentale… Ceci ne prend évidemment pas option sur le problème de la violence, mais permet de la resituer au plan sociologique, justement.
On notera que c’est une pratique récente que d’amalgamer meurtres, incendies, destructions par explosifs, extorsion de fonds, attaques à main armée, sous l’étiquette globale de violence, comme si tous ces crimes relevaient d’une unicité causale. Or, le terme même de violence prend option sur les causes, il connote par trop rigoureusement la psychopathologie. Un violent, pour l’opinion, n’est-ce pas d’abord un malade ? Ainsi la question rejoint-elle sa réponse avant même d’être posée.
Deux constructions idéologiques opposées en apparence peuvent tirer argument de cette équivalence supposée de la folie et de la violence. L’une affirme l’inanité de la révolte, violente, donc folle, insensée. Elle proclamerait volontiers l’existence d’un chromosome corse surnuméraire. La seconde semble intégrer la notion dynamique de conflit intrapsychique, mais ne fournit aucune indication clinique. Quand bien même elle le ferait, encore faudrait-il démontrer qu’il ne s’agit pas d’un banal état névrotique utilisant le matériel que l’air du temps met à sa portée…
L’absence de documents cliniques se fait cruellement sentir, et se double de celle de documents sociologiques ou ethnologiques.
Il manque à la Corse un travail comme celui de Franco Cagnetta [Bandits à Orgosolo, op. cit.]. Celui-ci démontre puissamment que le meurtre est, en Sardaigne, la réponse à la collusion oppressive du propriétaire, du gendarme et de l’État central. Mais rien n’est dit cependant de la façon dont s’intériorise pour un sujet son acte, tout reste au plan social.
La Corse n’a à offrir dans le registre de ces études que celle, déjà ancienne, de J.-B. Marcaggi [Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui, Ajaccio, La Marge, 1978]. Pour riche qu’elle soit dans son étude biographique des principaux bandits corses, celle-ci n’offre pas d’autre explication à la criminalité du Fium’Orbo et de Palneca que celle constituée par la triple étiologie palustre, alcoolique et des ascendants arabes…
On sait la valeur de « l’explication » raciale. Qu’elle ait récemment cédé le pas à une explication « culturelle » n’indique pas qu’elles soient de nature fondamentalement différente. L’entreprise consiste toujours à offrir à chacun des sujets du groupe une image à laquelle s’identifier. Il est certes moins coûteux de tirer vanité de traits raciaux ou culturels, qui sont donnés, que de contribuer à leur élaboration, de prendre le risque d’être jugé à ses œuvres.
Mais en contrepartie, la solidarité avec celui qui parle au nom du groupe est obligatoire : y renoncer c’est s’exclure du groupe, renoncer à la garantie qu’il confère à l’image, disparaître donc.
Freud s’exclame quelque part qu’on n’en a jamais fini avec la mégalomanie infantile. C’est bien cette position mégalomaniaque, et elle seule, qui peut faire croire qu’on puisse être aimé, non pas pour ce qu’on fait mais pour ce qu’on est. Et d’un tel amour, seule une mère peut être crue capable, jusqu’à ce que l’irruption d’un père, objet de son désir, vienne détromper l’enfant désormais condamné à la nostalgie.
Mais que survienne celui qui saura s’installer en la place laissée vacante par la mère et le nostalgique, qui est en chacun de nous, est en grand danger de consentir à être conforme à n’importe quelle image adéquate au désir de l’Autre… C’est à ce point que s’articulent sujet et collectif, ou plus exactement c’est là que se constitue le lien social. Celui-ci est fait évidemment du rapport du sujet au désir de l’Autre, ce qui dans le concret engage au moins deux organisations mentales. Singulariser « le Corse » parmi les Corses n’est qu’un tour de passe-passe qui a déjà été reconnu dans la transposition de l’identité culturelle du groupe à une supposée identité du sujet.
Le Corse ainsi serait pervers !... « Perversité colonialisante dans un récent passé, comportement fréquent de racisme, etc. » [Casanova J.-C., Azamberti V., op. cit.]. L’explication suit : « Le dominé dominant ne peut être qu’un pervers ». La thèse, là encore, demande à être explicitée : les Corses subissent la domination de l’État français colonialiste. Mais les besoins de cet État les mettent en position d’être à leur tour l’agent de cette domination dans d’autres parties du monde. Ils se retrouvent alors dominateurs et dominés, et victimes du racisme et racistes. Malheureusement, on n’a pas d’exemples de peuples dont l’expérience d’avoir été conquis, exploités, massacrés, les ait mis à l’abri d’exercer à leur tour des sévices sur d’autres peuples.
La thèse qui sous-tend ces propositions est claire : confronté au conflit entre la culture ancestrale et la culture extérieure, colonisatrice, le sujet ne peut résoudre la contradiction du conflit ethnique. S’ensuit un conflit intrapsychique, source de perturbations. On ne fournit toutefois pas d’exemples cliniques. Or, la pratique quotidienne ne met pas en évidence plus de schizophrénies, plus d’états de dépersonnalisation psychotique ou névrotique qu’ailleurs. Quelques formes cliniques particulières à l’île semblent en fait se circonscrire à des formes de schizophrénies simples, dépressives, abouliques, dans la continuité de ces infinies fatigues dont parle Giudicelli [NDLR : le psychiatre Sébastien Giudicelli, décédé en 2020 ].
Il apparaît bien qu’il faut distinguer le « malaise corse » événementiel et politique, d’un malaise individuel qui serait en rapport avec les difficultés à vivre le précédent. […].
La question de la violence en Corse est particulièrement épineuse. Il est certain que l’île partage avec d’autres îles méditerranéennes le triste privilège d’un nombre important d’homicides (on est toutefois loin des 27 meurtres connus à Orsosolo en Sardaigne, entre 1950 et 1954) Cagnetta F., [Bandits d’Orgosolo, Paris, Buchet-Chastel, 1963]. La violence est même parfois légitimée comme recours politique au nom de l’histoire et de la culture. Mon expérience personnelle d’expert pénal me permet toutefois d’affirmer n’avoir jamais eu l’occasion de déresponsabiliser un meurtrier corse pour une affection mentale… Ceci ne prend évidemment pas option sur le problème de la violence, mais permet de la resituer au plan sociologique, justement.
On notera que c’est une pratique récente que d’amalgamer meurtres, incendies, destructions par explosifs, extorsion de fonds, attaques à main armée, sous l’étiquette globale de violence, comme si tous ces crimes relevaient d’une unicité causale. Or, le terme même de violence prend option sur les causes, il connote par trop rigoureusement la psychopathologie. Un violent, pour l’opinion, n’est-ce pas d’abord un malade ? Ainsi la question rejoint-elle sa réponse avant même d’être posée.
Deux constructions idéologiques opposées en apparence peuvent tirer argument de cette équivalence supposée de la folie et de la violence. L’une affirme l’inanité de la révolte, violente, donc folle, insensée. Elle proclamerait volontiers l’existence d’un chromosome corse surnuméraire. La seconde semble intégrer la notion dynamique de conflit intrapsychique, mais ne fournit aucune indication clinique. Quand bien même elle le ferait, encore faudrait-il démontrer qu’il ne s’agit pas d’un banal état névrotique utilisant le matériel que l’air du temps met à sa portée…
L’absence de documents cliniques se fait cruellement sentir, et se double de celle de documents sociologiques ou ethnologiques.
Il manque à la Corse un travail comme celui de Franco Cagnetta [Bandits à Orgosolo, op. cit.]. Celui-ci démontre puissamment que le meurtre est, en Sardaigne, la réponse à la collusion oppressive du propriétaire, du gendarme et de l’État central. Mais rien n’est dit cependant de la façon dont s’intériorise pour un sujet son acte, tout reste au plan social.
La Corse n’a à offrir dans le registre de ces études que celle, déjà ancienne, de J.-B. Marcaggi [Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui, Ajaccio, La Marge, 1978]. Pour riche qu’elle soit dans son étude biographique des principaux bandits corses, celle-ci n’offre pas d’autre explication à la criminalité du Fium’Orbo et de Palneca que celle constituée par la triple étiologie palustre, alcoolique et des ascendants arabes…
On sait la valeur de « l’explication » raciale. Qu’elle ait récemment cédé le pas à une explication « culturelle » n’indique pas qu’elles soient de nature fondamentalement différente. L’entreprise consiste toujours à offrir à chacun des sujets du groupe une image à laquelle s’identifier. Il est certes moins coûteux de tirer vanité de traits raciaux ou culturels, qui sont donnés, que de contribuer à leur élaboration, de prendre le risque d’être jugé à ses œuvres.
Mais en contrepartie, la solidarité avec celui qui parle au nom du groupe est obligatoire : y renoncer c’est s’exclure du groupe, renoncer à la garantie qu’il confère à l’image, disparaître donc.
Freud s’exclame quelque part qu’on n’en a jamais fini avec la mégalomanie infantile. C’est bien cette position mégalomaniaque, et elle seule, qui peut faire croire qu’on puisse être aimé, non pas pour ce qu’on fait mais pour ce qu’on est. Et d’un tel amour, seule une mère peut être crue capable, jusqu’à ce que l’irruption d’un père, objet de son désir, vienne détromper l’enfant désormais condamné à la nostalgie.
Mais que survienne celui qui saura s’installer en la place laissée vacante par la mère et le nostalgique, qui est en chacun de nous, est en grand danger de consentir à être conforme à n’importe quelle image adéquate au désir de l’Autre… C’est à ce point que s’articulent sujet et collectif, ou plus exactement c’est là que se constitue le lien social. Celui-ci est fait évidemment du rapport du sujet au désir de l’Autre, ce qui dans le concret engage au moins deux organisations mentales. Singulariser « le Corse » parmi les Corses n’est qu’un tour de passe-passe qui a déjà été reconnu dans la transposition de l’identité culturelle du groupe à une supposée identité du sujet.
Le Corse ainsi serait pervers !... « Perversité colonialisante dans un récent passé, comportement fréquent de racisme, etc. » [Casanova J.-C., Azamberti V., op. cit.]. L’explication suit : « Le dominé dominant ne peut être qu’un pervers ». La thèse, là encore, demande à être explicitée : les Corses subissent la domination de l’État français colonialiste. Mais les besoins de cet État les mettent en position d’être à leur tour l’agent de cette domination dans d’autres parties du monde. Ils se retrouvent alors dominateurs et dominés, et victimes du racisme et racistes. Malheureusement, on n’a pas d’exemples de peuples dont l’expérience d’avoir été conquis, exploités, massacrés, les ait mis à l’abri d’exercer à leur tour des sévices sur d’autres peuples.