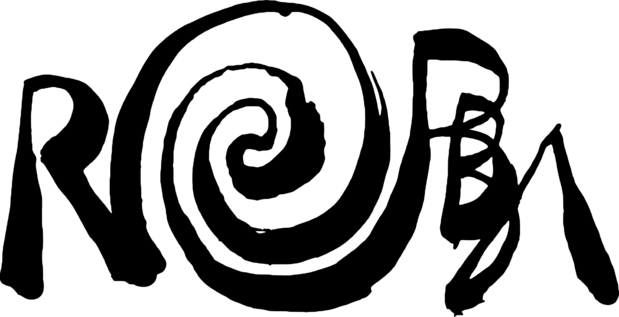Quelques jours après la visite du Pape François en Corse, Ajaccio a été le lieu d’un épouvantable drame. Un homme doté d’une arme à feu en a tué un autre et a blessé gravement six personnes dans la brasserie Le Lamparo, à quelques pas de la cathédrale. Comment est-il possible que dans cette île on puisse passer ainsi, presque consécutivement, d’un moment de grâce, ou jugé comme tel par une majorité de citoyens, au déchainement la plus absurde d’une violence inexplicable ? La question m’a été posée par un journaliste. Que pouvais-je répondre ? Sinon que le Pape avait honoré la Corse d’une visite mais n’était pas venu faire des miracles. Les démons de notre île à l’issu de ce voyage n’en sont devenus que plus hideux. Or, on le dit et on le répète, l’un de ces démons serait celui de la violence.
Je dirais pour être plus précis : d’une certaine violence. Car effectivement, au vu des statistiques, la délinquance générale, qui génère bien évidemment des formes de violences, est moins prégnante en Corse qu’ailleurs. La Corse par contre est la proie d’un fléau plus prégnant qu’ailleurs, celui des homicides. Et cela ne date pas d’aujourd’hui.
Je dirais pour être plus précis : d’une certaine violence. Car effectivement, au vu des statistiques, la délinquance générale, qui génère bien évidemment des formes de violences, est moins prégnante en Corse qu’ailleurs. La Corse par contre est la proie d’un fléau plus prégnant qu’ailleurs, celui des homicides. Et cela ne date pas d’aujourd’hui.
Le fléau des homicides
Dans le rapport annuel adressé autrefois chaque année au chef de l’État sur les crimes et délits recensés en France, le rapporteur en 1825 écrivait : « À Paris, sur 100 accusés, 10 seulement ont été poursuivis pour des crimes contre les personnes ; 90 l’ont été pour des crimes contre les propriétés. Dans la Corse au contraire, 76 accusés sur 100 ont été jugés pour des crimes contre les personnes » [1]. Le taux moyen d’homicides jugés en Corse entre 1825 et 1914 varie entre 10 et 35 homicides pour 100 000 habitants alors que dans le même temps, il varie de 0,8 à 1,5 en moyenne française. Au XXIe siècle, ce taux en Corse varie entre 3,5 et 8 homicides pour 100 000 habitant alors qu’il varie de 1,3 à 1,6 homicides pour 100 000 habitants en moyenne française. Les taux d’homicides sont donc très importants en Corse mais ils ont drastiquement diminué du XIXe au XXe siècles. Ils restent toutefois, comme dans certains départements et territoires d’outre-mer, les taux les plus élevés de France.
Tous ces homicides ne sont pas de même nature, bien entendu. En ce qui les concerne, il me semble que trois types de violences se côtoieraient ou se superposeraient de nos jours : la violence crapuleuse des groupes affairistes et du grand banditisme, la violence politique qui jusque dans les années 2010 n’était pas seulement la violence assumée par des mouvements nationalistes, et ce que je nommerais, sans doute improprement, la violence ordinaire. Cette violence ordinaire, celle générée au niveau des individus en raison de réflexes agressifs irrépressibles ou de mentalités que nous pourrions qualifier de nature tribale ou primaire, serait le cœur même du phénomène. Celui qui conduisait le ministre de l’Intérieur Manuel Valls, en 2013, à affirmer que « la violence est culturellement enracinée en Corse ».
Je voudrais ici revenir sur la manière dont un intellectuel corse de très haut niveau a évoqué cette question dans ses écrits.
Tous ces homicides ne sont pas de même nature, bien entendu. En ce qui les concerne, il me semble que trois types de violences se côtoieraient ou se superposeraient de nos jours : la violence crapuleuse des groupes affairistes et du grand banditisme, la violence politique qui jusque dans les années 2010 n’était pas seulement la violence assumée par des mouvements nationalistes, et ce que je nommerais, sans doute improprement, la violence ordinaire. Cette violence ordinaire, celle générée au niveau des individus en raison de réflexes agressifs irrépressibles ou de mentalités que nous pourrions qualifier de nature tribale ou primaire, serait le cœur même du phénomène. Celui qui conduisait le ministre de l’Intérieur Manuel Valls, en 2013, à affirmer que « la violence est culturellement enracinée en Corse ».
Je voudrais ici revenir sur la manière dont un intellectuel corse de très haut niveau a évoqué cette question dans ses écrits.
[1] Compte général de l’administration de la justice criminelle en France
La question des armes
Jean-Toussaint Desanti, de son aveu même, conservait de son enfance et de sa jeunesse en Corse un rapport curieux avec les armes. Il disait avoir eu l’habitude, où qu’il fut, de se promener armé. Sans doute aimait-il un peu jouer de ce paradoxe et de l’effet de surprise que cela ne manquait jamais de provoquer chez son interlocuteur.
Comment un homme de ce niveau, spécialiste de la philosophie des mathématiques, professeur à la Sorbonne et à l’école normale supérieure de la rue d’Ulm, qui a côtoyé Jean Paul Sartre, André Malraux, Jacques Lacan… pouvait-il admettre et même revendiquer des comportements dont lui-même décrit l’existence chez le plus simple citoyen d’une région de son île natale. Mais le fait est qu’il revendiquait ce « travers ». Il en parle assez longuement dans l’ouvrage qu’il a publié en 1982 : Un destin philosophique.
Pour aborder la question des armes, il commence par révéler la perception qu’il a eu de la loi durant son enfance : « Elle n’avait pas bon visage. D’un côté la suffisance ecclésiastique, de l’autre la sottise militaire » [1]. Et puis un jour vient la découverte : « Le moment où l’on est averti… qu’il existe autre chose que la gluante morale des prêtres et des argousins ; un côté du monde où nait le grand refus » [2].
Ce grand refus n’est pas nécessairement le résultat d’une savante démarche intellectuelle. Il peut n’être que l’effet d’une révolte spontanée ; révolte qui traduit un positionnement éthique : « Qui écrase l’innocent désarmé doit savoir qu’il risque la mort. Le lui faire connaitre par violence et au prix de la vie, cela se doit » [3]. « Redoutable maxime barbare » dit-il immédiatement, « mais à laquelle je me sentais incapable de rester tout à fait sourd ».
Pour expliquer ce sentiment, il se souviens d’un matin de juillet 1942, « le commissariat de la place du Panthéon et les enfants juifs, assis (quelle dérision !) sur leurs valises. Tout autour la flicaille (française) en armes. Ce jour-là j’avoue l’avoir entendue cette voix lointaine, que je croyais enterrée : c’était un désir de meurtre ; tuer, tuer, non pour punir, ni pour venger, mais afin seulement que cela se sache que tout n’est pas permis contre des innocents. Or en ce temps-là, dans Paris et pour des jours encore, nous marchions désarmés » [4].
Jean-Toussaint se dit donc que « pour se sentir vivant » il doit absolument récupérer une arme. « Pour se sentir vivant »… « Comment, ajoute-t-il, un réflexe de tueur potentiel pouvait-il rendre vivant ? »… « C’était ma tête qui s’enrayait… En surface j’étais plus mort que vif, en proie à ce manque… Pas d’arme. Il faut savoir ce que cela veut dire. C’est la crosse qui manque sous la paume et la détente qui manque sous l’index. C’est comme si tout d’un coup, le corps devenait incomplet à la main inutile. Alors c’est le monde même qui vient à manquer, à la mesure de cette incomplétude » [5].
Desanti est conscient bien sûr du fait que tout homme sur cette planète pourrait connaitre un même sentiment de révolte sans ressentir à priori le même manque vis-à-vis d’une arme. Alors il se souvient… Il se souvient d’un vieil homme qui était devenu son ami, vers les années 30, dans un petit village du Fiumorbo. Un vieil homme « toujours armé, bien sûr, comme tous les gens du coin » [6]. Un vieil homme qui lui racontait : « Dans la compagnie où j’ai été incorporé en 1914, il y avait un sergent, un Corse. Tu ne peux pas imaginer quelqu’un de pire. Il t’humiliait par tous les moyens… Il réfléchissait sans cesse au mal qu’il pourrait te faire… Et moi je pensais : « Comment est-ce que je pourrais faire pour le tuer ? » Un type pareil on ne peut pas le laisser vivre… Et je me disais : « il faut le tuer. » Lorsqu’une idée pareille te prend, tu es comme fou… Tu rumines ; tu cherches le moyen. Et tant que tu ne l’a pas trouvé, tu n’es pas vivant… Un jour, figure-toi, ces choses-là arrivent dans les guerres, l’occasion s’est présentée. Je ne l’ai pas manquée… Tout ça parce qu’il était sergent, qu’il avait la Loi pour lui » [7].
En faisant cela, en tuant le sergent, le vieil homme considérait qu’il était « en règle (in regula) ». Il le lui avait dit, « dans son corse de montagne que mon français ne put qu’affadir. « A morte, avait-il dit, a purtava in capu cun tuttu stu male. Maï piu un la francerebbe. Ci vulia tumba lu. Eru in regula » [8].
C’est ce récit de Jean-Toussaint Desanti qui m’a fait penser qu’au-delà du lien étroit qui existe entre la morale et la loi, il existe aussi un lien entre la loi et la langue dans laquelle cette loi est écrite. Lorsque son ami lui dit qu’il était en règle en tuant le sergent, il le lui dit bien sûr en langue corse, mais ce qui est remarquable, c’est que Jean Toussaint à ce moment-là considère qu’il est important, dans un livre écrit en français, de livrer au lecteur la phrase même en langue corse. La règle ne contient tout son sens que dans la langue d’où elle vient. Et même si vous ne la comprenez pas vous devez l’entendre.
L’arme, en ce temps-là, dans ce pays qu’est la Corse, et pour une partie des habitants de ce pays, serait devenue un complément indispensable du corps. Desanti disserte longuement dans son ouvrage, sur le sentiment de manque qu’il a lui-même éprouvé, à Paris en 1942, parce qu’il n’avait pas avec lui son arme : « Ce que je dis ici peut paraître opaque à qui n’a pas vécu dans son adolescence les mêmes circonstances, ni subi les mêmes espèces de rites…
Il faut savoir ce que voulait dire, en certains coins de Corse, à la fin des années 20 de ce siècle, l’accès à la possession d’une arme à feu. C’était le signe d’une mutation par laquelle on sortait de l’enfance… Maintenant on était à égalité avec les adultes… Elle (l’arme) complétait le corps qui, de ce fait, n’était plus vécu comme un corps d’enfant… » Son ami le lui avait dit : « L’arme est un secret dont tu es responsable. Tu la tiens cachée. On doit savoir que si tu la montres, c’est seulement pour t’en servir. Tu ne dois jamais faire un geste de menace. Si on t’insulte, tu ne réponds rien. Tu laisses dire… Une arme, ça n’est pas fait pour faire le fier-à-bras. C’est fait pour indiquer qu’il faut respecter la limite après laquelle on risque la mort… Ainsi apprenait-on à vivre « civilisé » selon l’étrange code de ce lieu. Dans la défiance réciproque, on s’efforçait de différer l’usage de la violence (fût-elle seulement verbale) jusqu’au point de non-retour, qu’on espérait bien ne jamais atteindre » [9].
Ce propos énoncé par un autre que Jean Toussaint Desanti pourrait paraitre soit outrancier, soit destiné à décrire un folklore caricatural et désuet. Mais celui qui nous livre ce témoignage n’est pas n’importe qui et il ne parle pas d’une coutume en vigueur il y a plusieurs siècles. Il est un penseur de très haut niveau et il parle d’un temps très proche. Si proche qu’il reconnait avoir sans doute lui-même gardé des réflexes liés à cette forme de pensée. Il avoue avoir durant sa vie longtemps éprouvé le besoin de sortir se promener armé, y compris dans Paris.
Comment un homme de ce niveau, spécialiste de la philosophie des mathématiques, professeur à la Sorbonne et à l’école normale supérieure de la rue d’Ulm, qui a côtoyé Jean Paul Sartre, André Malraux, Jacques Lacan… pouvait-il admettre et même revendiquer des comportements dont lui-même décrit l’existence chez le plus simple citoyen d’une région de son île natale. Mais le fait est qu’il revendiquait ce « travers ». Il en parle assez longuement dans l’ouvrage qu’il a publié en 1982 : Un destin philosophique.
Pour aborder la question des armes, il commence par révéler la perception qu’il a eu de la loi durant son enfance : « Elle n’avait pas bon visage. D’un côté la suffisance ecclésiastique, de l’autre la sottise militaire » [1]. Et puis un jour vient la découverte : « Le moment où l’on est averti… qu’il existe autre chose que la gluante morale des prêtres et des argousins ; un côté du monde où nait le grand refus » [2].
Ce grand refus n’est pas nécessairement le résultat d’une savante démarche intellectuelle. Il peut n’être que l’effet d’une révolte spontanée ; révolte qui traduit un positionnement éthique : « Qui écrase l’innocent désarmé doit savoir qu’il risque la mort. Le lui faire connaitre par violence et au prix de la vie, cela se doit » [3]. « Redoutable maxime barbare » dit-il immédiatement, « mais à laquelle je me sentais incapable de rester tout à fait sourd ».
Pour expliquer ce sentiment, il se souviens d’un matin de juillet 1942, « le commissariat de la place du Panthéon et les enfants juifs, assis (quelle dérision !) sur leurs valises. Tout autour la flicaille (française) en armes. Ce jour-là j’avoue l’avoir entendue cette voix lointaine, que je croyais enterrée : c’était un désir de meurtre ; tuer, tuer, non pour punir, ni pour venger, mais afin seulement que cela se sache que tout n’est pas permis contre des innocents. Or en ce temps-là, dans Paris et pour des jours encore, nous marchions désarmés » [4].
Jean-Toussaint se dit donc que « pour se sentir vivant » il doit absolument récupérer une arme. « Pour se sentir vivant »… « Comment, ajoute-t-il, un réflexe de tueur potentiel pouvait-il rendre vivant ? »… « C’était ma tête qui s’enrayait… En surface j’étais plus mort que vif, en proie à ce manque… Pas d’arme. Il faut savoir ce que cela veut dire. C’est la crosse qui manque sous la paume et la détente qui manque sous l’index. C’est comme si tout d’un coup, le corps devenait incomplet à la main inutile. Alors c’est le monde même qui vient à manquer, à la mesure de cette incomplétude » [5].
Desanti est conscient bien sûr du fait que tout homme sur cette planète pourrait connaitre un même sentiment de révolte sans ressentir à priori le même manque vis-à-vis d’une arme. Alors il se souvient… Il se souvient d’un vieil homme qui était devenu son ami, vers les années 30, dans un petit village du Fiumorbo. Un vieil homme « toujours armé, bien sûr, comme tous les gens du coin » [6]. Un vieil homme qui lui racontait : « Dans la compagnie où j’ai été incorporé en 1914, il y avait un sergent, un Corse. Tu ne peux pas imaginer quelqu’un de pire. Il t’humiliait par tous les moyens… Il réfléchissait sans cesse au mal qu’il pourrait te faire… Et moi je pensais : « Comment est-ce que je pourrais faire pour le tuer ? » Un type pareil on ne peut pas le laisser vivre… Et je me disais : « il faut le tuer. » Lorsqu’une idée pareille te prend, tu es comme fou… Tu rumines ; tu cherches le moyen. Et tant que tu ne l’a pas trouvé, tu n’es pas vivant… Un jour, figure-toi, ces choses-là arrivent dans les guerres, l’occasion s’est présentée. Je ne l’ai pas manquée… Tout ça parce qu’il était sergent, qu’il avait la Loi pour lui » [7].
En faisant cela, en tuant le sergent, le vieil homme considérait qu’il était « en règle (in regula) ». Il le lui avait dit, « dans son corse de montagne que mon français ne put qu’affadir. « A morte, avait-il dit, a purtava in capu cun tuttu stu male. Maï piu un la francerebbe. Ci vulia tumba lu. Eru in regula » [8].
C’est ce récit de Jean-Toussaint Desanti qui m’a fait penser qu’au-delà du lien étroit qui existe entre la morale et la loi, il existe aussi un lien entre la loi et la langue dans laquelle cette loi est écrite. Lorsque son ami lui dit qu’il était en règle en tuant le sergent, il le lui dit bien sûr en langue corse, mais ce qui est remarquable, c’est que Jean Toussaint à ce moment-là considère qu’il est important, dans un livre écrit en français, de livrer au lecteur la phrase même en langue corse. La règle ne contient tout son sens que dans la langue d’où elle vient. Et même si vous ne la comprenez pas vous devez l’entendre.
L’arme, en ce temps-là, dans ce pays qu’est la Corse, et pour une partie des habitants de ce pays, serait devenue un complément indispensable du corps. Desanti disserte longuement dans son ouvrage, sur le sentiment de manque qu’il a lui-même éprouvé, à Paris en 1942, parce qu’il n’avait pas avec lui son arme : « Ce que je dis ici peut paraître opaque à qui n’a pas vécu dans son adolescence les mêmes circonstances, ni subi les mêmes espèces de rites…
Il faut savoir ce que voulait dire, en certains coins de Corse, à la fin des années 20 de ce siècle, l’accès à la possession d’une arme à feu. C’était le signe d’une mutation par laquelle on sortait de l’enfance… Maintenant on était à égalité avec les adultes… Elle (l’arme) complétait le corps qui, de ce fait, n’était plus vécu comme un corps d’enfant… » Son ami le lui avait dit : « L’arme est un secret dont tu es responsable. Tu la tiens cachée. On doit savoir que si tu la montres, c’est seulement pour t’en servir. Tu ne dois jamais faire un geste de menace. Si on t’insulte, tu ne réponds rien. Tu laisses dire… Une arme, ça n’est pas fait pour faire le fier-à-bras. C’est fait pour indiquer qu’il faut respecter la limite après laquelle on risque la mort… Ainsi apprenait-on à vivre « civilisé » selon l’étrange code de ce lieu. Dans la défiance réciproque, on s’efforçait de différer l’usage de la violence (fût-elle seulement verbale) jusqu’au point de non-retour, qu’on espérait bien ne jamais atteindre » [9].
Ce propos énoncé par un autre que Jean Toussaint Desanti pourrait paraitre soit outrancier, soit destiné à décrire un folklore caricatural et désuet. Mais celui qui nous livre ce témoignage n’est pas n’importe qui et il ne parle pas d’une coutume en vigueur il y a plusieurs siècles. Il est un penseur de très haut niveau et il parle d’un temps très proche. Si proche qu’il reconnait avoir sans doute lui-même gardé des réflexes liés à cette forme de pensée. Il avoue avoir durant sa vie longtemps éprouvé le besoin de sortir se promener armé, y compris dans Paris.
[1] Jean-Toussaint Desanti, Un destin philosophique, Editions Grasset, 1984, p. 146.
[2] Ibid., p. 147.
[3] Ibid., p. 147.
[4] Ibid., p. 148.
[5] Ibid., p. 168.
[6] Ibid., p. 169.
[7] Ibid., page 171.
[8] Ibid., page 172.
[9] Ibid., pp. 190-191.
[9] Ibid., pp. 190-191.
Violence et légitimité
Jean-Toussaint Desanti ne nous dit pas bien sûr qu’il faut passer à l’acte. Mais il nous dit comment, symboliquement, les humains que nous sommes marchent en permanence au bord du gouffre : « Je n’ai jamais vu le sergent. Mais les flics autour des enfants, eux, je les ai vus ». Il dit qu’il n’a ni la sauvagerie ni la folie de son ami du Fiumorbo mais qu’en repensant aux flics de la place du Panthéon en 1942, il comprend comment un homme pouvait basculer et passer à l’acte.
La violence n’est donc pas simplement un réflexe de bête sauvage. La violence est une nécessité liée au devoir de régulation de la vie sociale dans un monde réputé civilisé. L’expression de cette régulation est théoriquement inscrite dans la loi. Mais la loi peut être mauvaise. Les policiers en armes qui entourent les enfants juifs assis sur leurs valises place du Panthéon obéissent à la loi, la loi du gouvernement de Vichy. L’individu alors serait dans son rôle d’être humain en ripostant par la violence à un évènement inqualifiable. C’est en cela que l’arme qu’il porte sur lui serait un instrument légitime de « justice ».
Cette conception de la justice est le résultat de siècles d’imposition à une population, de lois ressenties comme injustes ou, de fait, incomprises. Une permanence qui a conduit ces individus à considérer qu’il était légitime de disposer en permanence du moyen de s’opposer aux gendarmes et autres gardiens de la loi injuste.
Non pas parce qu’ils seraient naturellement et intrinsèquement violents, plus violents que les autres, mais parce que lorsque la loi est elle-même porteuse de l’injustice, il faut pouvoir réagir, se défendre… Un phénomène semblable existe aux États-Unis d’Amérique où les individus ont pris l’habitude durant la conquête de l’Ouest d’assumer individuellement la charge de leur sécurité. Ils n’ont, par la suite, pas voulu renoncer à cette charge et le taux d’homicides y est de même niveau qu’en Corse.
Un philosophe reconnu nous explique ainsi comment ce réflexe de défiance était observable et serait en partie justifié, jusqu’au vingtième siècle, dans une région de France, la Corse. Il nous explique en d’autres termes que la loi et ceux qui font la loi n’étaient pas totalement dignes de confiance du point de vue des habitants de cette région. Comment s’étonner, dès lors, qu’une frange de cette population en plein vingtième siècle préconise de se séparer de cet État et de ses lois ? Et comment ne pas voir que cet État a tout fait durant ce même vingtième siècle pour enfermer plus encore les habitants de cette région dans la défiance.
Il a fallu des réflexes de violence de la part de cette population pour empêcher cet État d’implanter en Corse un centre d’expérimentations nucléaires, pour obliger cet État à interdire le déversement de boues rouges extrêmement nocives au large des côtes de l’île, pour obliger cet État à mettre fin aux agissement frauduleux de producteurs de vins, pour dénoncer l’utilisation par cet État de polices parallèles et de barbouzes, pour dénoncer les agissement d’un préfet qui faisait incendier des paillotes sur les plages plutôt que d’utiliser les moyens normaux à sa disposition, pour empêcher des promoteurs de défigurer le paysage en spéculant et en construisant des horreurs, et pour dénoncer l’assassinat suspect en prison d’un militant nationaliste…
La violence n’est donc pas simplement un réflexe de bête sauvage. La violence est une nécessité liée au devoir de régulation de la vie sociale dans un monde réputé civilisé. L’expression de cette régulation est théoriquement inscrite dans la loi. Mais la loi peut être mauvaise. Les policiers en armes qui entourent les enfants juifs assis sur leurs valises place du Panthéon obéissent à la loi, la loi du gouvernement de Vichy. L’individu alors serait dans son rôle d’être humain en ripostant par la violence à un évènement inqualifiable. C’est en cela que l’arme qu’il porte sur lui serait un instrument légitime de « justice ».
Cette conception de la justice est le résultat de siècles d’imposition à une population, de lois ressenties comme injustes ou, de fait, incomprises. Une permanence qui a conduit ces individus à considérer qu’il était légitime de disposer en permanence du moyen de s’opposer aux gendarmes et autres gardiens de la loi injuste.
Non pas parce qu’ils seraient naturellement et intrinsèquement violents, plus violents que les autres, mais parce que lorsque la loi est elle-même porteuse de l’injustice, il faut pouvoir réagir, se défendre… Un phénomène semblable existe aux États-Unis d’Amérique où les individus ont pris l’habitude durant la conquête de l’Ouest d’assumer individuellement la charge de leur sécurité. Ils n’ont, par la suite, pas voulu renoncer à cette charge et le taux d’homicides y est de même niveau qu’en Corse.
Un philosophe reconnu nous explique ainsi comment ce réflexe de défiance était observable et serait en partie justifié, jusqu’au vingtième siècle, dans une région de France, la Corse. Il nous explique en d’autres termes que la loi et ceux qui font la loi n’étaient pas totalement dignes de confiance du point de vue des habitants de cette région. Comment s’étonner, dès lors, qu’une frange de cette population en plein vingtième siècle préconise de se séparer de cet État et de ses lois ? Et comment ne pas voir que cet État a tout fait durant ce même vingtième siècle pour enfermer plus encore les habitants de cette région dans la défiance.
Il a fallu des réflexes de violence de la part de cette population pour empêcher cet État d’implanter en Corse un centre d’expérimentations nucléaires, pour obliger cet État à interdire le déversement de boues rouges extrêmement nocives au large des côtes de l’île, pour obliger cet État à mettre fin aux agissement frauduleux de producteurs de vins, pour dénoncer l’utilisation par cet État de polices parallèles et de barbouzes, pour dénoncer les agissement d’un préfet qui faisait incendier des paillotes sur les plages plutôt que d’utiliser les moyens normaux à sa disposition, pour empêcher des promoteurs de défigurer le paysage en spéculant et en construisant des horreurs, et pour dénoncer l’assassinat suspect en prison d’un militant nationaliste…
La Corse qui n’existe plus
S’il en avait existé, il n’existe plus de justification au passage à l’acte, bien entendu, parce que la Corse dont nous parle Jean-Toussaint Desanti, la Corse de son enfance et de sa jeunesse, est une Corse qui n’existe plus. Dans un autre contexte, c’est ce qu’avait répondu Marie Susini [1] à son interlocuteur dans une émission de télévision, « Le journal d’en France », réalisée en direct de la citadelle de Corte en 1982.
Cette Corse-là, de l’enfance de Jean-Toussaint Desanti et de Marie Susini, n’existe plus, certes, mais la capacité d’indignation des individus demeure. Elle demeure parce que ce qui était dans la culture des Corses comme de tous les petits peuples trop longtemps soumis au cours de l’histoire aux lois des envahisseurs, ce n’est pas d’abord la violence, c’est essentiellement le désir de justice. Un désir de justice exprimé avec leurs mots contre les mots, écrits à l’origine dans une langue étrangère, souvent inadaptés, parfois incompréhensibles, ressentis comme injustes, expression de la loi des intrus. Cette loi des intrus qui aurait dû devenir, avec le temps, la loi des insulaires et qui l’est donc insuffisamment devenue.
La loi est acceptée, les tribunaux sont respectés lorsqu’ils ont su donner pleinement le sentiment de répandre la justice. Mais lorsque le sentiment plus ou moins contraire s’éternise trop longtemps, le désir de justice se pervertit lui-même, les individus perdent le sens des limites, les colères envahissent tous l’espace et prennent la place des attitudes raisonnables, les fous et les voyous s’emparent de la contradiction et peuvent continuer de commettre les actes les plus inqualifiables et les plus déviants.
Cette Corse-là, de l’enfance de Jean-Toussaint Desanti et de Marie Susini, n’existe plus, certes, mais la capacité d’indignation des individus demeure. Elle demeure parce que ce qui était dans la culture des Corses comme de tous les petits peuples trop longtemps soumis au cours de l’histoire aux lois des envahisseurs, ce n’est pas d’abord la violence, c’est essentiellement le désir de justice. Un désir de justice exprimé avec leurs mots contre les mots, écrits à l’origine dans une langue étrangère, souvent inadaptés, parfois incompréhensibles, ressentis comme injustes, expression de la loi des intrus. Cette loi des intrus qui aurait dû devenir, avec le temps, la loi des insulaires et qui l’est donc insuffisamment devenue.
La loi est acceptée, les tribunaux sont respectés lorsqu’ils ont su donner pleinement le sentiment de répandre la justice. Mais lorsque le sentiment plus ou moins contraire s’éternise trop longtemps, le désir de justice se pervertit lui-même, les individus perdent le sens des limites, les colères envahissent tous l’espace et prennent la place des attitudes raisonnables, les fous et les voyous s’emparent de la contradiction et peuvent continuer de commettre les actes les plus inqualifiables et les plus déviants.
[1] Marie Susini, écrivaine (1916-1993) née à Rennu. Cf. Etudes corses, n°91, décembre 2024.